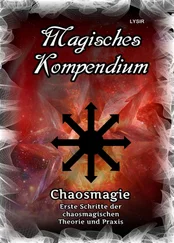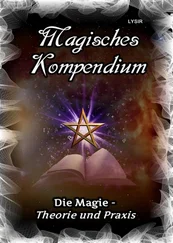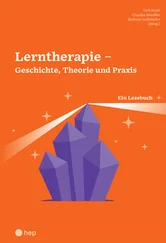| 1. |
TIFF (Baseline 6.0 sans compression) |
Note: 84,8. |
| 2. |
PNG 1.2 |
Note: 78. |
| 3. |
JP2 (JPEG 2000 Part 1) lossless |
Note: 74,7. |
| 4. |
JP2 (JPEG 2000 Part 1) lossy |
Note: 66,1. |
| 5. |
Basic JFIF (JPEG) 1.02 |
Note: 65,4. |
| 6. |
TIFF 6.0 LZW |
Note: 65,3. |
On constate que ces deux classements sont différents. Si l’établissement d’une méthode universelle, valable dans toute situation, était le but de ces deux études, alors cette constatation serait une contradiction. Mais les études de la Bibliothèque nationale des Pays-Bas 29indiquent que les facteurs de pondération doivent être établis en fonction des situations particulières. Dans le même esprit, les recommandations du CECO précisent bien qu’il n’existe pas un unique format valable dans toute situation, et qu’il est nécessaire de tenir compte de l’application prévue pour faire un choix.
En effet, les deux méthodes décrites ci-dessus sont imparfaites. Ces méthodes visent à simplifier le plus possible l’évaluation et le choix d’un format en ramenant tous les critères sur une seule dimension. Ainsi, en additionnant des nombres correspondant à divers critères, on établit un moyen permettant de comparer des critères qui peuvent ne rien avoir en commun. Une telle simplification est discutable.
Une autre observation que l’on peut faire est que les processus définis par les méthodes brièvement présentées ci-dessus impliquent de noter les formats selon divers critères. Mais la façon dont il s’agit d’attribuer les notes est subjective. Elle dépend des personnes chargées de cette tâche. Or, les compétences et l’expérience de ces gens influent certainement sur les notes distribuées.
En résumé, les méthodes d’évaluation de formats vues plus haut donnent un faux sentiment de rigueur. Elles permettent d’obtenir des chiffres et d’en déduire un ou plusieurs formats plus adaptés que les autres, alors qu’il n’est pas possible de définir ces chiffres de manière unique. Il est d’ailleurs utopique de vouloir créer une méthode absolument rigoureuse, puisque le choix d’un format dans le domaine de la conservation à long terme n’est pas seulement une question de compétence et de réflexion, mais aussi un pari sur l’avenir.
Le choix d’un format d’images pour un projet de numérisation: Méthode alternative (arbre de décision) 30
Les limites des méthodes discutées plus haut incitent à réfléchir à une méthode mieux adaptée. Le point essentiel est de pouvoir distinguer entre différentes situations, et il est par conséquent nécessaire de renoncer à un format unique qui serait valable dans tous les cas.
D’ailleurs, certaines institutions renoncent au format TIFF 31pourtant généralement indiqué comme le format à privilégier, comme cela est illustré par les études citées ci-dessus. Bien qu’il soit possible d’analyser ces choix divergents comme des erreurs, il semble beaucoup plus raisonnable de voir dans ces exemples une preuve de la nécessité de reconnaître que selon les cas, il s’agit de choisir des formats différents.
Dans la suite de cet article, on propose une méthode d’évaluation en arbre, qui permet de distinguer différentes situations en plusieurs étapes. Pour faciliter le choix, le processus décrit ci-dessous limite les possibilités à quelques formats dont les qualités sont telles que les risques sont aussi faibles que possible.
L’utilisation et les limites de la méthode en arbre
— Cet article n’a pas pour objectif d’étudier tous les formats d’images existants, ce qui serait impossible, mais il propose un processus permettant d’effectuer un choix raisonnable en fonction du contexte. Les formats et les algorithmes de compression proposés ici peuvent être considérés comme aptes à l’archivage à long terme, comme cela est brièvement expliqué plus haut.
Toutefois, d’autres formats et d’autres algorithmes de compression peuvent également être envisagés en cas de nécessité. Ainsi, cet article prend le point de vue d’une institution engagée dans des travaux de numérisation de documents originaux, ce qui lui laisse un contrôle entier sur le choix du format. Mais on peut imaginer une situation différente: une institution patrimoniale peut tout-à-fait se voir proposer des images numériques produites hors de son contrôle. Dans une telle situation, il vaut mieux commencer par étudier l’aptitude à l’archivage du format proposé plutôt que de convertir les images dans le format précédemment choisi par l’institution pour ses propres travaux.
— Le processus décrit ci-dessous, et permettant d’aboutir à un choix de format d’images n’est pas décrit en détail et laisse une liberté considérable aux personnes engages dans le choix d’un format d’images. En effet, il est impossible de prévoir toutes les situations et ce ne sont donc que les grandes lignes qui sont décrites ci-dessous. Certaines étapes nécessitent un travail d’analyse et de réflexion important, qu’il n’est pas possible d’éviter.
— Tous les formats dont il est question dans cet article sont des formats laissant une marge de manœuvre plus ou moins grande. Parmi les éléments le plus souvent discutés se trouvent l’algorithme de compression, qui peut soit être choisi (cas du format TIFF et du format PDF), soit être réglé à un niveau qui est à la convenance du producteur (cas de JPEG et de JPEG 2000), et la résolution de l’image, qui ne dépend pas du format. Mais il y a en réalité une grande quantité d’autres éléments qui doivent être déterminés.
Par exemple, les métadonnées, de tout type, sont des informations qu’il est possible d’intégrer directement dans le fichier d’une image et qu’il est nécessaire de sélectionner préalablement. Par la suite, il faut trouver le moyen de les inscrire dans le fichier au moment de la production des images (dans le cas contraire, seules les métadonnées automatiquement inscrites sont présentes dans les fichiers).
D’autre part, les données qui décrivent une image peuvent être organisées de différentes manières, selon les possibilités offertes par les formats et selon le choix du producteur. Ainsi, et à titre d’illustration, TIFF donne la possibilité d’organiser les images en tuiles (il s’agit de diviser une image en plusieurs petites images rectangulaires, de sorte à faciliter l’accès à une région de l’image) au lieu de l’organisation en lignes qui est en principe l’organisation par défaut. Pour sa part, JPEG 2000 permet de choisir entre différentes organisations qui facilitent l’une ou l’autre utilisation. Par exemple, il est possible d’organiser les données d’une image de sorte à faciliter la transmission de cette image à une résolution plus faible que celle de l’image originale. L’idée est de placer d’abord les données permettant de construire l’image à une faible résolution, puis celles permettant de construire l’image à une résolution moyenne, et finalement les données permettant d’obtenir l’image originale de haute qualité. De cette façon, un utilisateur du web pourrait visualiser une copie de faible résolution sans avoir à attendre le chargement de toutes les données de l’image originale.
Il est donc très important de ne pas se contenter de choisir un format et un éventuel algorithme de compression, mais de déterminer aussi les caractéristiques, avec tous les détails nécessaires, que l’on souhaite pour les images numériques qu’une institution veut produire. Ces choix doivent faire l’objet d’une spécification, telle celle de la Bibliothèque nationale des Pays-Bas pour les caractéristiques techniques, 32et tel le travail effectué par les AEG et les Archives de la Ville de Genève pour les métadonnées. 33
Читать дальше