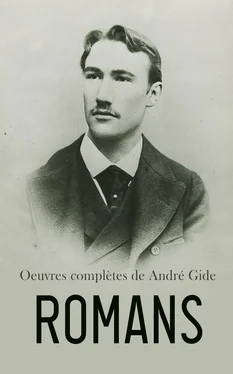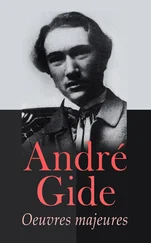André Gide - Oeuvres complètes de André Gide - Romans
Здесь есть возможность читать онлайн «André Gide - Oeuvres complètes de André Gide - Romans» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Oeuvres complètes de André Gide: Romans
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Oeuvres complètes de André Gide: Romans: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Oeuvres complètes de André Gide: Romans»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Table des Matières:
Les Cahiers d'André Walter
Le Voyage d'Urien
Paludes
Le Prométhée mal enchaîné
L'Immoraliste
Le Retour de l'enfant prodigue
La Porte étroite
Isabelle
Les Caves du Vatican
La Symphonie Pastorale
Les Faux-monnayeurs
L'École des femmes
Robert
Geneviève
Oeuvres complètes de André Gide: Romans — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Oeuvres complètes de André Gide: Romans», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
L’ombre était si dense, sous eux, que je n’osais m’y arrêter après la marche qui me faisait encore transpirer. Pourtant les escaliers ne m’exténuaient plus ; je m’exerçais à les gravir la bouche close ; j’espaçais toujours plus mes haltes, me disais : j’irai jusque-là sans faiblir ; puis, arrivé au but, trouvant dans mon orgueil content ma récompense, je respirais longuement, puissamment, et de façon qu’il me semblât sentir l’air pénétrer plus efficacement ma poitrine. Je reportais à tous ces soins du corps mon assiduité de naguère. Je progressais.
Je m’étonnais parfois que ma santé revînt si vite. J’en arrivais à croire que je m’étais d’abord exagéré la gravité de mon état ; à douter que j’eusse été très malade, à rire de mon sang craché, à regretter que ma guérison ne fût pas demeurée plus ardue.
Je m’étais soigné d’abord fort sottement, ignorant les besoins de mon corps. J’en fis la patiente étude et devins, quant à la prudence et aux soins, d’une ingéniosité si constante que je m’y amusai comme à un jeu. Ce dont encore je souffrais le plus, c’était ma sensibilité maladive au moindre changement de la température. J’attribuais, à présent que mes poumons étaient guéris, cette hyperesthésie à ma débilité nerveuse, reliquat de la maladie. Je résolus de vaincre cela. La vue des belles peaux hâlées et comme pénétrées de soleil, que montraient, en travaillant aux champs, la veste ouverte, quelques paysans débraillés, m’incitait à me laisser hâler de même. Un matin, m’étant mis à nu, je me regardai ; la vue de mes trop maigres bras, de mes épaules, que les plus grands efforts ne pouvaient rejeter suffisamment en arrière, mais surtout la blancheur ou plutôt la décoloration de ma peau, m’emplit et de honte et de larmes. Je me rhabillai vite, et, au lieu de descendre vers Amalfi, comme j’avais accoutumé de faire, me dirigeai vers des rochers couverts d’herbe rase et de mousse, loin des habitations, loin des routes, où je savais ne pouvoir être vu. Arrivé là, je me dévêtis lentement. L’air était presque vif, mais le soleil ardent. J’offris tout mon corps à sa flamme. Je m’assis, me couchai, me tournai. Je sentais sous moi le sol dur ; l’agitation des herbes folles me frôlait. Bien qu’à l’abri du vent, je frémissais et palpitais à chaque souffle. Bientôt m’enveloppa une cuisson délicieuse ; tout mon être affluait vers ma peau.
Nous demeurâmes à Ravello quinze jours ; chaque matin je retournais vers ces rochers, faisais ma cure. Bientôt l’excès de vêtement dont je me recouvrais encore devint gênant et superflu ; mon épiderme tonifié cessa de transpirer sans cesse et sut se protéger par sa propre chaleur.
Le matin d’un des derniers jours (nous étions au milieu d’avril) j’osai plus. Dans une anfractuosité des rochers dont je parle, une source claire coulait. Elle retombait ici même en cascade, assez peu abondante, il est vrai, mais elle avait creusé sous la cascade un bassin plus profond où l’eau très pure s’attardait. Par trois fois j’y étais venu, m’étais penché, m’étais étendu sur la berge, plein de soif et plein de désirs ; j’avais contemplé longuement le fond de roc poli, où l’on ne découvrait pas une salissure, pas une herbe, où le soleil, en vibrant et en se diaprant, pénétrait. Ce quatrième jour, j’avançai, résolu d’avance, jusqu’à l’eau plus claire que jamais, et, sans plus réfléchir, m’y plongeai d’un coup tout entier. Vite transi, je quittai l’eau, m’étendis sur l’herbe, au soleil. Là, des menthes croissaient, odorantes ; j’en cueillis, j’en froissai les feuilles, j’en frottai tout mon corps humide mais brûlant. Je me regardai longuement, sans plus de honte aucune, avec joie. Je me trouvais, non pas robuste encore, mais pouvant l’être, harmonieux, sensuel, presque beau.
VII
Table des matières
Ainsi me contentais-je pour toute action, tout travail, d’exercices physiques qui, certes, impliquaient ma morale changée, mais qui ne m’apparaissaient déjà plus que comme un entraînement, un moyen, et ne me satisfaisaient plus pour eux-mêmes.
Un autre acte pourtant, à vos yeux ridicule peut-être, mais que je redirai, car il précise en sa puérilité le besoin qui me tourmentait de manifester au dehors l’intime changement de mon être : À Amalfi, je m’étais fait raser.
Jusqu’à ce jour j’avais porté toute ma barbe, avec les cheveux presque ras. Il ne me venait pas à l’idée qu’aussi bien j’aurais pu porter une coiffure différente. Et, brusquement, le jour où je me mis pour la première fois nu sur la roche, cette barbe me gêna ; c’était comme un dernier vêtement que je n’aurais pu dépouiller ; je la sentais comme postiche ; elle était soigneusement taillée, non pas en pointe, mais en une forme carrée, qui me parut aussitôt très déplaisante et ridicule. Rentré dans la chambre d’hôtel, je me regardai dans la glace et me déplus ; j’avais l’air de ce que j’avais été jusqu’alors : un chartiste. Sitôt après le déjeuner, je descendis à Amalfi, ma résolution prise. La ville est très petite : je dus me contenter d’une vulgaire échoppe sur la place. C’était jour de marché ; la boutique était pleine ; je dus attendre interminablement ; mais rien, ni les rasoirs douteux, le blaireau jaune, l’odeur, les propos du barbier, ne put me faire reculer. Sentant sous les ciseaux tomber ma barbe, c’était comme si j’enlevais un masque. N’importe ! quand, après, je m’apparus, l’émotion qui m’emplit et que je réprimai de mon mieux, ne fut pas la joie, mais la peur. Je ne discute pas ce sentiment ; je le constate. Je trouvais mes traits assez beaux... non, la peur venait de ce qu’il me semblait qu’on voyait à nu ma pensée et de ce que, soudain, elle me paraissait redoutable.
Par contre, je laissai pousser mes cheveux.
Voilà tout ce que mon être neuf, encore désœuvré, trouvait à faire. Je pensais qu’il naîtrait de lui des actes étonnants pour moi-même ; mais plus tard ; plus tard, me disais-je, — quand l’être serait plus formé. Forcé de vivre en attendant, je conservais, comme Descartes, une façon provisoire d’agir. Marceline ainsi put s’y tromper. Le changement de mon regard, il est vrai, et, surtout le jour où j’apparus sans barbe, l’expression nouvelle de mes traits, l’auraient inquiétée peut-être, mais elle m’aimait trop déjà pour me bien voir ; puis je la rassurais de mon mieux. Il importait qu’elle ne troublât pas ma renaissance ; pour la soustraire à ses regards, je devais donc dissimuler.
Aussi bien celui que Marceline aimait, celui qu’elle avait épousé, ce n’était pas mon « nouvel être ». Et je me redisais cela, pour m’exciter à le cacher. Ainsi ne lui livrai-je de moi qu’une image qui, pour être constante et fidèle au passé, devenait de jour en jour plus fausse.
Mes rapports avec Marceline demeurèrent donc, en attendant, les mêmes — quoique plus exaltés de jour en jour, par un toujours plus grand amour. Ma dissimulation même (si l’on peut appeler ainsi le besoin de préserver de son jugement ma pensée), ma dissimulation l’augmentait. Je veux dire que ce jeu m’occupait de Marceline sans cesse. Peut-être cette contrainte au mensonge me coûta-t-elle un peu d’abord ; mais j’arrivai vite à comprendre que les choses réputées les pires (le mensonge, pour ne citer que celle-là) ne sont difficiles à faire que tant qu’on ne les a jamais faites ; mais qu’elles deviennent chacune, et très vite, aisées, plaisantes, douces à refaire, et bientôt comme naturelles. Ainsi donc, comme à chaque chose pour laquelle un premier dégoût est vaincu, je finis par trouver plaisir à cette dissimulation même, à m’y attarder, comme au jeu de mes facultés inconnues. Et j’avançais chaque jour, dans une vie plus riche et plus pleine, vers un plus savoureux bonheur.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Oeuvres complètes de André Gide: Romans»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Oeuvres complètes de André Gide: Romans» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Oeuvres complètes de André Gide: Romans» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.