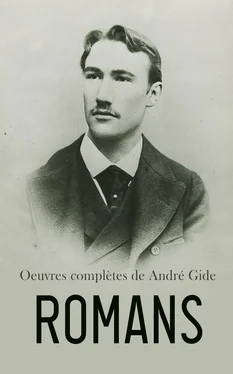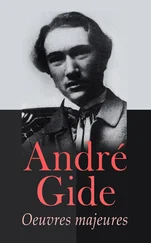André Gide - Oeuvres complètes de André Gide - Romans
Здесь есть возможность читать онлайн «André Gide - Oeuvres complètes de André Gide - Romans» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Oeuvres complètes de André Gide: Romans
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Oeuvres complètes de André Gide: Romans: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Oeuvres complètes de André Gide: Romans»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Table des Matières:
Les Cahiers d'André Walter
Le Voyage d'Urien
Paludes
Le Prométhée mal enchaîné
L'Immoraliste
Le Retour de l'enfant prodigue
La Porte étroite
Isabelle
Les Caves du Vatican
La Symphonie Pastorale
Les Faux-monnayeurs
L'École des femmes
Robert
Geneviève
Oeuvres complètes de André Gide: Romans — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Oeuvres complètes de André Gide: Romans», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Puis, brusquement, je songeai que je délaissais un peu Marceline.
Elle était assise à l’avant ; je m’approchai, et, pour la première fois vraiment, la regardai.
Marceline était très jolie. Vous le savez ; vous l’avez vue. Je me reprochai de ne m’en être pas d’abord aperçu. Je la connaissais trop pour la voir avec nouveauté ; nos familles de tout temps étaient liées ; je l’avais vue grandir ; j’étais habitué à sa grâce... Pour la première fois je m’étonnai, tant cette grâce me parut grande.
Sur un simple chapeau de paille noire elle laissait flotter un grand voile ; elle était blonde, mais ne paraissait pas délicate. Sa jupe et son corsage pareils étaient faits d’un châle écossais que nous avions choisi ensemble. Je n’avais pas voulu qu’elle s’assombrît de mon deuil.
Elle sentit que je la regardais, se retourna vers moi... jusqu’alors je n’avais eu près d’elle qu’un empressement de commande ; je remplaçais, tant bien que mal, l’amour par une sorte de galanterie froide qui, je le voyais bien, l’importunait un peu ; Marceline sentit-elle à cet instant que je la regardais pour la première fois d’une manière différente ? À son tour elle me regarda fixement ; puis, très tendrement, me sourit. Sans parler, je m’assis près d’elle. J’avais vécu pour moi ou du moins selon moi jusqu’alors ; je m’étais marié sans imaginer en ma femme autre chose qu’un camarade, sans songer bien précisément que, de notre union, ma vie pourrait être changée. Je venais de comprendre enfin que là cessait le monologue.
Nous étions tous deux seuls sur le pont. Elle tendit son front vers moi ; je la pressai doucement contre moi ; elle leva les yeux ; je l’embrassai sur les paupières, et sentis brusquement, à la faveur de mon baiser, une sorte de pitié nouvelle ; elle m’emplit si violemment, que je ne pus retenir mes larmes.
— Qu’as-tu donc ? me dit Marceline.
Nous commençâmes à parler. Ses propos charmants me ravirent. Je m’étais fait, comme j’avais pu, quelques idées sur la sottise des femmes. Près d’elle, ce soir-là, ce fut moi qui me parus gauche et stupide.
Ainsi donc celle à qui j’attachais ma vie avait sa vie propre et réelle ! L’importance de cette pensée m’éveilla plusieurs fois cette nuit ; plusieurs fois je me dressai sur ma couchette pour voir, sur l’autre couchette, plus bas, Marceline, ma femme, dormir.
Le lendemain le ciel était splendide ; la mer calme à peu près. Quelques conversations point pressées diminuèrent encore notre gêne. Le mariage vraiment commençait. Au matin du dernier jour d’octobre nous débarquâmes à Tunis.
Mon intention était de n’y rester que peu de jours. Je vous confesserai ma sottise : rien dans ce pays neuf ne m’attirait que Carthage et quelques ruines romaines : Timgat, dont Octave m’avait parlé, les mosaïques de Sousse et surtout l’amphithéâtre d’El Djem, où je me proposais de courir sans retard. Il fallait d’abord gagner Sousse, puis de Sousse prendre la voiture des postes ; je voulais que rien d’ici là ne fût digne de m’occuper.
Pourtant Tunis me surprit fort. Au toucher de nouvelles sensations s’émouvaient telles parties de moi, des facultés endormies qui, n’ayant pas encore servi, avaient gardé toute leur mystérieuse jeunesse. J’étais plus étonné, ahuri, qu’amusé, et ce qui me plaisait surtout, c’était la joie de Marceline.
Ma fatigue cependant devenait chaque jour plus grande ; mais j’eusse trouvé honteux d’y céder. Je toussais et sentais au haut de la poitrine un trouble étrange. Nous allons vers le Sud, pensais-je ; la chaleur me remettra.
La diligence de Sfax quitte Sousse le soir à huit heures ; elle traverse El Djem à une heure du matin. Nous avions retenu les places du coupé. Je m’attendais à trouver une guimbarde inconfortable ; nous étions au contraire assez commodément installés. Mais le froid !... Par quelle puérile confiance en la douceur d’air du Midi, légèrement vêtus tous deux, n’avions-nous emporté qu’un châle ? Sitôt sortis de Sousse et de l’abri de ses collines, le vent commença de souffler. Il faisait de grands bonds sur la plaine, hurlait, sifflait, entrait par chaque fente des portières ; rien ne pouvait en préserver. Nous arrivâmes tout transis ; moi, de plus, exténué par les cahots de la voiture, et par une horrible toux qui me secouait encore plus. Quelle nuit ! — Arrivés à El Djem, pas d’auberge ; un affreux bordj en tenait lieu. Que faire ? La diligence repartait. Le village était endormi ; dans la nuit qui paraissait immense on entrevoyait vaguement la masse lugubre des ruines ; des chiens hurlaient. Nous rentrâmes dans une salle terreuse où deux lits misérables étaient dressés. Marceline tremblait de froid, mais là du moins le vent ne nous atteignait plus.
Le lendemain fut un jour morne. Nous fûmes surpris, en sortant, de voir un ciel uniformément gris. Le vent soufflait toujours, mais moins impétueusement que la veille. La diligence ne devait repasser que le soir... Ce fut, vous dis-je, un jour lugubre. L’amphithéâtre, en quelques instants parcouru, me déçut ; même il me parut laid, sous ce ciel terne. Peut-être ma fatigue aidait-elle, augmentait-elle mon ennui. Vers le milieu du jour, par désœuvrement, j’y revins, cherchant en vain quelques inscriptions sur les pierres. Marceline, à l’abri du vent, lisait un livre anglais qu’elle avait par bonheur emporté. Je revins m’asseoir auprès d’elle.
— Quel triste jour ! Tu ne t’ennuies pas trop ? lui dis-je.
— Non : tu vois : je lis.
— Que sommes-nous venus faire ici ? Tu n’as pas froid, au moins.
— Pas trop. Et toi ? C’est vrai ! tu es tout pâle.
— Non...
La nuit, le vent reprit sa force... Enfin la diligence arriva. Nous repartîmes.
Dès les premiers cahots je me sentis brisé. Marceline, très fatiguée, s’endormit vite sur mon épaule. Mais ma toux va la réveiller, pensai-je, et doucement, doucement, me dégageant, je l’inclinai vers la paroi de la voiture. Cependant je ne toussais plus, non : je crachais ; c’était nouveau ; j’amenais cela sans effort ; cela venait par petits coups, à intervalles réguliers ; c’était une sensation si bizarre que d’abord je m’en amusai presque, mais je fus bien vite écœuré par le goût inconnu que cela me laissait dans la bouche. Mon mouchoir fut vite hors d’usage. Déjà j’en avais plein les doigts. Vais-je réveiller Marceline ?... Heureusement je me souvins d’un grand foulard qu’elle passait à sa ceinture. Je m’en emparai doucement. Les crachats que je ne retins plus vinrent avec plus d’abondance. J’en étais extraordinairement soulagé. C’est la fin du rhume, pensais-je. Soudain je me sentis très faible ; tout se mit à tourner et je crus que j’allais me trouver mal. Vais-je la réveiller ?... ah ! fi !... (J’ai gardé, je crois, de mon enfance puritaine la haine de tout abandon par faiblesse ; je le nomme aussitôt lâcheté.) Je me repris, me cramponnai, finis par maîtriser mon vertige... Je me crus sur mer de nouveau, et le bruit des roues devenait le bruit de la lame... Mais j’avais cessé de cracher.
Puis, je roulai dans une sorte de sommeil.
Quand j’en sortis, le ciel était déjà plein d’aube ; Marceline dormait encore. Nous approchions. Le foulard que je tenais à la main était sombre, de sorte qu’il n’y paraissait rien d’abord ; mais, quand je ressortis mon mouchoir, je vis avec stupeur qu’il était plein de sang.
Ma première pensée fut de cacher ce sang à Marceline. Mais comment ? — J’en étais tout taché ; j’en voyais partout, à présent ; mes doigts surtout... — J’aurai saigné du nez... C’est cela ; si elle interroge, je lui dirai que j’ai saigné du nez.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Oeuvres complètes de André Gide: Romans»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Oeuvres complètes de André Gide: Romans» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Oeuvres complètes de André Gide: Romans» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.