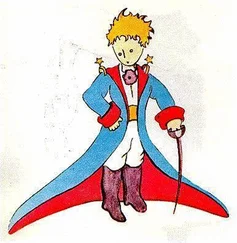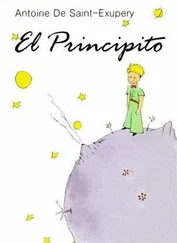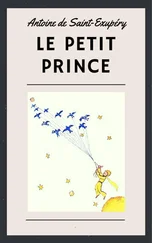Il ne s’agit point ici du Commandant Alias mais de tous les hommes. Au cours des corvées de l’enterrement, nous y aimions le mort, nous ne sommes pas en contact avec la mort. La mort est une grande chose. Elle est un nouveau réseau de relations avec les idées, les objets, les habitudes du mort. Elle est un nouvel arrangement du monde. Rien n’a changé en apparence, mais tout a changé. Les pages du livre sont les mêmes, mais non le sens du livre. Il nous faut, pour ressentir la mort, imaginer les heures où nous avons besoin du mort. Alors il manque. Imaginer les heures où il eût eu besoin de nous. Mais il n’a plus besoin de nous. Imaginer l’heure de la visite amicale. Et la découvrir creuse. Il nous faut voir la vie en perspective. Mais il n’est point de perspective ni d’espace, le jour où l’on enterre. Le mort est encore en morceaux. Le jour où l’on enterre, nous nous dispersons en piétinements, en mains d’amis vrais ou faux à serrer, en préoccupations matérielles. Le mort mourra demain seulement, dans le silence. Il se montrera à nous dans sa plénitude, pour s’arracher, dans sa plénitude, à notre substance. Alors nous crierons à cause de celui-là qui s’en va, et que nous ne pouvons retenir.
Je n’aime pas les images d’Épinal de la guerre. Le rude guerrier y écrase une larme, et dissimule son émotion sous des boutades bourrues. C’est faux. Le rude guerrier ne dissimule rien. S’il lâche une boutade, c’est qu’il pense une boutade.
La qualité de l’homme n’est point en cause. Le Commandant Alias est parfaitement sensible. Si nous ne rentrons pas il en souffrira plus, peut-être, qu’un autre. À condition qu’il s’agisse de nous et non d’une somme de détails divers. À condition que cette reconstruction lui soit permise par le silence. Car si, cette nuit, l’huissier qui nous poursuit contraint encore le Groupe à déménager, une roue de camion en panne, dans l’avalanche des problèmes, fera reporter à plus tard notre mort. Et Alias oubliera d’en souffrir.
Ainsi, moi qui pars en mission, je ne pense pas lutte de l’Occident contre le Nazisme. Je pense détails immédiats. Je songe à l’absurde d’un survol d’Arras à sept cents mètres. À la vanité des renseignements souhaités de nous. À la lenteur de l’habillage qui m’apparaît comme une toilette pour le bourreau. Et puis à mes gants. Où diable trouverai-je des gants ? J’ai perdu mes gants.
Je ne vois plus la cathédrale que j’habite.
Je m’habille pour le service d’un dieu mort.
— Dépêche-toi… Où sont mes gants ?… Non… Ce ne sont pas ceux-là… cherche-les dans mon sac…
— Les trouve pas, mon Capitaine.
— Tu es un imbécile.
Ils sont tous des imbéciles. Celui qui ne sait pas trouver mes gants. Et l’autre, de l’État-Major, avec son idée fixe de mission à basse altitude.
— Je t’ai demandé un crayon. Voilà dix minutes que je t’ai demandé un crayon… Tu n’as pas de crayon ?
— Si, mon Capitaine.
En voilà un qui est intelligent.
— Pends-moi ce crayon à une ficelle. Et accroche-moi cette ficelle à cette boutonnière-ci… Dites donc, le mitrailleur, vous n’avez pas l’air de vous presser…
— C’est que je suis prêt, mon Capitaine.
— Ah ! Bon.
Et l’observateur, je bifurque vers lui :
— Ça va, Dutertre ? Manque rien ? Vous avez calculé les caps ?
— J’ai les caps, mon Capitaine…
Bon. Il a les caps. Une mission sacrifiée… Je vous demande un peu s’il est censé de sacrifier un équipage pour des renseignements dont personne n’a besoin et qui, si l’un de nous est encore en vie pour les rapporter, ne seront jamais transmis à personne…
— Ils devraient engager des spirites, à l’État-Major…
— Pourquoi ?
— Pour que nous puissions les leur communiquer ce soir, sur table tournante, leurs renseignements.
Je ne suis pas très fier de ma boutade, mais je ronchonne encore :
— Les États-Majors, les États-Majors, qu’ils aillent les faire, les missions sacrifiées, les États-Majors !
Car il est long le cérémonial de l’habillage, quand la mission apparaît comme désespérée, et que l’on se harnache avec tant de soin pour griller vif. Il est laborieux de revêtir cette triple épaisseur de vêtements superposés, de s’affubler du magasin d’accessoires que l’on porte comme un brocanteur, d’organiser le circuit d’oxygène, le circuit de chauffage, le circuit de communications téléphoniques entre membres de l’équipage. La respiration, je la prends dans ce masque. Un tube en caoutchouc me relie à l’avion, tout aussi essentiel que le cordon ombilical. L’avion entre en circuit dans la température de mon sang. L’avion entre en circuit dans mes communications humaines. On m’a ajouté des organes qui s’interposent, en quelque sorte, entre moi et mon cœur. De minute en minute je deviens plus lourd, plus encombrant, plus difficile à manier. Je vire d’un bloc et, si je penche pour serrer des courroies ou tirer sur des fermetures qui résistent, toutes mes jointures crient. Mes vieilles fractures me font mal.
— Passe-moi un autre casque. Je t’ai déjà dit vingt-cinq fois que je ne voulais plus du mien. Il est trop juste.
Car, Dieu sait par quel mystère, le crâne enfle à haute altitude. Et un casque normal au sol presse les os, comme un étau, à dix mille mètres.
— Mais votre casque, c’est un autre, mon Capitaine. Je l’ai changé…
— Ah ! Bon.
Car je ronchonne absolument, mais sans aucun remords. J’ai bien raison ! Tout cela d’ailleurs n’a point d’importance. On traverse, à cet instant-là, le centre même de ce désert intérieur dont je parlais. Il n’est, ici, que des débris. Je n’éprouve même pas de honte à souhaiter le miracle qui changera le cours de cet après-midi. La panne de laryngophone par exemple. C’est toujours en panne, les laryngophones ! De la pacotille ! Ça sauverait notre mission d’être sacrifiée, une panne de laryngophone…
Le Capitaine Vezin m’aborde d’un air sombre. Le Capitaine Vezin aborde chacun de nous, avant le départ en mission, d’un air sombre. Le Capitaine Vezin est chargé, chez nous, des relations avec les organismes de guet des avions ennemis. Il a pour rôle de nous renseigner sur leurs mouvements. Vezin est un ami que j’aime tendrement, mais un prophète de malheur. Je regrette de l’apercevoir.
— Mon vieux, me dit Vezin, c’est embêtant, c’est embêtant, c’est embêtant !
Et il tire des papiers de sa poche. Puis me regardant, soupçonneux :
— Par où sors-tu ?
— Par Albert.
— C’est bien ça. C’est bien ça. Ah, c’est embêtant !
— Ne fais pas l’idiot ; qu’y a-t-il ?
— Tu ne peux pas partir !
Je ne peux pas partir !… Il est bien bon, Vezin ! Qu’il obtienne de Dieu le Père une panne de laryngophone !
— Tu ne peux pas passer.
— Pourquoi ne puis-je pas passer ?
— Parce qu’il y a trois missions de chasse allemande qui se relaient en permanence au-dessus d’Albert. L’une à six mille mètres, l’autre à sept mille cinq, l’autre à dix mille. Aucune ne quitte le ciel avant l’arrivée des remplaçants. Ils font de l’interdiction à priori. Tu vas te jeter dans un filet. Et puis, tiens, regarde !…
Et il me montre un papier, sur lequel il a griffonné des démonstrations incompréhensibles.
Il ferait mieux, Vezin, de me foutre la paix. Les mots « interdiction à priori » m’ont impressionné. Je songe aux lumières rouges et aux contraventions. Mais la contravention, ici, c’est la mort. Je déteste surtout « à priori ». J’ai l’impression d’être personnellement visé.
Читать дальше