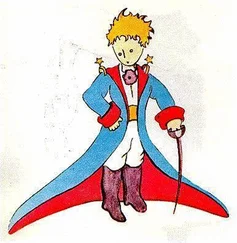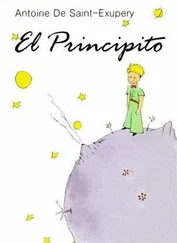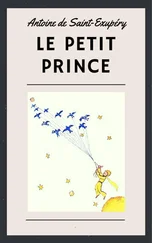Pour le moment je suis tout semblable au chrétien que la grâce a abandonné. Je jouerai mon rôle, avec Dutertre, honnêtement, cela est certain, mais comme l’on sauve des rites lorsqu’ils n’ont plus de contenu. Quand le dieu s’en est retiré. J’attendrai la nuit, si je puis vivre encore, pour m’en aller un peu à pied sur la grand’route qui traverse notre village, enveloppé dans ma solitude bien-aimée, afin d’y reconnaître pourquoi je dois mourir.
Je me réveille de mon rêve. Le Commandant me surprend par une proposition étrange :
— Si ça vous ennuie trop, cette mission… si vous ne vous sentez pas en forme, je peux…
— Voyons, mon Commandant !
Le Commandant sait bien qu’une telle proposition est absurde. Mais, quand un équipage ne rentre pas, on se souvient de la gravité des visages, à l’heure du départ. On interprète cette gravité comme le signe d’un pressentiment. On s’accuse de l’avoir négligée.
Le scrupule du Commandant me fait souvenir d’Israël. Je fumais, avant-hier, à la fenêtre de la Salle des Renseignements. Israël, quand je l’aperçus de ma fenêtre, marchait rapidement. Il avait le nez rouge. Un grand nez bien juif et bien rouge. J’ai été brusquement frappé par le nez rouge d’Israël.
Cet Israël, dont je considérais le nez, j’avais pour lui une amitié profonde. C’était l’un des plus courageux camarades pilotes du Groupe. L’un des plus courageux et l’un des plus modestes. On lui avait tellement parlé de la prudence juive que, son courage, il devait le prendre pour de la prudence. Il est prudent d’être vainqueur.
Donc, je remarquai son grand nez rouge, lequel ne brilla qu’un instant, vu la rapidité des pas qui emportaient Israël et son nez. Sans vouloir plaisanter, je me retournai vers Gavoille :
— Pourquoi fait-il un nez comme ça ?
— Sa mère le lui a fait, répondit Gavoille.
Mais il ajouta :
— Drôle de mission à basse altitude. Il part.
— Ah !
Et, bien sûr, je me suis rappelé, le soir, lorsque nous eûmes cessé d’attendre le retour d’Israël, ce nez qui, planté dans un visage totalement impassible, exprimait avec une sorte de génie, à lui seul, la plus lourde des préoccupations. Si j’avais eu à commander le départ d’Israël, l’image de ce nez m’eût hanté longtemps comme un reproche. Israël, certes, n’avait rien répondu à l’ordre de départ, sinon : « Oui mon Commandant. Bien mon Commandant. Entendu mon Commandant. » Israël, certes, n’avait pas tressailli d’un seul des muscles de son visage. Mais, doucement, insidieusement, traîtreusement, le nez s’était allumé. Israël contrôlait les traits de son visage, mais non la couleur de son nez. Et le nez en avait abusé pour se manifester, à son compte, dans le silence. Le nez, à l’insu d’Israël, avait exprimé au Commandant sa forte désapprobation.
C’est peut-être pourquoi le Commandant n’aime point faire partir ceux qu’il imagine accablés de pressentiments. Les pressentiments trompent presque toujours, mais font rendre aux ordres de guerre un son de condamnation. Alias est un chef, non un juge.
Ainsi, l’autre jour, à propos de l’adjudant T.
Autant Israël était courageux, autant T. était accessible à la peur. C’est le seul homme que j’aie connu qui éprouvât réellement la peur. Quand on donnait à T. un ordre de guerre, on déclenchait en lui une bizarre ascension de vertige. C’était quelque chose de simple, d’inexorable et de lent. T. se raidissait lentement des pieds vers la tête. Son visage était comme lavé de toute expression. Et les yeux commençaient de luire.
Contrairement à Israël, dont le nez m’avait paru tellement penaud, penaud de la mort probable d’Israël, en même temps que tout irrité, T. ne formait point de mouvements intérieurs. Il ne réagissait pas : il muait. Quand on avait achevé de parler à T., on découvrait que l’on avait simplement en lui allumé l’angoisse. L’angoisse commençait de répandre sur son visage une sorte de clarté égale. T., dès lors, était comme hors d’atteinte. On sentait s’élargir, entre l’univers et lui, un désert d’indifférence. Jamais ailleurs, chez nul au monde, je n’ai connu cette forme d’extase.
— Je n’aurais jamais dû le laisser partir ce jour-là, disait plus tard le Commandant.
Ce jour-là, quand le Commandant avait annoncé son départ à T., celui-ci, non seulement avait pâli, mais il avait commencé de sourire. Simplement de sourire. Ainsi font peut-être les suppliciés quand le bourreau, vraiment, dépasse les bornes.
— Vous n’êtes pas bien. Je vous remplace…
— Non, mon Commandant. Puisque c’est mon tour, c’est mon tour.
Et T., au garde à vous devant le Commandant, le regardait tout droit, sans un mouvement.
— Mais si vous ne vous sentez pas sûr de vous…
— C’est mon tour, mon Commandant, c’est mon tour.
— Voyons T…
— Mon Commandant…
L’homme était semblable à un bloc.
Et Alias :
— Alors je l’ai laissé partir.
Ce qui suivit ne reçut jamais d’explication. T., mitrailleur à bord de l’appareil, subit une tentative d’attaque de la part d’un chasseur ennemi. Mais le chasseur, ses mitrailleuses s’étant enrayées, fit demi-tour. Le pilote et T. se parlèrent entre eux jusqu’aux environs du terrain de base, sans que le pilote remarquât rien d’anormal. Mais à cinq minutes de l’arrivée, il n’obtint plus de réponse.
Et l’on retrouva T., dans la soirée, le crâne brisé par l’empennage de l’avion. Il avait sauté en parachute dans des conditions désastreuses, en pleine vitesse, et cela en territoire ami, alors qu’aucun danger ne le menaçait plus. Le passage du chasseur avait joué comme un appel irrésistible.
— Allez vous habiller, nous dit le Commandant, et soyez en l’air à cinq heures trente.
— Au revoir, mon Commandant.
Le Commandant répond par un geste vague. Superstition ? Comme ma cigarette est éteinte, et qu’en vain je fouille mes poches :
— Pourquoi n’avez-vous jamais d’allumettes ?
Ça, c’est exact. Et je franchis la porte sur cet adieu, en me demandant : Pourquoi n’ai-je jamais d’allumettes ?
— La mission l’ennuie, remarque Dutertre.
Moi je pense : il s’en fout ! Mais ce n’est pas à Alias que je songe en formant cette injuste boutade. Je suis choqué par une évidence que nul n’avoue : la vie de l’Esprit est intermittente. La vie de l’Intelligence, elle seule, est permanente, ou à peu près. Il y a peu de variations dans mes facultés d’analyse. Mais l’Esprit ne considère point les objets, il considère le sens qui les noue entre eux. Le visage qui est lu au travers. Et l’Esprit passe de la pleine vision à la cécité absolue. Celui qui aime son domaine, vient l’heure où il n’y découvre plus qu’assemblage d’objets disparates. Celui qui aime sa femme, vient l’heure où il ne voit dans l’amour que soucis, contrariétés et contraintes. Celui qui goûtait telle musique, vient l’heure où il n’en reçoit rien. Vient l’heure, comme maintenant, où je ne comprends plus mon pays. Un pays n’est pas la somme de contrées, de coutumes, de matériaux, que mon intelligence peut toujours saisir. C’est un Être. Et vient l’heure où je me découvre aveugle aux Êtres.
Le Commandant Alias a passé la nuit chez le Général à discuter logique pure. Ça ruine la vie de l’Esprit, la logique pure. Puis il s’est épuisé, sur la route, contre d’interminables embouteillages. Puis il a trouvé, en rentrant au Groupe, cent difficultés matérielles, de celles qui vous rongent peu à peu comme les mille effets d’un glissement de montagne que l’on ne saurait contenir. Il nous a enfin convoqués pour nous lancer dans une mission impossible. Nous sommes des objets de l’incohérence générale. Nous ne sommes pas, pour lui, Saint Exupéry ou Dutertre, doués d’un mode particulier de voir les choses ou de ne pas les voir, de penser, de marcher, de boire, de sourire. Nous sommes des morceaux d’une grande construction dont il faut plus de temps, plus de silence et plus de recul pour découvrir l’assemblage. Si j’étais affligé d’un tic, Alias ne remarquerait plus que le tic. Il n’expédierait plus, sur Arras, que l’image d’un tic. Dans le cafouillis des problèmes posés, dans l’éboulement, nous sommes nous-mêmes divisés en morceaux. Cette voix. Ce nez. Ce tic. Et les morceaux n’émeuvent pas.
Читать дальше