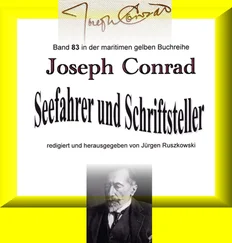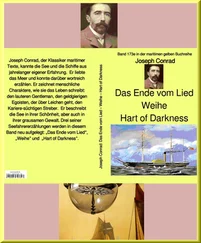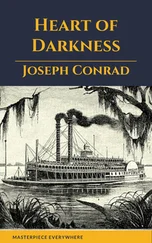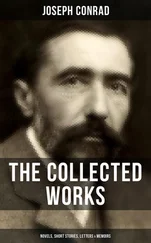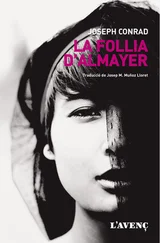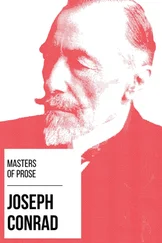– C’est ce que vous avez fait de plus adroit. Vous saviez ce que vous faisiez.
– Vous revoilà en train d’insinuer je ne sais quelle malversation, comme cet homme à grosses épaulettes du bureau de la Marine qui avait l’air de vouloir me faire arrêter simplement parce que j’avais ramené une prise, depuis l’océan Indien, à huit mille milles d’ici, en échappant à tous les navires anglais que j’avais rencontrés, ce qu’il n’aurait probablement pas su faire. J’ai mon brevet de canonnier, signé par le citoyen Renaud, chef d’escadre. On ne me l’a pas donné pour m’être tourné les pouces ou m’être caché dans la cale à filin quand l’ennemi était là. Il y avait à bord de nos navires des patriotes qui ne trouvaient pas cette sorte de chose au-dessous d’eux, je puis vous l’assurer. Mais, république ou pas république, ce n’est vraisemblablement pas des gens de ce genre qui obtenaient un brevet de canonnier.
– C’est bon», dit Réal, les yeux fixés sur le navire anglais qui était maintenant cap au nord.
«Regardez, on dirait qu’il a enfin perdu son erre», fit-il observer, en manière de parenthèse, à Peyrol qui, aussitôt, regarda de ce côté et fit un signe d’assentiment. «C’est bon. Mais on sait que, une fois à terre, vous vous êtes mis rapidement au mieux avec une bande de patriotes. Chefs de section, terroristes…
– Ma foi oui… Je voulais voir ce qu’ils avaient à dire. Ils parlaient comme un équipage de loustics en ribote qui ont pillé un navire. Mais en tout cas, ils ne ressemblaient pas à ceux qui ont vendu le port aux Anglais. Ceux-là étaient des marins d’eau douce, assoiffés de sang. Je suis sorti de la ville aussitôt que je l’ai pu. Je me suis souvenu que j’étais né par ici. Je ne connaissais aucun autre coin de France et je n’avais pas envie d’aller plus loin. Personne n’est venu me chercher.
– Non, pas ici. Je pense qu’on a trouvé que c’était trop près. On vous a recherché pendant quelque temps mais on y a renoncé. Si l’on avait persévéré et fait de vous un amiral, peut-être que nous n’aurions pas été battus à Aboukir [55].»
En entendant prononcer ce nom, Peyrol montra le poing au ciel serein de la Méditerranée. «Et pourtant, nous valions bien les Anglais, s’écria-t-il, et il n’y a pas au monde de navires comme les nôtres. Voyez-vous, lieutenant, le dieu républicain de tous ces bavards ne nous donnerait jamais, à nous autres marins, l’occasion d’un combat loyal.»
Le lieutenant se retourna avec surprise: «Que savez-vous d’un dieu républicain? demanda-t-il. Que diable voulez-vous dire?
– J’ai entendu parler de dieux et j’ai vu des dieux en plus grand nombre que vous n’en pourriez jamais rêver pendant une longue nuit de sommeil; aux quatre coins de la terre, au cœur même des forêts, ce qui est une chose inconcevable. Des figures, des pierres, des bâtons, il doit y avoir quelque chose dans cette idée… Ce que je voulais dire», continua-t-il d’un ton irrité, «c’est que leur dieu républicain, qui n’est fait ni de bois, ni de pierre, et qui me parait ressembler à une espèce de terrien, ne nous a jamais donné, à nous autres marins, un chef comme celui que nos soldats ont à terre.»
Le lieutenant Réal considéra Peyrol avec une grave attention, puis déclara tranquillement: «Eh bien! le dieu des aristocrates revient et je crois bien qu’il nous ramène un empereur avec lui. Vous avez entendu parler un peu de cela, vous autres, dans cette ferme, n’est-ce pas?
– Non, dit Peyrol, je n’ai jamais entendu parler d’un empereur. Mais qu’est-ce que cela peut faire? Sous n’importe quel nom, un chef ne peut être plus qu’un chef, et ce général qu’ils ont nommé consul est un bon chef, personne ne peut dire le contraire.»
Après avoir prononcé ces mots d’un ton dogmatique, Peyrol leva la tête vers le soleil et suggéra qu’il était temps de redescendre à la ferme «pour manger la soupe». Le visage de Réal s’assombrit aussitôt, mais il se mit en route suivi de Peyrol. Au premier détour du sentier, ils découvrirent en contrebas les bâtiments d’Escampobar avec les pigeons arpentant toujours le faîte des toits, les vergers ensoleillés, les cours où il n’y avait âme qui vive. Peyrol remarqua qu’ils étaient probablement tous dans la cuisine à attendre son retour et celui du lieutenant. Quant à lui, il mourait de faim. «Et vous, lieutenant?»
Le lieutenant n’avait pas faim. En entendant cette déclaration faite d’un ton bourru, Peyrol hocha la tête d’un air sagace derrière le dos du lieutenant. Ma foi! quoi qu’il arrive il faut bien qu’un homme mange. Lui, Peyrol, savait ce que c’était de n’avoir absolument rien à se mettre sous la dent. Mais c’est déjà peu, très peu, que des demi rations pour quelqu’un qui a à travailler ou à combattre. Pour sa part, il ne pouvait imaginer une circonstance capable de l’empêcher de faire un repas aussi longtemps qu’il y aurait moyen d’attraper un morceau à manger.
Sa loquacité inaccoutumée ne provoqua aucune réponse, mais Peyrol continuait sur le même ton comme s’il ne pensait absolument qu’à la nourriture, tout en laissant ses regards errer à droite et à gauche et en prêtant l’oreille au moindre bruit. Une fois devant la maison, Peyrol s’arrêta pour jeter un regard inquiet vers le sentier qui descendait au rivage et laissa le lieutenant entrer dans le café. La Méditerranée, dans la partie que l’on découvrait de la porte du café, était aussi vide de voiles qu’une mer encore inexplorée. Le tintement triste d’une cloche fêlée, au cou de quelque vache errante, fut le seul bruit qu’il entendit, ce qui accentuait la paix dominicale de la ferme. Deux chèvres étaient couchées sur le penchant occidental de la colline. Tout cela avait un aspect très rassurant et l’expression anxieuse se dissipait sur le visage de Peyrol quand, soudain, l’une des chèvres bondit sur ses pieds. Le forban tressaillit et prit une posture rigide, comme sous l’effet d’une vive appréhension. Un homme, dans un état d’esprit à tressaillir parce qu’une chèvre fait un bond, ne peut pas être très heureux. L’autre chèvre cependant restait étendue. Il n’y avait réellement aucune raison d’alarme, et Peyrol, composant son visage pour lui donner autant que possible son expression de placidité habituelle, suivit le lieutenant dans la maison.
On n’avait mis dans la salle qu’un seul couvert [56]au bout d’une longue table pour le lieutenant. C’est là qu’il prenait ses repas, tandis que les autres prenaient le leur dans la cuisine: rassemblement habituel, étrangement assorti, que servait Catherine, inquiète et silencieuse. Peyrol, soucieux et affamé, faisait face au citoyen Scevola en habit de travail et très absorbé. Scevola avait l’air plus fiévreux que d’ordinaire, et au-dessus de sa barbe drue, les taches rouges de ses pommettes étaient très marquées. De temps à autre, la maîtresse de la ferme se levait de sa place, près du vieux Peyrol, et allait dans la salle servir le lieutenant. Les trois autres convives semblaient ne point prêter attention à ses absences. Vers la fin du repas, Peyrol, appuyé au dossier de sa chaise de bois, laissa son regard se poser sur l’ex-terroriste qui n’avait pas encore achevé son repas et qui s’activait encore au-dessus de son assiette, de l’air d’un homme qui a beaucoup travaillé toute la matinée. La porte de communication entre la salle et la cuisine était grande ouverte, mais aucun bruit de voix ne parvenait jamais de l’autre pièce.
Jusqu’à ces temps derniers, Peyrol ne s’était guère inquiété de l’état d’esprit de ceux avec qui il vivait. Maintenant, au contraire, il se demandait quelles pouvaient bien être les pensées de ce patriote ex-terroriste, de cet être sanguinaire et extrêmement pauvre qui jouait le rôle de patron de la ferme d’Escampobar. Mais lorsque le citoyen Scevola leva enfin la tête pour prendre une longue gorgée de vin, rien d’imprévu n’apparut sur ce visage auquel ses vives couleurs donnaient une telle ressemblance avec un masque peint. Leurs regards se croisèrent.
Читать дальше