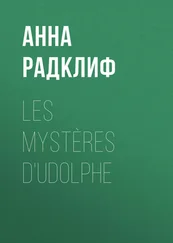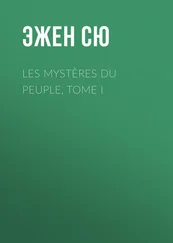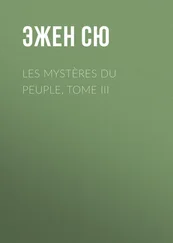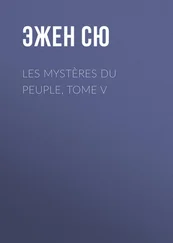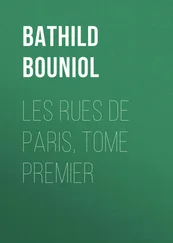– Car nous revenons par la prairie, n’est-ce pas, monsieur Rodolphe?
– Sans doute: il y a un pont de bois sur la rivière. Au retour, il est, ma foi, bien six ou sept heures: dans ce temps-ci un bon feu bien gai flambe dans la grande cuisine de la ferme; vous allez vous y réchauffer et causer un moment avec les braves gens qui soupent en rentrant du labour. Ensuite vous dînez avec votre tante. Quelquefois le curé ou un des vieux amis de la maison se met à table avec vous. Après cela, vous lisez ou vous travaillez pendant que votre tante fait sa partie de cartes. À dix heures, elle vous baise au front, vous remontez chez vous: et le lendemain matin c’est à recommencer…
– On vivrait cent ans comme cela, monsieur Rodolphe, sans penser à s’ennuyer un moment…
– Mais cela n’est rien. Et les dimanches! Et les jours de fêtes!
– Ces jours-là, monsieur Rodolphe?
– Vous vous faites belle, vous mettez une jolie robe à la paysanne, avec ça de charmants bonnets ronds qui vous vont à ravir; vous montez en carriole d’osier avec votre tante et Jacques, le garçon de ferme, pour aller à la grand-messe du village; après, dans l’été, vous ne manquez pas d’assister, avec votre tante, à toutes les fêtes des paroisses voisines. Vous êtes si gentille, si douce, si bonne ménagère, votre tante vous aime tant, le curé rend de vous un si bon témoignage, que tous les jeunes fermiers des environs veulent vous faire danser, parce que c’est comme cela que commencent toujours les mariages… Aussi, peu à peu vous en remarquez un… et…
Rodolphe, étonné du silence de la Goualeuse, la regarda.
La malheureuse fille étouffait à grand-peine ses sanglots.
Un moment abusée par les paroles de Rodolphe, elle avait oublié le présent, et le contraste de ce présent avec le rêve d’une existence douce et riante lui rappelait l’horreur de sa position.
– Fleur-de-Marie, qu’avez-vous?
– Ah! monsieur Rodolphe, sans le vouloir, vous m’avez fait bien du chagrin… j’ai cru un instant à ce paradis…
– Mais, pauvre enfant, ce paradis existe… tenez, regardez… Cocher, arrête!
La voiture s’arrêta.
La Goualeuse releva machinalement la tête. Elle se trouvait au sommet d’une petite colline. Quel fut son étonnement, sa stupeur! Le joli village bâti à mi-côte, la ferme, la prairie, les belles vaches, la petite rivière, la châtaigneraie, l’église dans le lointain, le tableau était sous ses yeux… rien n’y manquait, jusqu’à Musette, belle génisse blanche, future favorite de la Goualeuse.
Ce charmant paysage était éclairé par un beau soleil de novembre… Les feuilles jaunes et pourpres des châtaigniers les couvraient encore et se découpaient sur l’azur du ciel.
– Eh bien! Fleur-de-Marie, que dites-vous? Suis-je bon peintre? dit Rodolphe en souriant.
La Goualeuse le regardait avec une surprise mêlée d’inquiétude. Cela lui semblait presque surnaturel.
– Comment se fait-il, monsieur Rodolphe?… Mais, mon Dieu, est-ce un rêve? Ça me fait presque peur… Comment! ce que vous m’avez dit…
– Rien de plus simple, mon enfant… La fermière est ma nourrice, j’ai été élevé ici… Je lui ai écrit ce matin de très-bonne heure que je viendrais la voir: je peignais d’après nature.
– Ah! c’est vrai, monsieur Rodolphe! dit la Goualeuse avec un profond soupir.
La ferme où Rodolphe conduisait Fleur-de-Marie était située en dehors et à l’extrémité du village de Bouqueval, petite paroisse solitaire, ignorée, enfoncée dans les terres, et éloignée d’Écouen d’environ deux lieues.
Le fiacre, suivant les indications de Rodolphe, descendit un chemin rapide et entra dans une longue avenue bordée de cerisiers et de pommiers.
La voiture roulait sans bruit sur un tapis de ce gazon fin et ras dont la plupart des routes vicinales sont ordinairement couvertes.
Fleur-de-Marie, silencieuse, triste, restait, malgré ses efforts, sous une impression douloureuse, que Rodolphe se reprochait presque d’avoir causée.
Au bout de quelques minutes, la voiture passa devant la grande porte de la cour de la ferme, continua son chemin le long d’une épaisse charmille et s’arrêta en face d’un petit porche de bois rustique à demi caché sous un vigoureux cep de vigne aux feuilles empourprées par l’automne.
– Nous voici arrivés, Fleur-de-Marie, dit Rodolphe, êtes-vous contente?
– Oui, monsieur Rodolphe… pourtant il me semble à présent que je vais avoir honte devant la fermière; je n’oserai jamais la regarder…
– Pourquoi cela, mon enfant?
– Vous avez raison, monsieur Rodolphe, elle ne me connaît pas. Et la Goualeuse étouffa un soupir.
On avait sans doute guetté l’arrivée du fiacre de Rodolphe.
Le cocher ouvrait la portière, lorsqu’une femme de cinquante ans environ, vêtue comme le sont les riches fermières des environs de Paris, ayant une physionomie à la fois triste et douce, parut sous le porche et s’avança au-devant de Rodolphe avec un respectueux empressement.
La Goualeuse devint pourpre et descendit de voiture après un moment d’hésitation…
– Bonjour, ma bonne madame Georges…, dit Rodolphe à la fermière; vous le voyez, je suis exact…
Puis, se retournant vers le cocher et lui mettant de l’argent dans la main:
– Tu peux t’en retourner à Paris.
Le cocher, petit homme trapu, avait son chapeau enfoncé sur les yeux et la figure presque entièrement cachée par le collet fourré de son carrick: il empocha l’argent, ne répondit rien, remonta sur son siège, fouetta son cheval et disparut rapidement dans l’allée verte.
– Après une si longue course, ce cocher muet est bien pressé de s’en aller…, pensa d’abord Rodolphe. Bah! il n’est que deux heures; il veut être assez tôt de retour à Paris pour pouvoir utiliser le restant de sa journée.
Et Rodolphe n’attacha aucune importance à sa première observation.
Fleur-de-Marie s’approcha de lui, l’air inquiet, troublé, presque alarmé, et lui dit tout bas, de manière à ne pas être entendue de M meGeorges:
– Mon Dieu! monsieur Rodolphe, pardon… Vous renvoyez la voiture… Mais l’ogresse, hélas!… Il faut que je retourne chez elle ce soir… sinon… elle me regardera comme une voleuse… Mes habits lui appartiennent… et je lui dois…
– Rassurez-vous, mon enfant, c’est à moi à vous demander pardon.
– Pardon! et de quoi?
– De ne pas vous avoir dit plus tôt que vous ne deviez plus rien à l’ogresse, et que vous pouviez quitter ces ignobles vêtements pour d’autres que ma bonne M meGeorges va vous donner. Elle en a à peu près de votre taille, elle voudra bien vous prêter de quoi vous habiller. Vous le voyez, elle commence déjà son rôle de tante.
Fleur-de-Marie croyait rêver; elle regardait tour à tour la fermière et Rodolphe, ne pouvant croire à ce qu’elle entendait.
– Comment, dit-elle la voix palpitante d’émotion, je ne retournerai plus à Paris? je pourrai rester ici? Madame me le permettra?… ce serait possible, ce château en Espagne de tantôt?
– C’était cette ferme… le voilà réalisé.
– Non, non, ce serait trop beau, trop heureux.
– On n’a jamais trop de bonheur, Fleur-de-Marie.
– Ah! par pitié, monsieur Rodolphe, ne me trompez pas, cela me ferait bien mal.
– Ma chère enfant, croyez-moi, dit Rodolphe d’une voix toujours affectueuse, mais avec un accent de dignité que Fleur-de-Marie ne lui connaissait pas encore; oui, vous pouvez, si cela vous convient, mener dès aujourd’hui, auprès de M meGeorges, cette vie paisible dont tout à l’heure le tableau vous enchantait. Quoique M meGeorges ne soit pas votre tante, elle aura pour vous, lorsqu’elle vous connaîtra, le plus tendre intérêt; vous passerez même pour sa nièce aux yeux des gens de la ferme; ce petit mensonge rendra votre position plus convenable. Encore une fois, si cela vous plaît, Fleur-de-Marie, vous pourrez réaliser votre rêve de tantôt. Dès que vous serez habillée en petite fermière, ajouta-t-il en souriant, nous vous mènerons voir votre future favorite, Musette, jolie génisse blanche qui n’attend plus que le collier que vous lui avez promis. Nous irons aussi donner un coup d’œil à vos amis les pigeons, et puis à la laiterie; nous parcourrons enfin toute la ferme: je tiens à remplir ma promesse.
Читать дальше