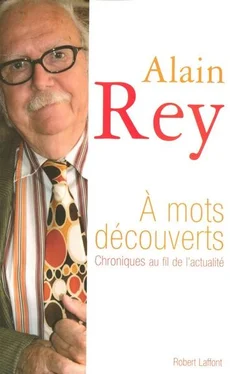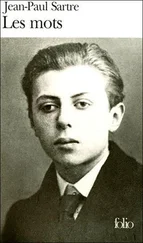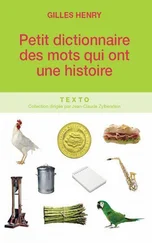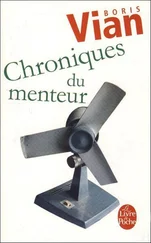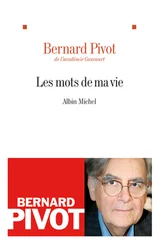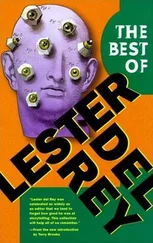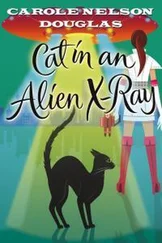Le mot d’aujourd’hui sera une expression que tout le monde connaît et emploie. Comme l’a bien noté un auditeur de Tarbes, qui s’en irrite, l’expression « le pot de terre et le pot de fer », si commode pour rappeler l’inégalité des chances, est citée par « des personnalités plus ou moins célèbres » dans un contexte inexact.
C’est vrai que l’on entend couramment évoquer un combat où le malheureux pot de terre est attaqué et brisé par l’impitoyable pot de fer. Et c’est une évocation qui trahit l’auteur qui est à l’origine de cette expression, La Fontaine. Ce dernier était plus subtil que l’usage qu’on fait de sa trouvaille, car il est banal de noter, dans les rapports humains, que le plus fort écrase le plus faible. Quand le fabuliste expose cette situation, c’est pour rappeler que la force brutale aime à s’orner de justifications et de raisons. Celle du plus fort, constate La Fontaine, est toujours la meilleure, ce qui épingle d’un seul coup toutes les langues de bois et les rhétoriques des tyrans, des dictateurs et de quelques autres détenteurs du pouvoir.
Les pots de terre n’ont qu’à se méfier, car les pots de fer de la fable ne se présentent pas comme des menaces. Pot de terre et pot de fer, gentiment associés, voyagent de conserve, l’un prétendant protéger l’autre. Mais au moindre choc, devinez qui détruit : évidemment, le protecteur dans son armure. Et la moralité s’ensuit : « Ne nous associons — lisez : si-ons — qu’avecque nos égaux. »
On peut appliquer cette mise en garde à la psychologie des ménages et des pacs, aux ententes politiques comme aux associations d’affaires. Il y a toujours un peu plus de fer dans un associé que dans l’autre. Autrement dit : gardez-moi de mes amis, etc.
Avant de parler de pot de terre ou de maître corbeau, rouvrons donc les géniales Fables : cela nous ramènera de l’illusion à l’allusion.
3 octobre 2000
Plusieurs auditrices et quelques auditeurs se préoccupent du vocabulaire d’Internet, qui devient de plus en plus incontournable, comme on dit, mais qui nous asperge d’un franglais indiscret.
L’une des questions qui revient le plus souvent, à côté des e-mails qu’on aime traduire en courriels , à la québécoise, est celle du remplacement possible de start-up . Ces jeunes sociétés avides de profit et qui se développent avec une rapidité impressionnante ont paresseusement conservé dans notre langue si accueillante leur désignation américaine. Nous connaissions déjà quelques mots issus du verbe anglais to start , qui signifie « partir, démarrer », par exemple le starter des automobiles et celui des stades, ou encore la starting gate des champs de courses. Start-up , que vous pouvez toujours prononcer « startupe » pour montrer que vous savez l’écrire, ne veut pas dire grand-chose de précis. Le vocabulaire des affaires et de la finance américaines utilisait le mot bien avant les « nouvelles technologies » et la « nouvelle économie » (qui ne peut être qu’une new economy …) à propos de sociétés pétrolières à développement rapide. Aucune idée de jeunesse ni de croissance, comme dans le gracieux « jeune pousse » que l’Administration française favorise, mais simplement un démarrage rapide.
Il semble que la Bourse suggère aux Français des idées botaniques et jardinières, puisque l’une de mes correspondantes me suggère par une carte postale exotique et charmante le mot turion . Ce latinisme de botaniste existe en effet depuis le XVI e siècle et signifie justement « jeune pousse » ; il est bref, sonore, mais un peu rare et précieux. Il évoque, parmi les végétaux, les bourgeons de ce qui va devenir succulent, l’asperge. Si le ou la start-up — grand inconvénient de l’anglicisme, le genre flottant — est, à son démarrage, un turion, il ou elle pourra devenir une grande asperge, ce qui n’est pas forcément la gloire. Décidément, ce turion latin serait plus goûteux et plus ironique que la banale start-up franglaise.
4 octobre 2000
Le mot ultimatum résonne assez sinistrement aux oreilles européennes. C’est avec un ultimatum adressé par l’Autriche à la Serbie que commença la guerre de 1914. Avec le recul, le contenu de cet ultimatum nous paraît léger : la requête autrichienne de participer, à Belgrade, à l’enquête sur l’attentat de Sarajevo, où l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche venait d’être assassiné. Sur le refus de la Serbie, l’Autriche lui déclara la guerre et la machine infernale se mit en marche.
L’histoire nous apprend donc qu’un ultimatum peut être un prétexte ou une affaire symbolique. Ehud Barak somme Yasser Arafat d’accomplir une mission impossible : arrêter dans l’heure la violence créée par des années de conflit ouvert ou larvé. Sinon, représailles.
Pourtant, rien ne dit « menace », dans le mot ultimatum . Au Moyen Âge, on disait en latin ultimatum consultum , « décision définitive ». Le mot est dérivé de ultimus , « le dernier », ultime , mot apparenté à ultra qui, nous ne le savons que trop, signifie « extrême », ou plutôt « extrémiste ».
Mais l’ultimatum, dernière décision, devint rapidement « décision irrévocable », ce qui, dans un contexte de conflit, a vite tourné à la menace. Moins agressif en apparence, ultimatum signifie cependant : « Si, après tel bref délai, tu ne me cèdes pas, je cogne. » Voilà ce qu’est devenu, en français, ce mot latin, au tournant du XIX e siècle. Un certain Napoléon, puis quelques souverains coalisés contre lui y sont pour quelque chose. Enfin, ce qui est ultime peut devenir atroce : il faut se souvenir du sens qu’avait pris dans l’Allemagne nazie l’expression que nous traduisons par solution finale .
L’ultimatum va du plus fort vers le plus faible, sinon il est dérisoire. C’est ce qui le rend, dans tous les cas, si déplaisant. On ne parlera pas d’ultimatum à propos de la demande pressante des familles des morts du Concorde écrasé pour obtenir une proposition d’Air France : là, au moins, pas de menace militaire. Parfois, l’usage dominant du mot rejoint le calembour ; un jour, l’ultime atome pourrait devenir l’arme définitive.
9 octobre 2000
Le prolongement de l’ultimatum israélien adressé à Yasser Arafat représente non seulement un sursis, mais un répit, un soulagement.
Des répits, on en a bien besoin, puisqu’ils représentent un apaisement par rapport à un danger, à une menace. Répit , qui évoque aujourd’hui un apaisement provisoire, un moment de repos et de détente, rime pourtant avec dépit , non par hasard. Le dépit, dans son origine, est un mépris, alors que le répit, qui fut son contraire, est exactement un respect. Deux « regards » (en latin spectum , de spicere , d’où vient spectacle ).
Tandis que le mot latin respectus , qui exprime un regard admiratif et confiant, a été pris tel quel par le français respect , la langue parlée populaire le transformait en respit’ , puis répit . Si l’on considère quelqu’un avec confiance, cela peut apaiser l’inquiétude et supprimer les risques d’agression ; d’où la signification, au départ inattendue, de délai.
Aujourd’hui, il n’y a plus de rapport clair entre respect et répit ; c’est dommage. En effet, les menaces, les chantages correspondent à une absence totale de considération envers l’autre. Les répits ne sont que des détentes dans une situation « tendue » : rien que du temps sans danger, sans agressivité, sans haine. C’est très bien, on en profite, mais passivement.
Читать дальше