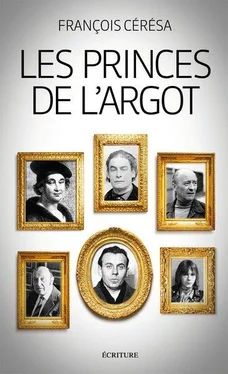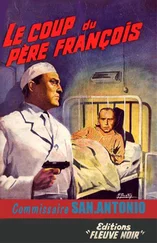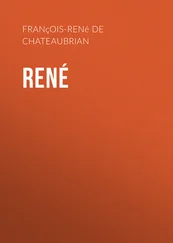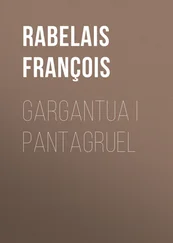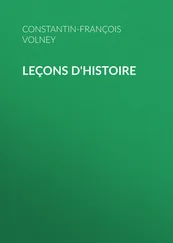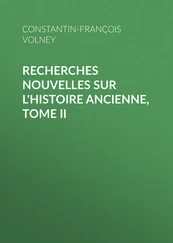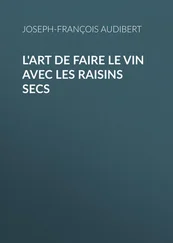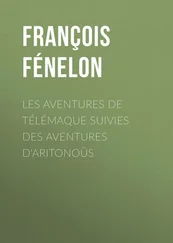La carrière de Le Breton est lancée. Mais le vrai big-bang, le déclic financier, c’est Du rififi chez les hommes . Publié en « Série Noire » chez Gallimard, comme plus tard Razzia sur la chnou et Le rouge est mis . Le Breton est immédiatement consacré vedette du polar à la française. On est en 1953. J’ai du bol, je suis né cette année-là, quand la série Rififi a été lancée. Elle devient l’un des fers de lance des Presses de la Cité. Rififi est une marque déposée. C’est la propriété de son auteur.
✩
Comme Le Trou de José Giovanni [41] Gallimard, « Série Noire », 1957.
mis en scène par Becker, Du rififi chez les hommes devient un film. Réalisé par Jules Dassin, avec Jean Servais (qui faisait le méchant dans L’Homme de Rio ) et Magali Noël (l’égérie pulpeuse des films de Fellini). Succès fulgurant. La patte de Dassin, ce n’est pas de l’anodin. Et là, on est dans le sérieux. On se familiarise avec l’argot des hommes, du Milieu. Pas d’humour. Auguste Le Breton ne sera jamais un rigolo. Dans son livre, c’est direct. Il ne s’embarrasse pas de circonlocutions. Exemple :
Ida ne s’attardait pas sur le clille. Elle encaissait l’oseille, épongeait le branque, et hop ! fonçait remettre le couvert avec un autre.
Il y a pourtant des passages où l’on sourit, plus à cause de l’argot lui-même que de l’action, ce qui prouve que l’argot appartient aussi au domaine du rire, involontaire ou non. Exemple :
Au comptoir, perchées sur des tabourets, deux nanas se laissent pincer les noix par des corniauds en goguette.
Les mots « noix » et « corniauds », associés dans ce contexte, forcent le sourire. L’argot faisant partie du domaine de l’interdit, on ressent une sorte de défoulement jubilatoire lorsque les mots ou les expressions giclent. Auguste Le Breton, qui prétendait avoir inventé le verlan (l’envers), signe des passages dans ce langage aujourd’hui revendiqué par les zarbis de banlieue. Suite du précédent extrait :
L’une d’elles jeta un coup de sabord sur une équipe de mirontons qui venaient de soulever la tenture bleue de l’entrée et murmura à sa pote :
— Te détronche pas, Lily, la Mondaine…
Pour que les caves qui les serraient de trop près n’entravent pas, elle ajouta en verlan :
— Qu’est-ce qu’ils viennent tréfou les draupers à cette heure-ci ? Pourvu qu’ils fassent pas une flera. Ça serait le quetbou : j’ai pas encore gnéga une thune.
Les temps changent. De nos jours, n’importe quel Raymond pige le verlan. C’est chic, mode, snob. Les bobos se gargarisent tous les matins au verlan. C’est le Synthol de leur rhétorique. L’argot, par contre, c’est coton. Celui qui rouscaille bigorne façon Vidocq, Bruant ou Le Breton fait flanelle. C’est un bouffon. Un cassos, comme on dit maintenant. Les grands argotiers, à l’instar des grands argentiers, ont saisi la manipe. C’est presque une histoire de recyclage. On a beau être piqué, il faut vivre avec son taon !
✩
Dès qu’on a un filon, on ne le lâche plus. Après Du rififi chez les hommes , il y a Du rififi chez les femmes, Du rififi à Tokyo, Du rififi à Paname . Les trois sont adaptés au cinéma. Le dernier est tourné par Denys de La Patellière, avec Alphonse Boudard aux dialogues, Jean Gabin, Mireille Darc et George Raft au générique (eh oui, le gangster mythique de Scarface et de Certains l’aiment chaud !). Hélas, nobody is perfect . Ces suites vieillottes et sans relief n’ont aucun intérêt. On peut dire que c’est aussi le lot de l’argot. Le trop est l’ennemi du bien. Tout un livre en argot tient plus de la curiosité archéologique que du joyau littéraire. On s’ébaubit à la lecture de certaines ballades de Villon, mais de vous à moi, c’est parfois abstrus, souvent lassant. C’est la visite au musée. On consulte certains textes argotiques comme on va voir le trésor de Toutankhamon. Si le côté hiéroglyphe fascine toujours, le côté grand disparu également. On ressent une espèce de sympathie polie et compatissante, pour ne pas dire condescendante, à l’égard d’un genre dinosaurien qui, comme on le disait autrefois, appartient au « cinéma de papa ».
Certains joyaux prennent du carat (de l’âge), d’autres restent intemporels. Auguste Le Breton, malgré Le rouge est mis , mis en scène par Gilles Grangier, avec Jean Gabin et Lino Ventura, Razzia sur la chnouf , un vrai bon polar adapté par Henri Decoin, avec encore Gabin et Ventura, puis l’inaltérable Clan des Siciliens , adapté par Henri Verneuil et José Giovanni, avec Gabin, Ventura, Delon et la musique d’Ennio Morricone, n’est plus en vogue. La vie littéraire est ainsi faite. Certains chefs-d’œuvre ne passent pas à l’écran, certains livres passables deviennent des chefs-d’œuvre. C’est injuste. On se souvient des films — moins des livres.
Le Breton était parfois désuet. Un jour, José Giovanni m’a raconté qu’ils avaient à « causer ». Il était question de cinéma. Giovanni était avec sa femme, Le Breton avec la sienne. À un moment, Le Breton s’est tourné vers les épouses et a dit : « Laissez-nous, on doit parler entre hommes… »
L’écrivain se prenait parfois pour le dur qu’il n’avait jamais été : un côté vieillot, démodé, suranné. L’œuvre de Le Breton pâtit de ce constat : ce n’est pas curieux, ce n’est plus qu’une curiosité. L’argot, qui n’est pas un long fleuve tranquille, doit être une langue vivante, pas une langue morte. L’humour adjacent, le clin d’œil, le jeu de mots, le langage populaire, la pirouette, tout ce qui fait qu’on « pine à la fortune du pot », même si le milieu décrit est la pègre, doivent exister et nourrir le mariage de la carte et du tapin ! Extrait de Razzia sur la chnouf :
C’matin, mon doublard est resté pointé à la barbote ( visite médicale des prostituées ). Une de ses potes m’affranchit. On l’a gardée. Pour des boutons qu’le toubib a dit. À la chagatte ! Tu parles… Comme si ça empêchait la môme d’éponger des michetons.
Extrait de Le rouge est mis :
Lisette n’avait plus son berlingue. Elle l’avait perdu dans les bras d’un jeune gigolpince à moustaches cirées. Ils n’avaient pas tort les barbeaux qui renaudaient contre ces petites connasses ! Elles grillaient les femmes de métier. Après leur turbin, pas rare qu’elles écrèment un micheton pour que dalle.
Cette mode du polar des années 1950-60 a fait florès. Surtout dans le registre sérieux. Quand on parlait l’argot, c’était pour ne pas être compris du patron et des non-affranchis. Quand on écrit trop en argot, on prend le risque de ne pas être compris par le lecteur. L’argot doit faire rire, au même titre que le langage populaire. Le français n’est pas du franglais, il doit conserver des expressions populaires telles que : « Il travaille du chapeau », « J’ai l’os du foie qui me fait mal », « Il a l’air d’un accident de chemin de fer », « Les yeux qui croisent les bras », « Les pieds en bouquet de violettes », « Les yeux bordés d’anchois », « C’est pas le frère à dégueulasse », « Chaque pot a son couvercle », « Il mange avec les chevaux de bois », etc. En matière d’argot, il faut faire comme Boudard et Simonin. Sous couvert de drôlerie ou de digressions appropriées, tantôt ils donnent la signification du mot bizarre, tantôt, du fait même de l’action, ils rendent le mot lumineusement compréhensible. Cela existe même chez Le Breton. Exemple dans Le rouge est mis :
Les petits boulots avaient des roupanes à trois thunes sur le cul, mais ça faisait rien. Girondes qu’elles étaient, dans leurs robes imprimées. Elles frappaient le trottoir de leurs hauts talons et bagotaient vers leurs rencards.
Читать дальше