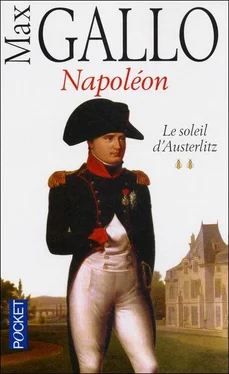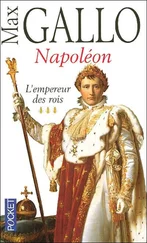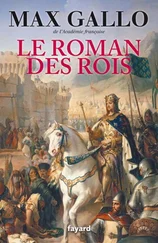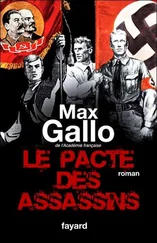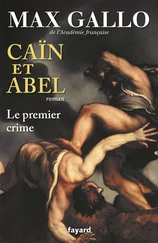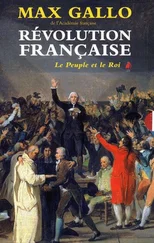En remontant la grande allée, il se dirige vers un obélisque, découvre des ruines romaines. Les quatre chasseurs de l'escorte qui ont mission de le suivre chaque fois qu'il quitte la berline se tiennent en arrière, à plusieurs pas.
Il se trouve au sommet d'une sorte de colline à laquelle on accède par un portique. De là on domine tout le paysage, et au loin il aperçoit, dans la brume sombre, Vienne.
Autrefois, quand il commandait l'armée d'Italie, il avait rêvé de parvenir jusqu'ici. Et voici que, par des routes inattendues, sa vie l'a mené là, à Schönbrunn, dans le Versailles des Habsbourg. Et un des proches de l'Empereur d'Autriche vient de lui proposer d'épouser, comme un Capet, l'archiduchesse.
Qui eût imaginé cela ?
Et pourquoi, après tout, ce mariage serait-il impossible ? Sa vie n'est-elle pas une suite d'événements incroyables et qui pourtant ont eu lieu ?
N'est-il pas l'Empereur ?
Il s'installe dans l'une des grandes chambres du château et, par la fenêtre, il observe la Garde impériale qui prend ses cantonnements. Il donne l'ordre aux grenadiers de préparer leur tenue de parade, puis, quand la nuit est tombée, il part avec sa seule escorte pour Vienne.
La ville est tranquille, mais les fantassins qu'il aperçoit ont l'aspect de vaincus. Ils portent des uniformes de fortune et gardent accrochés à leur ceinture des bouteilles, du pain, des volailles. La Grande Armée est usée par les centaines de kilomètres parcourus. Il faudra la reprendre en main avant la bataille.
Rentré à Schönbrunn, il convoque le général Bessières, afin qu'un défilé de la Garde impériale soit organisé dans Vienne, les jours suivants, dès que la Garde sera prête. Il faut que les Viennois soient impressionnés par la puissance et la discipline de l'armée, et qu'ils oublient les images de soldats en haillons.
Dans sa chambre, il reste longtemps pensif, pendant que Roustam s'affaire, puis il écrit quelques mots à Joséphine :
« Je suis à Vienne depuis deux jours ; je l'ai parcourue la nuit. Demain, je reçois les notables et les corps. Presque toutes mes troupes sont au-delà du Danube, à la poursuite des Russes.
« Adieu, ma Joséphine ; du moment que cela sera possible, je te ferai venir. Mille choses aimables pour toi. »
Il signe en écrasant sa plume si bien que le trait qui souligne « Napoléon » est une longue tache noire irrégulière.
Il étudie les cartes de la région qui s'étend autour de Brünn et au nord de Vienne. Cette succession de plateaux, d'étangs et de vallées étroites permet sur un espace réduit une bataille décisive. Il faut faire vite. Les troupes prussiennes sont en marche. Le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III et la reine Louise ont accueilli avec faste le tsar Alexandre I er. Des espions assurent que, au début du mois de novembre, le 3, les souverains se sont rendus de nuit à Potsdam, qu'ils sont descendus dans le caveau funéraire de Frédéric II et qu'à la lumière des torches ils se sont, sur son cercueil, juré une amitié éternelle.
Ridicule. Que valent les serments des souverains ? Frédéric II et les Russes s'étaient fait une guerre de sept ans ! Que durerait l'amitié de ces rois si la défaite écrasait l'armée russe ?
Je dois vaincre.
Le 16 novembre, Napoléon quitte Schönbrunn. Avant de monter dans la berline, il écrit une nouvelle lettre à Joséphine.
Il faut que l'Impératrice quitte Strasbourg, traverse le Rhin.
« Porte de quoi faire des présents aux dames et aux officiers qui seront de service près de toi. Sois honnête mais reçois tous les hommages : l'on te doit tout et tu ne dois rien que par honnêteté.
« Je serai bien aise de te voir du moment que mes affaires me le permettront. Je pars pour mon avant-garde. Il fait un temps affreux, il neige beaucoup ; du reste toutes mes affaires vont bien.
« Adieu, ma bonne amie. »
Le matin du 17 novembre, il est à Znaïm. Il se promène sous la neige, regarde le paysage qui s'étend en contrebas de la petite ville située sur une hauteur.
Le comte de Thiard arrive en courant, essoufflé, balbutiant. Des officiers autrichiens faits prisonniers ont rapporté que les Anglais ont coulé toute la flotte française de l'amiral Villeneuve, à Trafalgar, non loin de Cadix. La bataille s'est déroulée le 21 octobre. La marine française a perdu treize vaisseaux sur dix-huit. Son alliée, la marine espagnole, neuf sur quinze. Les Anglais ont conservé tous leurs vaisseaux engagés dans le combat. Il n'y a plus de flotte française. L'amiral Villeneuve est prisonnier. Nelson a été tué au cours du combat, à bord de son navire, le Victory .
Napoléon ne pose aucune question. Le 21 octobre, il avait lancé, au lendemain de la victoire d'Ulm, une proclamation à l'armée. C'est comme si le destin voulait, le même jour, marquer qu'il ne lui accorde que la puissance de la terre et lui refuse la domination de la mer.
L'Angleterre, comme il l'avait pressenti, ne sera donc vaincue que par la terre.
Je dois vaincre ici.
Il ne veut pas s'arrêter à cette défaite, qui le rejoint alors qu'il se prépare à la bataille. La défaite est déjà enfouie sous tant de jours, engloutie par cet océan de temps qui s'est écoulé depuis le 21 octobre.
Oublions-la. Il le faut.
Il gagne Pohrlitz, couche au presbytère. Le lendemain, il parcourt en berline puis à cheval les routes de la région. Il met pied à terre, observe un combat de cavalerie, non loin du village de Lattein. Il connaît ce sentiment qui l'habite, fait de tension et de calme. Il regarde ces collines, cette plaine, ces plateaux et ces vallées. Il imagine les troupes se déplaçant ici et là. Il aperçoit des villages et, le soir, à Brünn, il monte jusqu'à la citadelle du Spielberg qui domine toute la région. Les nuages courent au ras des collines. L'horizon au sud-ouest est ourlé d'une bande plus claire.
On entend le canon et des détonations. Les Russes ont cessé de reculer. Il faut que Koutousov accepte la bataille. Il faut l'attirer là, vers ce plateau de Pratzen.
Napoléon déploie ses cartes. Et, le 20 novembre au matin, il dicte un ordre bref. « Il est ordonné au maréchal Davout de se rendre à Austerlitz. »
Napoléon, du bout de l'ongle, trace un trait sous le nom de cette ville située en contrebas du plateau de Pratzen, à son extrémité sud.
Le lendemain matin, jeudi 21 novembre, il se lève avant l'aube. Il est reposé et calme. Il monte son cheval blanc et, entouré de son escorte et de ses aides de camp, il galope seul en avant. Il longe la vallée du Goldbach, traverse les villages de Kobelnitz, de Bosenitz, monte sur les plateaux. Souvent il met pied à terre.
C'est ici qu'il veut que la bataille ait lieu, sur ces plateaux, dans ces vallées parsemées d'étangs.
Il va à pied, son mamelouk Roustam tient son cheval par les rênes.
Napoléon se tourne vers ses aides de camp et ses officiers d'ordonnance.
- Jeunes gens, dit-il, étudiez bien ce terrain, nous nous y battrons.
38.
Ce matin, mercredi 27 novembre 1805, Napoléon attend l'aube au sommet de la citadelle du Spielberg. Les chasseurs de sa garde se tiennent au pied des fortifications. Il veut être seul face à ce paysage qui sort lentement de la nuit et du brouillard. Depuis quelques jours, le temps a changé. Le froid est plus intense, mais les averses de neige et de pluie ont cessé. Le sol a gelé. Il sera bon pour les charges de cavalerie qui résonneront sur la terre dure et sèche. Le ciel, maintenant que le brouillard se dissipe, est voilé mais clair, et le soleil surgit comme une hostie rouge à l'est.
Il connaît chaque mètre carré de ce paysage, de cet immense triangle où la bataille qu'il attend, qu'il a conçue va se dérouler, comme une immense manœuvre sur un polygone.
Читать дальше