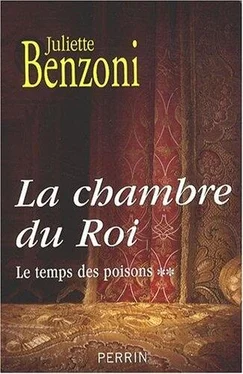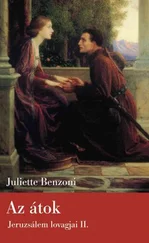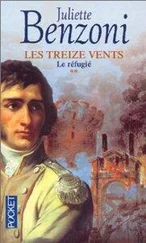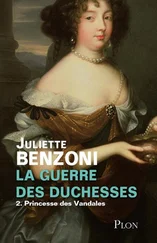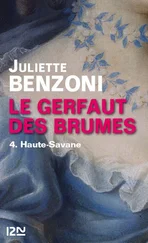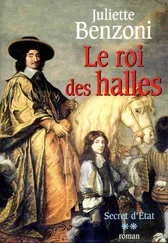Mais, comme chez tous les Guise, l’insolence n’était jamais loin chez le chevalier, ce dernier répliqua :
— Encore faudrait-il que nous connaissions la dame en question.
— Vous ne la connaissez pas ?
— Non, Sire.
— Alors continuez ! Ce sera mieux pour tout le monde...
Et comme on devait assister à un concert, le Roi alla s’asseoir dans son fauteuil et se fit remettre le programme de la soirée...
ÉPILOGUE
Cinq ans plus tard...
Au matin du 17 juillet 1691, Alban Delalande quittait la Bastille dans la voiture de M. de La Reynie, accouru en hâte dès que la nouvelle lui était parvenue : M. de Louvois venait de mourir ! La veille il avait été pris d’un malaise qui l’avait saisi dans le Cabinet même du Roi d’où il était sorti porté par deux valets.
Étrange malaise, d’ailleurs ! Certes, sa santé n’était pas des meilleures depuis quelque temps. L’accumulation de ses charges était écrasante et il travaillait sans discontinuer, aiguillonné par la crainte d’une disgrâce à laquelle, chuchotait-on, Mme de Maintenon œuvrait parce qu’il s’était opposé sans nuances à la publication de son mariage avec le Roi. Certes, il avait de fréquents accès de fièvre qu’il soignait en buvant force eau de Forges qu’il faisait venir, mais nul ne l’eût supposé à cette extrémité. L’homme semblait bâti pour durer et pourtant...
On le rapporta donc dans son appartement de la Surintendance, au bout de l’aile ancienne du château, le long de l’Orangerie. Mis au lit, il fut saigné et purgé. On lui appliqua des ventouses, on lui fit avaler de l’eau apoplectique, des gouttes d’Angleterre et des eaux divines et générales. Rien n’y fit : en un quart d’heure, il était mort...
— Naturellement, conclut La Reynie, le mot de poison court déjà un peu partout...
Mais Alban ne l’écoutait que d’une oreille. Penché à la portière, il dévorait des yeux le paysage parisien baigné de soleil ; il se laissait envahir par les cris de la rue, les bruits de la ville qui lui avaient tant manqué ; il respirait les odeurs - pas toujours suaves d’ailleurs !
— Mais qui étaient celles de la liberté retrouvée. Les murs énormes de la Bastille étouffaient tout cela...
— Où me conduisez-vous ? demanda-t-il.
— Chez toi d’abord pour que tu t’y débarrasses des senteurs de la prison. Ton logis a été entretenu par les soins de M. Sainfoin. Tu as besoin, je pense, de te retrouver toi-même ?
— Ô combien ! J’ai l’impression de renaître... Mais vous avez dit « d’abord » ?
— Ce qui annonce une suite ? Eh bien... ensuite, je t’emmènerai à Saint-Germain.
Le visage dont les traits s’étaient burinés s’illumina :
— Elle m’attend donc toujours ?
— Question idiote ! Elle t’aurait attendu l’éternité s’il l’avait fallu. Son cœur n’est pas de ceux qui se reprennent...
— Alors, allons-y vite, tel que je suis ! Elle s’en souciera peu... et j’ai trop espéré cet instant...
— Tu crois ?
Le trajet entre la Bastille et la rue Beautreillis était court. On arrivait. La voiture stoppa devant la maison.
— Non, ne nous arrêtons pas ! Continuons ! pria Alban.
— Je pense que ce serait dommage, lit La Reynie. Regarde plutôt !...
Alertée par le pas cadencé des chevaux, Charlotte venait d’apparaître sur le seuil de la maison.
— Alban ! cria-t-elle.
Il avait déjà sauté à terre et ils s’élancèrent l’un vers l’autre rayonnants d’un bonheur qui les étranglait à demi. L’instant suivant, ils s’étreignaient, perdus dans ce baiser qu’ils n’espéraient plus. Puis il l’enleva dans ses bras, l’emporta dans la maison dont il referma la porte sur eux d’un violent coup de talon...
Resté seul, La Reynie, revenu de sa surprise, se mit à rire:
— Touche au Châtelet ! cria-t-il au cocher. On n’a plus besoin de nous !
Quelques jours plus tard, Charlotte et Alban étaient mariés et, comme M. Isidore ne voyait pas ce qu’il pouvait faire de mieux, il fit de Mlle Léonie des Courtils de Chavignol une Mme Sainfoin du Bouloy... Bien sûr ils n’eurent pas de progéniture, mais le rôle de futurs grands-parents leur convenait parfaitement...
FIN
Saint-Mandé, novembre 2008
[1] Le 25 septembre 1683, Madame fut en effet victime d’un accident de chasse heureusement sans gravité.
[2] Cela allait de cinq pieds ( 1,68m ) pour le souverain à quatre pouces ( 11 cm ) pour les maréchaux et les grands dignitaires.
[3]Laissé à l’abandon, il fut démoli sur ordre de Louis XV. On a bâti dessus… La gare de Versailles !
[4] Il y resterait jusqu’à sa mort en 1707à l’âge de quatre-vingt-huit ans .
[5]Le duc Charles III de Créqui, après de nombreuses campagnes devint ambassadeur de France à Rome avant d’être gouverneur de Paris. Il mourut trois ans plus tard de chagrin de n’être plus l’ami du Roi. Louis XVI, sans doute gêné, ne lui adressait plus la parole.
[6] Le duc Charles III de Créqui, après de nombreuses campagnes, devint ambassadeur de France à Rome avant d’être gouverneur de Paris. Il mourut trois ans plus tard de chagrin de n’être plus l’ami du Roi. Louis XIV, sans doute gêné, ne lui adressait plus la parole.
[7] Futur roi Philippe V d’Espagne.
[8] Sidonia de Lenoncourt, marquise de Courcelles, fut longtemps poursuivie par la passion de Louvois. Mal mariée par ailleurs, la jeune femme alternait les séjours dans les couvents et les aventures amoureuses.
[9] Le futur Régent
[10] Si l’on considère ce qu’était la gastronomie au Grand Siècle, ce menu reste relativement simple et composé de peu de plats. La gourmandise de Louis XIV, qui était un mangeur peu ordinaire, était pour quelque chose, mais on reste pantois devant la complication de certaines recettes.
[11] Environ 2 mètres.
[12] La ville se hâta de le reconstruire « en dur ». C’est aujourd’hui le pont Royal.
[13] On appelait ainsi l’épilepsie
[14] Cette chambre n’était pas encore celle que l’on connaît au centre de la cour de Marbre et qui a été si magnifiquement reconstituée. Louis XIV ne l’occupa qu’en 1701.
[15] Voir tome 1 : On a tué la Reine !
[16] Dans l’une de ses lettres à sa tante Sophie, elle n’avait pas hésité à écrire : « Ce vieux diable de Fagon a tué la Reine afin de laisser le champ libre à la vieille guenipe. »
[17] Elle allait avoir trente-trois ans, douze de moins que Monsieur.
[18] Cette autorisation fut réduite quelques mois plus tard. Il y avait trop de monde.
[19]Voici un exemple – 3 septembre 1786- de distribution des pavillons. A gauche : au 1, Mmes de Chevreuse et de Gramont ; au 2, Mmes d’Urfé et Dangeau ; au 3, le duc du Maine et le comte de Toulouse ; au 4, MM. De Vendôme et de Livry ; au 5, MM. De Louvois et le Premier médecin ; au 6, le maréchal d’Humières et M. de Cavoye.
A droite : au 1, M.le Duc et M.d’Aumont ; au 2, MM. de la Rochefoucauld et Tilladet ; au 3, MM. le Grand (Ecuyer) et M. de Noailles ; au 4, M. Lassale et le Premier Médecin ; au 5, MM. de la Feuillade et de Fillequier ; au 6, MM. de Duras et de Lorges.
[20] Le cabaret était plus élégant que l’auberge et préfigurait le restaurant.
[21] Actuelle place des Vosges
[22] 2,7 cm
[23] Par exemple, celui de l’homme au masque (de fer).
[24] Dix mètres