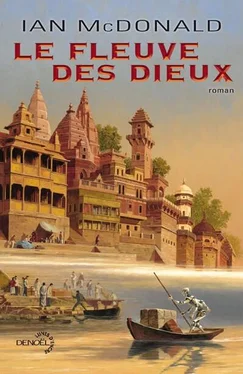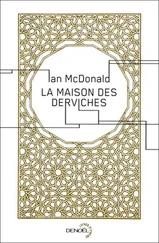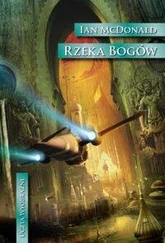Le mausolée de Moazam Ali Khan se dressait parmi les épaisses souches d’arbres dans la partie la plus ancienne du cimetière. C’était le premier Khan inhumé là, sur une éminence caillouteuse au-dessus du limon apporté par les inondations. Au fil des saisons, les Mûsâ avaient coupé le feuillage qui donnait de l’ombre, mais l’intendant actuel de Râmghar approuvait ce dépouillement. Il permettait à la tombe, petite mais aux proportions classiques, d’étirer ses os, laissait respirer sa peau de grès, dévoilait la construction. Shahîn Badûr Khan se pencha pour passer sous l’arche orientée à l’est et arriver sous le dôme intérieur. Les délicats écrans jâlîs s’étaient depuis longtemps écroulés, et Shahîn Badûr Khan savait depuis ses aventures d’enfance que des chauves-souris hantaient le caveau en dessous, mais la tombe du fondateur de la dynastie politique des Khan, même délabrée, enchantait le visiteur. Moazam Ali avait vécu une existence d’accomplissement et d’intrigue, relatée par les chroniqueurs ourdous, comme Premier ministre des nababs de l’Awadh à l’époque où le pouvoir des Moghols de moins en moins flamboyants établis à Âgrâ connaissait une hémorragie au profit de leurs liges symboliques à Lakhnau. Il avait supervisé la transformation d’une ville commerçante médiévale sordide en un fleuron de la civilisation islamique, puis, sentant la fragilité de tout cela dans la lotion capillaire des représentants de la Compagnie anglaise des Indes orientales, s’était retiré de la vie publique avec son modeste mais célèbre harem de poétesses persanes afin d’étudier le mysticisme sûfi dans le pavillon de chasse au gibier offert par la nation reconnaissante. À l’époque où Moazam Ali et ses poétesses menaient une vie studieuse au milieu des oiseaux chanteurs des marais n’avait succédé qu’un lent déclin vers la poussière. La lumière sous le dôme diminuait de seconde en seconde avec l’avancée de la mousson sur Râmghar Kothî, avec sa promesse de marécages revivifiés et de lacs rétablis. Les doigts de Shahîn Badûr Khan tracèrent le contour du mihrab, la niche indiquant la direction de La Mecque.
Deux générations après, Mushtâq Khan repose sous une élégante chhatrî, ouverte au vent et à la poussière. Sauveur de la réputation et de la fortune familiales en restant loyal au Râj au moment de la mutinerie du nord de l’Inde. Des gravures de journaux de 1857 le montrent défendant, un pistolet dans chaque main et sous des volutes de fumée d’armes à feu, sa propriété et sa famille assiégées par des hordes de cipayes. La vérité était moins spectaculaire : un petit détachement de mutins qui attaquait Râmghar avait été repoussé sans pertes à l’aide d’armes de poing, mais cela suffit pour lui valoir, auprès des Britanniques, le titre de Fidèle Mahométan et, auprès des Hindous, celui de Khan le Tueur, titres de gloire parmi les Seigneurs du Râj qu’il convertirait prudemment en une campagne pour une reconnaissance politique particulière des musulmans. Comme il a dû se sentir fier, pensa Shahîn Badûr Khan, d’avoir vu ces graines donner naissance à une nation musulmane, un Pays des Purs. Comme il aurait eu le cœur brisé en voyant ce Pays des Purs devenir une théocratie médiévale puis se laisser déchirer par le factionalisme tribal. Les prophéties de la Parole de Dieu sorties d’un canon d’AK47. Le temps, la mort et la poussière. Les cloches du temple tintèrent de l’autre côté du marécage mort. Du sud lui parvint la sirène d’un train, actionnée en permanence. Un léger coup de tonnerre ébranla l’atmosphère.
Et là, recouvert par cette stèle de marbre sur le banc de gravier, au seul endroit assez profond pour une tombe, repose son grand-père, Sayid Raiz Khan, juge et bâtisseur de nation qui a gardé son épouse et sa famille en sécurité au moment des Guerres de Partition et de leur million de morts, toujours fermement persuadé qu’une Inde devait exister et que pour être tout ce qu’avait déclaré Nehru ce minuit-là en 1947, cette Inde devait accorder une place d’honneur aux musulmans. Là, son père : avocat militant et membre de deux Parlements, l’un à Delhi, l’autre à Vârânacî. Il avait livré ses propres Guerres de Partition. Les Fidèles Mahométans Khan, chaque génération luttant contre les réalisations de la précédente, jusqu’à la dernière goutte.
Les phares de l’automobile sont visibles à des kilomètres sur ce terrain plat et nu. Shahîn Badûr Khan descend les marches délabrées de la tourelle des joueurs de tambour pour ouvrir le portail. Les domestiques de Râmghar, âgés et dociles, méritent de dormir. Il sursaute en sentant la pluie sur sa lèvre, la goûte doucement du bout de la langue.
J’ai provoqué une guerre pour ça.
La Lexus entre dans la cour. Sa carapace d’un noir luisant est constellée de pluie. Shahîn Badûr Khan ouvre la portière. Bilqis Badûr Khan sort, vêtue d’un sari de soirée bleu et or, le dupattâ tiré sur la tête. Il comprend. Cache ton visage. Shahîn appartient à un peuple qui, autrefois, pouvait mourir de honte.
« Merci d’être venue », dit-il. Elle lève la main. Pas ici. Pas maintenant. Pas devant les domestiques. Il désigne la chhatrî à colonnes de la tourelle, cède le passage à son épouse qui soulève son sari pour escalader les marches abruptes. La pluie a désormais acquis un rythme, l’horizon au sud-est est une cérémonie d’éclairs. La pluie dégouline en continu du bord du toit en dôme qui coiffe la tourelle moghole octogonale. Shahîn Badûr Khan prend la parole : « Avant tout, je dois te dire que je suis vraiment très, vraiment profondément désolé de ce qui s’est passé. » Les mots ont un goût de poussière sur ses lèvres, la poussière de ses ancêtres vers lesquels s’infiltre la pluie. Ils gonflent dans sa bouche. « Je… non. Nous avions un accord, je ne l’ai pas respecté, cela s’est ébruité d’une manière ou d’une autre. Le reste appartiendra à l’histoire. J’ai été d’une imprudence intolérable et cela m’est retombé dessus. »
Il ne sait pas à quel moment elle a commencé à avoir des soupçons, mais après la naissance de Dârâ, il était devenu évident que Bilqis ne pouvait être tout ce qu’il désirait. Leur union était le dernier mariage moghol, un mariage de dynastie, de pouvoir et d’opportunisme. Ils n’en avaient parlé ouvertement qu’une seule fois, après le départ de Jehân à l’université, dans une havelî soudain sonore et remplie de trop nombreux domestiques. Cela avait été une conversation forcée, sèche, douloureuse, aux phrases remplies d’allusions et d’élisions car rien n’échappait au personnel de maison, tout juste assez longue pour établir l’accord qu’il ne laisserait jamais cela menacer la famille et le gouvernement, que Bilqis resterait une épouse d’homme politique convenable et dévouée. À ce moment-là, ils n’avaient pas couché ensemble depuis dix ans.
Ça. Ils n’avaient jamais donné de nom à la chose entre eux. Shahîn Badûr Khan ne sait plus trop vraiment s’il en existe un. Son affliction ? Son vice ? Sa faiblesse, sa bête noire ? Sa perversion ? Il n’y a pas de mots pour les ça dans la langue entre deux personnes.
La pluie tombe si fort que Shahîn Badûr Khan a du mal à se faire entendre.
« Il reste quelques personnes qui me doivent un service, ce qui m’a permis d’organiser une sortie du Bhârat, par un vol direct pour Katmandou. Entrer au Népal ne présentera aucune difficulté. De là, nous pouvons repartir n’importe où dans le monde. En ce qui me concerne, je préférerais l’Europe du Nord, la Finlande ou la Norvège, peut-être. Ce sont de grands pays sous-peuplés où nous pouvons vivre dans l’anonymat. J’ai de l’argent de côté, des traites bancaires transférables, suffisamment pour qu’on s’achète une propriété et une vie convenables, mais peut-être moins confortables que ce dont nous avons pris l’habitude ici au Bhârat. La vie y est chère et nous aurons du mal à nous adapter au climat, mais je pense que la Scandinavie est ce qu’il y a de mieux pour nous. »
Читать дальше