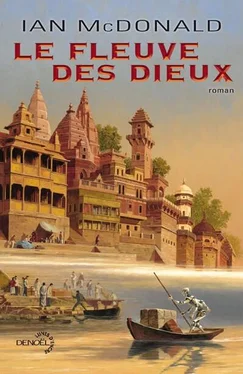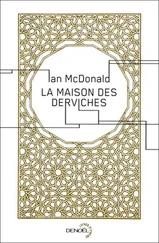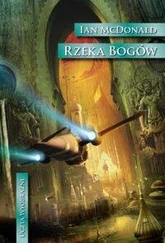— Vous parlez d’un toit, il appartient au gouvernement…
— Oui », dit M. Nanda d’une voix lente et prudente, comme si chaque mot était un seau d’eau remonté d’un puits. « Un toit qui appartient au gouvernement, et auquel j’ai le droit grâce au soin et au dévouement que je consacre à mon métier. Un toit sous lequel je m’attends à trouver la paix, le calme et l’ordre domestique qu’exige ce métier. Vous ne savez rien de ce que je fais. Vous ne comprenez rien aux forces que je combats, aux ennemis que je traque. Des créatures aux ambitions divines, madame. Ces choses que vous ne pourriez même pas commencer à comprendre, qui menacent toutes nos croyances en ce monde, je les affronte jour après jour. Et si mon horrible musique occidentale discordante, si mon insipide régime blanc de firengi, si ma cuisinière et ma balayeuse me fournissent cette paix, ce calme, cet ordre domestique qui me permettent de faire face à une autre journée de travail, est-ce déraisonnable ?
— Non », renvoie Mme Sâdhurbhaï. Elle sent qu’elle court à l’échec, mais comprend aussi qu’il est idiot de mourir sans avoir tiré toutes ses cartouches. « Ce qui est déraisonnable, c’est que Pârvati n’a aucune place dans tout cela, à ce que je vois.
— Pârvati, ma fleur. » L’atmosphère dans la cuisine est d’une épaisseur de sirop. M. Nanda sent l’inertie et le poids de chacun de ses mots, de chacun de ses mouvements de tête. « Es-tu malheureuse ? Te manque-t-il quelque chose ? »
Pârvati va pour répondre, mais sa mère la prend de vitesse.
« Ce que veut ma fille, c’est sentir qu’on voit en elle l’épouse d’un professionnel attentionné et dévoué, et non une femme cachée en haut d’un immeuble du centre-ville.
— Pârvati, c’est vrai ?
— Non, dit-elle. Je pensais que peut-être…» Une fois encore, sa mère ne fait aucun cas d’elle.
« Elle aurait pu choisir n’importe qui, n’importe qui : un fonctionnaire, un avocat, un homme d’affaires… Et même un politicien, il l’aurait prise et installée là où elle doit l’être et exhibée comme une fleur, il lui aurait offert ce à quoi elle a droit.
— Pârvati, mon amour, je ne comprends pas. Je croyais que nous étions heureux, ici.
— Alors vous ne comprenez en effet rien si vous ne savez pas que ma fille aurait pu avoir toutes les richesses des Moghols et qu’elle y aurait renoncé juste pour un enfant…
— Mère ! Non ! s’écrie Pârvati.
— … un enfant convenable. Un enfant digne de son statut. Un véritable héritier. »
L’atmosphère est désormais irrespirable. M. Nanda arrive à peine à tourner la tête vers Mme Sâdhurbhaï.
« Un brâhmane ? C’est ce que vous voulez dire ? Pârvati, c’est vrai ? » Elle pleure au bout de la table, le visage dissimulé dans son dupattâ. M. Nanda sent ses sanglots secouer la table. « Un brâhmane. Un enfant génétiquement conçu. Un enfant humain qui vit deux fois plus longtemps, mais vieillit deux fois moins vite. Un être humain qui ne peut jamais avoir ni le cancer, ni la maladie d’Alzheimer, ni de l’arthrite ni aucune des maladies dégénératives qui nous tomberont dessus, Pârvati. Notre enfant. Le fruit de notre union. Est-ce ce que tu veux ? Que nous emmenions notre semence chez les médecins pour qu’ils l’ouvrent, la désassemblent et la modifient si bien qu’elle ne serait plus la nôtre, puis l’amalgament avant de mettre ça dans ton ventre, Pârvati, qu’ils te gavent d’hormones et de médicaments contre la stérilité, qu’ils te le fourrent dans le ventre jusqu’à ce qu’il prenne et te fasse gonfler, cet étranger en toi.
— Pourquoi lui refusez-vous ça ? s’exclame Mme Sâdhurbhaï. Quel parent repousserait l’occasion d’avoir un enfant parfait ? Vous refuseriez ça à une mère ?
— Parce qu’ils ne sont pas humains ! crie M. Nanda. Vous les avez vus ? Moi, je les ai vus. Je les vois chaque jour dans les rues et les bureaux. Ils ont l’air si jeunes, mais il n’y a là rien de notre connaissance. Les aeais et les brahmanes sont la destruction de chacun de nous. Nous sommes redondants. Des culs-de-sac. Je lutte contre des monstres inhumains, je ne vais pas en inviter un dans le ventre de ma femme. » Ses mains tremblent. Ses mains tremblent. Ce n’est pas juste. Tu vois à quoi ces femmes t’ont conduit ? M. Nanda recule sa chaise et se lève. Il se sent mesurer des kilomètres de haut, immense et diffus comme un avatar de sa boîte, remplissant les immeubles. « Je sors. J’ai à faire. Je ne rentrerai peut-être pas avant demain, mais à mon retour, ta mère sera partie d’ici. »
La voix de Pârvati le suit dans l’escalier.
« C’est une vieille femme, il est tard, où ira-t-elle ? Vous ne pouvez pas jeter une vieille femme à la rue. »
M. Nanda ne répond pas. Il a une aeai à excommunier. Au moment où il sort de l’immeuble d’habitation qui appartient au gouvernement pour s’approcher de l’automobile qui appartient au gouvernement, des pigeons s’envolent autour de lui en un applaudissement d’ailes bruissantes. Il serre l’image du Kalkî d’ivoire dans sa main.
Sur cette tourelle, les joueurs de tambour accueillaient autrefois les invités qui arrivaient par la chaussée traversant le marécage. Des oiseaux aquatiques s’envolaient de chaque côté de celle-ci : des aigrettes, des grues, des spatules ainsi que les canards sauvages à cause desquels Moazam Ali Khan avait choisi cet endroit pour construire son pavillon de chasse, dans la plaine d’inondation d’hiver de la Ghâghra, au niveau du lac Râmghar. Le lac est maintenant asséché, les marécages sont devenus boue fissurée, les oiseaux ont disparu. Aucun tambour n’a résonné sur le naqqârkhânâ du vivant de Shahîn Badûr Khan. Le pavillon se trouvait déjà plus ou moins à l’abandon du temps de son père, Asad Badûr Khan, qui dort dans les bras d’Allah sous un simple rectangle de marbre du cimetière familial. Durant la vie de Shahîn Badûr Khan, on a abandonné à la chaleur et à la poussière d’abord les chambres, puis les suites et les ailes ; les tissus pourrirent et se déchirèrent, le plâtre se tacha et s’écailla dans l’humidité de la mousson. Le cimetière lui-même est recouvert d’herbes bonnes ou mauvaises, désormais flétries et jaunies par la sécheresse. L’un après l’autre, les ashokas qui donnaient de l’ombre ont été abattus et emportés par les gardiens comme bois de chauffe.
Shahîn Badûr Khan n’a jamais aimé le vieux pavillon de chasse de Râmghar Kothî. Voilà pourquoi il est venu s’y cacher. Seuls ceux en qui il a confiance savent cet endroit encore debout.
Il dut klaxonner dix minutes avant qu’il vienne à l’idée des gardiens que quelqu’un pourrait vouloir visiter le pavillon. C’était deux musulmans pauvres et âgés, mais pleins d’orgueil, un instituteur à la retraite et son épouse. En rémunération de leur lutte contre l’entropie, ils obtenaient l’usage gratuit d’une aile ainsi qu’une poignée de roupies par semaine pour le riz et le dâl. Le vieux Mûsâ ne put dissimuler sa surprise en ouvrant les deux battants du portail. Peut-être à cause de cette visite inattendue après quatre ans d’oubli. Ou parce qu’il savait tout, ayant écouté les informations de la Voix du Bhârat. Shahîn Badûr Khan entra à l’abri du cloître des écuries, puis ordonna au gardien de barricader le portail.
Devant le mur noir auquel ressemblait l’horizon à l’est, Shahîn Badûr Khan s’avança entre les tombes poussiéreuses de son clan. Ses ancêtres moghols avaient baptisé la mousson le Marteau de Dieu. Ce marteau s’était abattu, et Shahîn Badûr Khan vivait encore. Il pouvait dresser des plans. Il pouvait rêver. Il pouvait même espérer.
Читать дальше