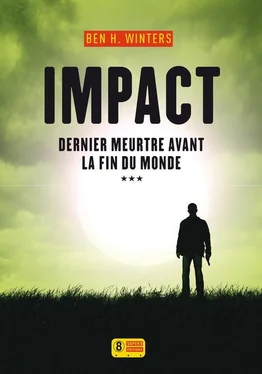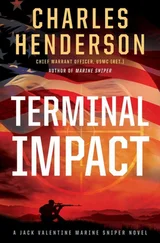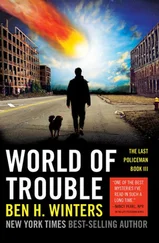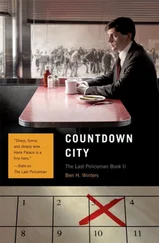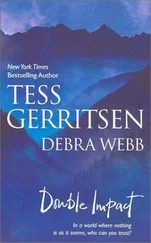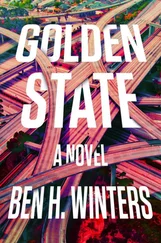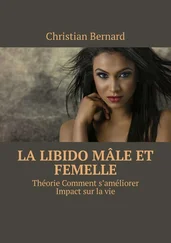Et c’est ce que je fais, je m’éloigne, sans geste brusque, à quatre pattes, le derrière en l’air.
En rampant hors de ce guêpier, je passe tout contre la base du mur, et je remarque au passage la marque de fabrique de celui qui l’a construit. Un mot unique, coloré en rouge sombre : joy.
Les seuls suicidés que je découvre à Rotary se trouvent sur la galerie extérieure d’une maison de Downing Drive : des coups de fusil, le mari et la femme, un pichet de citronnade entre eux deux sur la table à plateau de verre, des cristaux de sucre visibles sur les bords et des quartiers de citron pourrissant au fond. Le mari tient encore le fusil, serré entre ses mains, enfoncé entre ses genoux. J’analyse rapidement la scène, d’instinct, sans même le vouloir. C’est lui qui a tiré, il l’a tuée d’abord, proprement, puis a retourné l’arme contre lui-même ; il a pris une cartouche dans la pommette – un premier essai, raté –, puis une seconde, sous le menton, sous un angle correct.
J’éprouve une brève bouffée d’affection pour le mort, dont le bas du visage n’est plus qu’un trou rouge, pour avoir honoré leur marché. D’abord sa femme, puis lui-même, et il est allé jusqu’au bout, comme promis. Les abeilles bourdonnent autour du pichet de citronnade, attirées par ses derniers effluves sucrés.
Ils n’ont pas de masse de forgeron. Je vais voir au garage, puis à l’intérieur, même, dans les placards. Simplement, la masse n’est pas un outil très répandu chez les particuliers.
Houdini et moi descendons les marches et rejoignons Downing Drive, où nous sommes accueillis par des bouffées d’une odeur chaude qui remonte la rue pour venir nous englober, et je jure que nous nous regardons, le chien et moi, et que, même si évidemment il ne peut pas parler, nous nous disons : « Ça ne serait pas du poulet grillé ? »
La salive envahit ma bouche, et Houdini se met à tourner vivement sa petite tête en tout sens. Il a les yeux brillants de joie, comme deux billes toutes neuves. « Va ! » dis-je, et le chien se rue vers la source de ce fumet.
Je cours derrière lui. Nous enfilons en sprint une rue adjacente que je n’avais pas encore explorée, une longue voie étroite qui s’éloigne d’Elm Street en direction de l’ouest. Encore des petites maisons aux volets fermés, une station-service dont les pompes ont été arrachées du sol. Tandis que je cours après le chien, mon estomac se met à gronder et j’ai un petit rire, un petit rire saccadé de fou, à envisager la possibilité que ce soit une sorte de mirage : le cinglé courant derrière une vision floue d’oasis, le grand policier affamé se précipitant aux trousses d’un illusoire plat de poulet.
La rue remonte un peu, traverse deux carrefours, et là, à droite, il y a un parking – au centre duquel, vision déconcertante, s’élève la forme caractéristique d’un restaurant Taco Bell. Le hideux décor extérieur violet et jaune, les murs en stuc bas de gamme, une de ces petites structures construites par millions à la périphérie des villes au cours du dernier demi-siècle de civilisation américaine. Mais ce n’est pas de la sous-cuisine mexicaine qui s’y prépare. L’odeur est maintenant épaisse autour de Houdini et moi. C’est une odeur de poulet grillé, riche, légèrement fumée, impossible à confondre avec une autre. Je m’essuie le menton : je salive comme un personnage de dessin animé.
Il y a de la musique, aussi, c’est l’autre bizarrerie. Nous voilà en train de traverser le parking du Taco Bell, lentement, moi devant, l’arme au poing, Houdini marchant sagement sur mes talons, et nous écoutons une musique lourdement rythmée en provenance du restaurant – ou plutôt de derrière le restaurant, dirait-on –, de la musique tapageuse, de grosses guitares, des voix qui braillent.
Je m’immobilise et pousse un sifflement bref pour appeler le chien, qui s’assoit à contrecœur derrière moi. J’observe attentivement le bâtiment, les vitres brisées qui laissent apercevoir des banquettes en skaï, des tables en Formica, des distributeurs de serviettes en papier. Un annuaire téléphonique maintient la porte ouverte.
Ce sont les Beastie Boys, la musique qui hurle à l’autre bout du parking. La chanson « Paul Revere », de cet album qui a fait un tabac. La brise nous apporte l’odeur de poulet en même temps que les basses.
« Assis. Pas bouger », dis-je au chien avec autorité. Il m’obéit, plus ou moins, en gigotant avec excitation, pendant que je longe prudemment le petit édifice kitsch.
« Qui est là ? »
Personne ne me répond, mais je ne suis pas certain de m’être fait entendre par-dessus la musique. Je n’ai jamais été un grand fan des Beastie Boys. J’avais un ami, Stan Reingold, qui s’est passionné pour le hip-hop pendant environ une semaine, au collège. Il y a quelques années de cela, j’ai appris qu’il s’était engagé dans l’armée et qu’il s’était retrouvé en Irak avec la 101e division aéroportée. Il peut être n’importe où à l’heure qu’il est, bien sûr. J’élève le SIG Sauer à hauteur de mon torse, et je fais un grand pas pour enjamber la haie basse et rejoindre l’allée réservée au service en voiture.
Je ne crois plus sérieusement qu’il puisse s’agir d’un mirage. L’odeur du poulet qui cuit est trop forte, mêlée au parfum de goudron qui monte de l’asphalte mouillé par la pluie. C’est peut-être un piège : on attire les passants innocents avec de la musique de fête et des odeurs délicieuses, et ensuite… qui sait ?
Un énorme camping-car m’empêche de voir ce qui se passe là-bas : long d’au moins huit mètres, il est garé perpendiculairement au restaurant, l’arrière côté mur. Le véhicule massif est posé sur des parpaings, toutes portes ouvertes, vitres baissées. Des vêtements sont étalés sur le pare-brise et suspendus au capot ouvert. Les flancs marron clair sont décorés de bandes rouges, avec la marque highway pirate calligraphiée à l’aérographe. La musique émane du camping-car, semble-t-il. Houdini pousse un petit jappement à mes pieds – il en a assez d’attendre. Je me baisse pour le caresser en espérant qu’il va se taire. Il n’est pas très bien dressé, ce chien.
La musique s’arrête, il y a un court silence, puis elle recommence. Bon Jovi, maintenant, « Livin’ on a Prayer ». Nous continuons d’avancer, Houdini et moi. Nous longeons sans bruit le flanc du véhicule et, une fois que je l’ai contourné par l’arrière, j’ai enfin une vue dégagée sur le parking. Et sur un homme qui pointe un fusil vers ma tête.
« Stop, me lance-t-il. Tu bouges plus, et tu fais taire ton clebs. »
Je m’immobilise. Par bonheur, Houdini en fait autant. Ils sont deux, un homme et une femme, tous deux à moitié à poil. Lui est torse nu, en caleçon et tongs, les cheveux châtains et sales, avec une coupe mulet qui a repoussé. Elle porte une longue robe à fleurs informe, cheveux roux, soutien-gorge noir. Tous deux ont une bière dans une main et un fusil dans l’autre.
« OK, mon frère, OK, me dit l’homme en me dévisageant avec attention. Ne m’oblige pas à te faire sauter le caisson, d’accord ? » Gros biceps suants, front rougeaud.
« Je n’en ferai rien.
— Il n’en fera rien ! reprend la femme avant de boire une rasade de bière. C’est un bon garçon, hein ? Ça se voit. T’es un bon gars, toi. »
Je fais oui de la tête. « Je suis un bon garçon.
— Ouais. Il va être très sage, le garçon. »
Elle me lance un clin d’œil. Je la regarde, médusé. C’est Alison Koechner. La première fille que j’ai aimée. Ce corps mince et blanc, ces boucles orangées, comme des rubans de bolduc sur un paquet cadeau.
Читать дальше