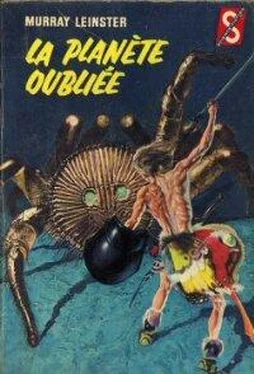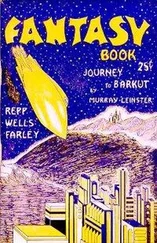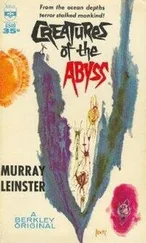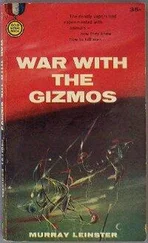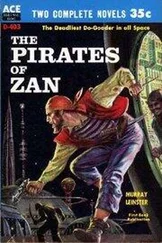À voix basse, Burl se mit à distribuer des ordres à ses compagnons. Il savait – comme les autres – ce qui allait se passer maintenant. Quand la suite logique du meurtre commença à se dérouler, il s’avança tandis que ses amis le suivaient en tremblant. En fait, on ne pouvait rêver entreprise moins dangereuse – mais la simple perspective d’attaquer une guêpe avait déjà de quoi faire dresser les cheveux sur la tête.
Le second acte du drame était abominable. Les guêpes, normalement, sont carnivores, mais on était à la saison où elles élèvent leurs jeunes. Il y avait obligatoirement du miel dans le jabot du bourdon. Si le lourd insecte était parvenu à son nid, il aurait dégluti le liquide sucré pour en nourrir ses larves. Seulement, autant ce miel est favorable à la croissance des jeunes bourdons, autant il devient poison mortel pour les larves de guêpes. Il convenait donc que la guêpe vide le jabot de son contenu avant de transporter la carcasse du bourdon qui, elle seule, servirait de nourriture à la jeune larve de la prédatrice. Et, merveille de la nature, la guêpe qui, durant tout le reste de l’année, aurait méprisé semblable aliment, en était folle à cette période précise.
Renversant le corps flasque de sa victime, elle entreprit de l’écraser pour en faire sortir le miel. C’était dans ce but qu’elle avait frappé les centres nerveux : le cadavre était ainsi parfaitement malléable, prêt à toutes les manipulations.
Et le bourdon vomit effectivement son miel que la guêpe, ivre d’extase, se mit à boire avec délectation au fur et à mesure qu’il coulait. Plus rien au monde ne comptait pour elle que ce nectar dont elle s’enivrait.
Burl et ses compagnons ne perdirent pas de temps. Les armes de fortune entrèrent en action, transperçant l’insecte de part en part dans un affreux bruit de cuirasse fracassée. Un coup de Burl, particulièrement bien ajusté, coupa même la guêpe en deux au niveau de la taille.
Mais même dans la mort, la bouche de la guêpe resta rivée à celle du bourdon, comme si elle comptait s’abreuver du miel de son ennemi pour l’éternité.
Burl se redressa et regarda fièrement ses compagnons. C’était maintenant des hommes qu’il avait devant lui !
Ce soir-là, juste au moment du coucher du soleil, la tribu parvint au sommet d’un petit monticule. Depuis une heure, ils faisaient marches et contremarches pour éviter les nuages de poussière rouge. À un moment, ils avaient failli être encerclés par trois éclatements de spores meurtrières. Ils n’avaient réussi à s’échapper que grâce à une course éperdue.
Mais maintenant qu’ils pouvaient voir le paysage qui s’étendait devant eux, ils eurent le sentiment que tous ces efforts avaient été inutiles. Leur route allait traverser une plaine large d’environ six kilomètres et que les lycoperdons coloraient d’un rouge brique. Cette plaine n’était pas seulement dangereuse, elle était fatale. Or, elle s’étendait à perte de vue dans toutes les directions. Très loin à l’horizon, dans la brume, Burl aperçut le reflet d’une eau courante.
Sur la plaine elle-même, les spores flottaient comme un brouillard. Sans cesse se produisaient de nouveaux éclatements. Il y avait des millions de plantes meurtrières.
Effarée, la tribu pensait au danger mortel que présentait une marche à travers ce paysage maudit.
Avancer, c’était mourir à coup sûr.
Seulement ce serait un suicide que de tenter de revenir en arrière.
Burl réussit à garder ses compagnons vivants jusqu’à la tombée de la nuit. La troupe marcha très lentement. Burl avait placé des guetteurs qui observaient tous les points de l’horizon. Sur leurs avertissements criés d’une voix stridente, ils changèrent quatre fois de direction. Les adultes aidaient les enfants à éviter la poussière rouge.
Enfin, lorsque la nuit descendit sur la plaine, ils s’arrêtèrent. Burl avait un plan. Il allait conduire ses compagnons à travers les lycoperdons dès que la pluie nocturne aurait duré assez longtemps pour faire tomber la poussière rouge et transformer en boue inoffensive les spores répandues sur le sol.
C’était une entreprise d’une telle folie qu’aucun homme civilisé ne l’aurait tentée. Il n’y avait pas d’étoiles pour se guider, ni de compas pour indiquer la route. Il n’y avait aucune lumière, aucune possibilité de maintenir une ligne droite dans l’obscurité. Il fallait se fier à la chance dans cette tentative qui était peut-être la plus folle que des humains aient jamais acceptée de risquer.
Pour suppléer à leurs sens défaillants, ils utilisèrent les longues antennes d’un hanneton. Quand ils entrèrent en file dans la plaine rouge, Burl, qui marchait en tête, balaya le chemin avec une des antennes plumeuses. Saya, qui ne le quittait pas, l’aidait dans cette tâche avec l’autre antenne. La tribu suivait. Ils se tenaient tous par la main.
Le ciel était complètement noir. Mais, dans une plaine, l’obscurité n’est jamais totale. Et puis, il y avait des phosphorescences, des champignons qui répandaient leur propre luminosité, des rouilles qui brillaient faiblement. Il n’y avait ni lucioles ni vers luisants pour éclairer la petite troupe. Tous étaient morts. Mais il n’y avait pas non plus d’ogres pour lui donner la chasse. Ils avançaient lentement, en une seule colonne, à travers les lycoperdons rouges. Au bout d’une demi-heure, Burl lui-même doutait de suivre la ligne qu’il s’était tracée. Une heure plus tard, tous se disaient avec désespoir qu’à l’aube ils se trouveraient au milieu de la poussière rouge qui leur rendrait l’air irrespirable. Ils n’en continuaient pas moins d’avancer.
À un moment donné, ils reniflèrent l’odeur pénétrante des choux. Suivant leur odorat, ils ne tardèrent pas à atteindre un taillis de ces végétaux géants que les moisissures parasitant leurs feuilles faisaient luire faiblement dans la nuit. Et, pour la première fois depuis des heures, ils virent des créatures vivantes : d’énormes chenilles qui dévoraient inlassablement afin de tuer le temps en attendant l’heure de la métamorphose. Burl les aurait volontiers insultées dans sa rage de voir qu’elles étaient – croyait-il – immunisées contre la mort rouge.
Et elles l’étaient, en quelque sorte : l’épaisse fourrure qui les revêtait, particulièrement dense au niveau des évents par lesquels elles respiraient, faisait office de filtre et retenait les spores empoisonnées.
Un jour, peut-être, les hommes auraient-ils l’idée de détacher leur pagne de fourrure et de le rouler devant leur nez. Mais ce moment-là n’était pas encore arrivé.
Cependant, avec la docilité du désespoir, la tribu suivit Burl pendant toute la nuit. Lorsque le ciel commença à pâlir à l’est, elle se résigna passivement à la mort. Dans la lumière grise du petit matin, Burl, harassé, regarda autour de lui. On se trouvait dans une petite clairière circulaire, entièrement environnée des redoutables lycoperdons. Il ne faisait pas encore assez clair pour que les couleurs soient visibles. Le sol était recouvert de boue. On n’entendait aucun bruit. Un léger soupçon de l’odeur chaude et poivrée des spores flottait dans l’air.
Burl fut pris d’un amer découragement. Bientôt les nuages de poussière commenceraient à se déplacer, la brume rougeâtre se formerait autour d’eux…
Soudain, le jeune homme leva la tête et poussa un cri de joie. Il avait entendu un bruit d’eau courante.
Ses compagnons le regardèrent avec un espoir naissant. Comme, sans un mot, Burl se mettait à courir, ils le suivirent. Ils hâtèrent le pas en l’entendant pousser un hurlement de triomphe. Ils traversèrent un fouillis de plantes fongoïdes et se trouvèrent sur le bord d’une large rivière. C’était l’eau que Burl avait vu briller la veille à l’horizon.
Читать дальше