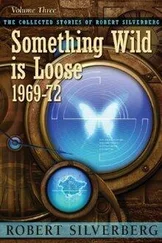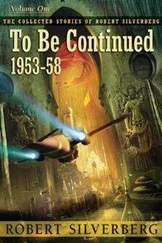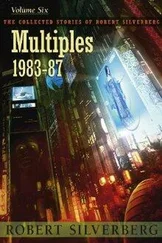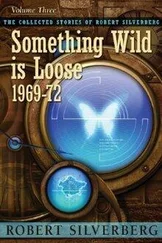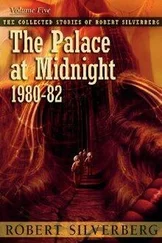Cet après-midi de novembre, je captai des émanations de peur de tous les côtés en rentrant hâtivement chez moi. L’atmosphère de paranoïa était générale. Les gens rentraient les épaules en regardant les autres d’un air suspicieux. Des visages de femmes apparaissaient, livides, derrière les rideaux de leurs appartements, au-dessus des rues silencieuses. Les automobilistes regardaient prudemment dans toutes les directions aux carrefours, comme s’ils s’attendaient à voir les tanks envahir Broadway. (À ce moment-là, on croyait généralement que l’assassinat était le premier coup porté par les auteurs d’un putsch de droite.) Personne ne s’attardait dans la rue. Tout le monde courait s’abriter. N’importe quoi pouvait arriver maintenant. Des meutes de loups pouvaient déboucher dans Riverside Drive. Des patriotes excités pouvaient déclencher un pogrom. De mon appartement – le verrou mis et les volets bouclés – j’essayai de te téléphoner à ton centre d’informatique, pensant que tu n’avais peut-être pas appris la nouvelle, ou simplement poussé par le désir d’entendre ta voix dans ces circonstances traumatisantes. Les lignes téléphoniques étaient embouteillées. Je renonçai au bout de vingt minutes d’essais. Puis, errant désœuvré de la chambre au living et inversement, agrippé à mon transistor, tripotant le cadran pour essayer de trouver une station dont le commentateur m’annoncerait qu’il vivait encore malgré tout, je passai par la cuisine et je trouvai ton mot sur la table, où tu me disais que tu me quittais, que tu ne pouvais plus vivre avec moi. Le mot était daté de ce matin 10 h 30, avant l’assassinat, dans une ère différente. Je me précipitai vers le placard de la chambre et vis ce qui m’avait échappé jusqu’alors, que toutes tes affaires avaient disparu. Quand une femme me quitte, elle le fait toujours brusquement et furtivement, sans le moindre avertissement préalable.
Vers la fin de la soirée, je téléphonai à Nyquist. Cette fois-ci, les lignes étaient dégagées. « Est-ce que Kitty est là ? » lui demandai-je de but en blanc. « Oui », me répondit-il. « Une seconde. » Et il te passa l’appareil. Tu m’expliquas que tu allais vivre chez lui pendant quelque temps jusqu’à ce que tes idées soient remises en place. Il s’était montré très serviable. Non, tu ne m’en voulais pas, tu ne ressentais aucune amertume. Je te paraissais seulement… insensible, alors que lui avait cette compréhension instinctive, intuitive, de tes besoins émotionnels. Il était capable d’entrer dans ta tête, Kitty, et moi je ne le pouvais pas. Alors, tu étais allée vers lui chercher l’amour et le réconfort. Au revoir, disais-tu, et merci pour tout. Je balbutiai un au revoir, et je raccrochai l’appareil. Au cours de la nuit, le temps changea et ce fut sous un ciel noir et une pluie glacée qu’on enterra le Président. Je manquai tout : la bière exposée dans la rotonde, la veuve stoïque et les enfants courageux, l’assassinat d’Oswald et la procession funéraire, toutes ces pages d’histoire instantanée. Le samedi et le dimanche, je me couchai tard, je pris une cuite et lus cinq livres sans en absorber un mot. Le lundi, jour de deuil national, je t’écrivis cette lettre incohérente, Kitty, où je t’expliquais tout, où je te racontais ce que j’avais essayé de faire de toi et pour quelle raison, où je te confessais mon pouvoir et les effets qu’il exerçait sur mon existence, et où je te mettais aussi en garde contre Nyquist, en t’expliquant ce qu’il était, qu’il avait le pouvoir également de lire dans tes pensées et que tu ne pourrais garder aucun secret pour lui. Qu’il ne fallait pas le prendre pour un être humain, qu’il n’était qu’une machine, autoprogrammée pour l’accomplissement maximum de soi-même, et que le pouvoir l’avait rendu froid et cruellement fort, tandis qu’il m’avait au contraire affaibli et rendu instable. J’insistais pour te faire savoir qu’essentiellement il était aussi malade que moi, qu’il se plaisait à manipuler les gens et était incapable de donner de l’amour, seulement de prendre. Je t’avertissais qu’il te ferait du mal si tu te rendais vulnérable à lui. Tu ne répondis pas. Je n’ai plus jamais entendu parler de toi depuis, je ne t’ai jamais revue et je ne l’ai jamais revu non plus. Treize ans. Je n’ai pas la plus petite idée de ce que vous avez pu devenir l’un et l’autre. Probable que je ne le saurai jamais. Mais écoutez. Écoute bien. Je t’aimais, Kitty. Je t’aime en ce moment. Et tu es perdue pour moi à jamais.
Il se réveille raide, engourdi et endolori, dans un service d’hôpital lugubre et sombre. Visiblement, il se trouve à St. Luke, peut-être dans le pavillon des urgences. Sa lèvre inférieure est enflée, son œil gauche s’ouvre avec difficulté et son nez fait un bruit de sifflet inhabituel à chaque inspiration. Est-ce qu’ils l’ont transporté ici sur une civière, quand les joueurs de basket en ont eu fini avec lui ? Il essaie d’évaluer les dommages en regardant son corps, mais son cou, étrangement rigide et réticent, ne se plie que juste assez pour lui faire voir la blancheur douteuse d’une blouse d’hôpital. Chaque fois qu’il respire, il imagine qu’il sent les arêtes brisées de ses côtes qui se raclent. Il passe tant bien que mal une main sous la blouse pour tâter sa poitrine et ne découvre pas de pansement. Il ne sait pas s’il faut qu’il en soit soulagé ou inquiet.
Prudemment, il se met assis sur son lit. Un tourbillon d’impressions l’assaille. La salle d’hôpital est bruyante et pleine de monde. Les lits sont serrés les uns contre les autres. Ils sont munis de rideaux isolants, mais pas un seul rideau n’est tiré. La plupart des personnes alitées sont des Noirs, et plusieurs doivent être dans un état grave, à en juger d’après le nombre d’appareils qui les entourent. Coups de couteau ? Pare-brise éclaté ? Amis et parents se pressent autour de chaque lit, gesticulant, discutant et criant. C’est une atmosphère de kermesse. Impassibles, les infirmières circulent au milieu de tout cela, manifestant autant d’intérêt pour les malades qu’un gardien de musée pour les momies qu’il est chargé de surveiller. Personne ne prête attention à Selig excepté Selig, qui retourne à l’examen de sa personne. Du bout des doigts, il explore ses joues. Sans miroir, il ne peut pas dire à quel point son visage est endommagé, mais il y a beaucoup de points sensibles. Sa clavicule gauche est endolorie des suites d’une manchette de karaté fulgurante. Son genou droit est le siège d’élancements pénibles, comme s’il l’avait tordu dans sa chute. Dans l’ensemble, la douleur est moins forte qu’il ne l’aurait imaginé. On lui a sans doute fait une piqûre.
Son esprit est brumeux. Il reçoit des impulsions mentales de ses voisins de salle, mais tout est confus, indistinct. Il capte des auras, mais aucune concrétisation verbale intelligible. Il essaie de rassembler ses idées. Il demande par trois fois à des infirmières qui passent de lui dire l’heure qu’il est, car son bracelet-montre a disparu, mais elles ne font pas attention à lui. Finalement, une Noire massive et souriante vêtue d’une robe rose à froufrous se penche sur lui en disant : « Quatre heures moins le quart, mon poulet. » Du matin ? De l’après-midi ? Probablement de l’après-midi, décide-t-il. De l’autre côté de l’allée, deux infirmières ont commencé à ériger ce qui doit être un système d’alimentation intraveineuse, avec un tuyau en plastique qui pénètre dans le nez d’un énorme Noir inconscient emmitouflé de pansements. L’estomac de Selig ne lui lance pour l’instant aucun signal de faim. L’odeur de pharmacie qui flotte dans la salle lui donne la nausée. C’est à peine s’il est capable de saliver. Est-ce qu’on lui donnera à manger ce soir ? Est-ce qu’on va le garder longtemps ? Qui paiera ? Doit-il demander qu’on avertisse Judith ? Ses blessures sont-elles graves ?
Читать дальше