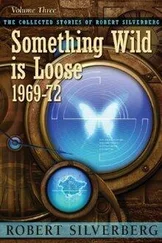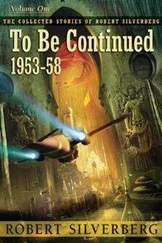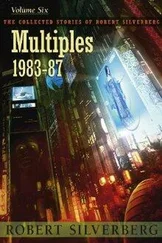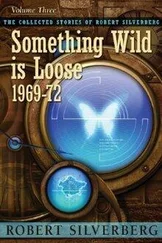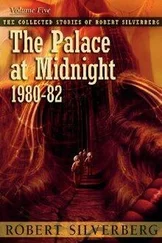Selig n’a pas connu un tel bonheur depuis des années. La lumière, sereine et dorée, envahit son âme. Une gaieté irrésistible le possède. Il court dans des bosquets brumeux à l’aube, il sent les fougères mouillées lui fouetter gentiment les mollets. Le soleil transperce la voûte de feuillage, et les petites perles de rosée brillent d’un feu intérieur glacé. Les oiseaux s’éveillent. Leur chant est tendre et doux, gazouillement lointain qui incite au sommeil. Il court dans la forêt, et il n’est pas seul car une main agrippe sa main. Il sait alors qu’il n’a jamais été seul, et qu’il ne le sera jamais. Le sol de la forêt est humide et spongieux sous ses pieds nus.
Il court, d’un pas léger, accompagné d’un invisible chœur harmonieux qui chante une note et la tient, la tient puis la gonfle en un crescendo parfait, jusqu’à ce qu’il débouche dans une clairière inondée de soleil. La musique envahit alors le cosmos, et se réverbère en une plénitude magique. Il se lance alors à plat ventre, agrippant la terre, le visage contre l’odorant tapis d’herbe. Il sent de ses deux mains la courbure de la planète, et il a conscience du palpitement intérieur du monde. C’est cela, l’extase ! C’est cela, le contact ! D’autres esprits entourent le sien. Dans quelque direction qu’il se dirige, il sent leur présence, leur soutien. Viens, disent-ils. Viens avec nous, ne sois qu’un avec nous, abandonne les lambeaux déchirés de ton moi, laisse partir tout ce qui te sépare encore de nous. Oui, répond Selig. Oui, j’affirme l’extase de la vie, j’affirme la joie du contact. Je m’abandonne à vous. Ils le touchent. Il les touche. C’est pour cet instant, pense-t-il, que j’ai reçu le don, mon bienfait, mon pouvoir. Pour cet instant d’accomplissement et d’affirmation. Viens avec nous. Viens avec nous. Oui ! Les oiseaux ! Le chœur invisible ! La rosée ! La prairie ! Le soleil ! Il éclate de rire. Il se relève et se lance dans une danse d’extase. Il rejette la tête en arrière pour chanter, lui qui de toute sa vie n’a jamais osé chanter, et les sons qui sortent de ses lèvres sont riches et pleins, purs et parfaitement timbrés. Oh, oui ! L’union, l’extase, le toucher, la sensation de ne faire qu’un avec toute chose ! Il n’est plus David Selig. Il fait partie d’eux, et ils font partie de lui. Dans cette communion joyeuse, il connaît la perte du moi, il laisse derrière lui tout ce qui est usé et fatigué et aigri en lui, il laisse ses peurs et ses incertitudes, il laisse tout ce qui l’a séparé de lui-même pendant tant d’années. Il émerge de l’autre côté. Il s’ouvre pleinement, et l’immense signal de l’univers s’engouffre librement en lui. Il reçoit. Il transmet. Il absorbe. Il irradie. Oui. Oui. Oui. Oui.
Il sait que cette extase durera toujours.
Mais à l’instant même où il réalise cela, il sent qu’elle est en train de lui échapper. Le chœur radieux s’éteint progressivement, le soleil décline vers l’horizon. La mer lointaine se retire, aspirant le rivage. Il lutte pour retenir la joie, mais plus il lutte, plus elle lui échappe. Empêcher l’océan de refluer ? Mais comment ? Retarder la tombée de la nuit ? Mais comment ? Mais comment ? Les chants d’oiseaux sont presque inaudibles maintenant. L’air est devenu froid. Tout s’éloigne vertigineusement de lui. Il reste seul dans l’obscurité qui s’assemble. Il se souvient de l’extase, il essaie de l’évoquer de nouveau, momentanément, de la revivre, car elle a déjà disparu et un terrible effort de volonté est nécessaire pour la re-capturer. Disparue. Oui. Soudain, tout est devenu très calme. Il entend un dernier son, un instrument dont on pince les cordes au loin, un violoncelle, peut-être, joué pizzicato, laissant entendre un joli son mélancolique. Dzong. L’accord plaintif. Dzing. La corde qui casse. Dzoung. La lyre désaccordée. Dzong. Dzing. Dzoung. Rien de plus. Le silence l’enveloppe. Un silence définitif, qui résonne dans les cavernes de son esprit, le silence qui fait suite à la rupture des cordes du violoncelle, le silence qui accompagne la mort de la musique. Il n’entend plus rien. Il ne sent plus rien. Il est seul. Il est seul.
Il est seul.
« Si calme », murmure-t-il. « Si retiré. C’est… si… retiré… ici. »
« Selig ? » interroge une voix profonde. « Que t’arrive-t-il, Selig ? »
« Je vais bien », répond Selig. Il essaie de se lever, mais plus rien n’est solide. Il s’écroule à travers le bureau du doyen, à travers le sol de la pièce, à travers la planète elle-même. Il cherche et ne trouve pas une plate-forme solide. « Si calme ! Le silence, Ted ! Le silence ! » Des bras vigoureux se saisissent de lui. Il a conscience de plusieurs silhouettes qui s’agitent autour de lui. Quelqu’un appelle un docteur. Selig secoue la tête, protestant qu’il va bien, que tout est normal, excepté le silence qui est dans sa tête, excepté le silence, le silence.
Excepté le silence.
L’hiver est là. Le ciel et la chaussée forment une bande de gris sans couture, inexorable. Il y aura bientôt de la neige. Pour une raison quelconque, le quartier est privé de ramassage des poubelles depuis trois ou quatre jours, et les sacs en plastique gonflés d’ordures s’amoncellent devant chaque porte d’immeuble. Cependant, il n’y a pas d’odeur dans l’air. Même les odeurs ne peuvent pas vivre sous ces températures. Le froid emporte la puanteur, chasse les signes de la réalité organique. Seul le béton triomphe ici. Le silence règne. Des chats gris et noirs efflanqués, immobiles, simples statues d’eux-mêmes, passent la tête du fond des impasses. La circulation est légère. Je parcours rapidement les rues qui séparent la station de subway de l’appartement de Judith, en détournant les yeux des rares passants que je croise. Je me sens timide et gêné parmi eux, comme un ancien combattant qui vient de sortir du centre de réhabilitation et que ses mutilations embarrassent. Naturellement, je suis absolument incapable de dire ce que les gens pensent. Leurs esprits me sont hermétiques maintenant, et ils me narguent avec leur bouclier de glace. Ironiquement, j’ai l’illusion qu’ils ont tous accès à moi. Ils peuvent me transpercer de leur regard et me voir tel que je suis devenu. Voilà David Selig, doivent-ils se dire. Comme il a été insouciant ! Quel pauvre gardien pour un tel don ! Il a gâché sa vie, et il l’a laissé échapper, le crétin. Et je me sens coupable de leur causer une telle déception. Pourtant, ma culpabilité n’est pas aussi grande qu’elle pourrait l’être. Il y a un niveau ultime où je m’en fiche éperdument. C’est ce que je suis, me dis-je à moi-même. C’est ce que je serai désormais. Si tu n’es pas content, c’est du pareil au même. Essaie de m’accepter. Si tu ne peux pas t’y résigner, fais comme si je n’existais pas.
« De même que la société la plus authentique se rapproche toujours davantage de la solitude, de même le meilleur discours finit par retomber dans le silence. Le silence est audible à tous les hommes, en tous temps et dans tous les lieux. » Ainsi disait Thoreau en 1849, dans Une semaine sur les fleuves Concord et Merrimack. Évidemment, Thoreau était un inadapté et un névrosé. Quand il était jeune, juste après avoir quitté l’université, il tomba amoureux d’une fille nommée Ellen Sewall, mais elle le laissa tomber, et il ne se maria jamais. Je me demande même s’il eut jamais des relations physiques avec quelqu’un. Probablement non. Je ne peux pas vraiment imaginer Thoreau en train de baiser. Et vous ? Oh, peut-être qu’il n’est pas mort puceau, mais je parie que sa vie sexuelle se réduisait à peu de chose. Peut-être qu’il ne se masturbait même pas. Vous l’imaginez, assis à côté de sa mare, en train de se tirer sur la glande ? Moi non. Pauvre Thoreau. Le silence est audible, Henry.
Читать дальше