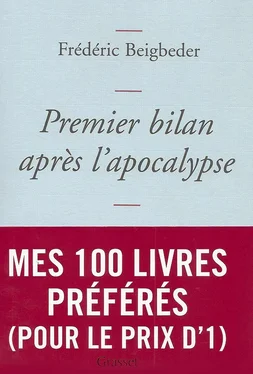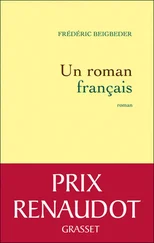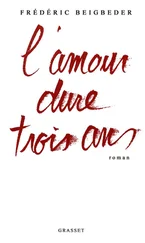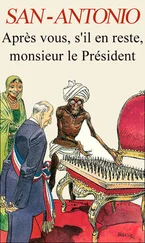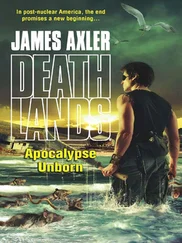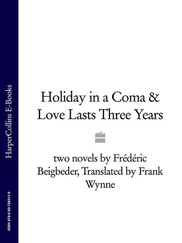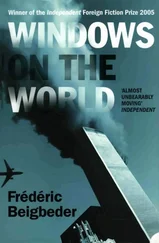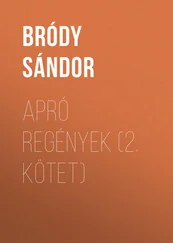Comme Blake Edwards vient de mourir, on peut le dire avec le maximum de lâcheté : le film Diamants sur canapé était absolument charmant mais c’est tout de même un acte de haute trahison. Il a transformé une satire qui pourrait s’intituler « Déchéance d’une escort girl » en comédie romantique morale. Le roman ne finit pas par un baiser sous la pluie, même s’il y a aussi une histoire de chat perdu. Capote voulait décrire une provinciale écervelée, une arriviste vénale, une pauvre cynique détruite par son cynisme. La sottise hilarante de Holly masque une douleur profonde : son frère Fred meurt à la guerre pendant le livre, l’action se déroule en 1943, en fait elle se nomme Lulamae Baraes et elle est mariée depuis l’âge de 14 ans à un vétérinaire du Texas. Capote décrit une société dissolue, de jeunes étourdis qui dansent pour oublier que leur pays bombarde l’Europe et le Japon. En une série de soirées superficielles, Capote tourne en dérision tous les mensonges de la Grande Ville. Le roman influencera autant Jay Mclnerney que Gossip girl. Par moments, Breakfast at Tiffany’s semble un pastiche d’une nouvelle de Fitzgerald : quand elle se plaint des types saouls qui lui mordent l’épaule, Holly Golightly (nom de famille signifiant « va avec légèreté ») évoque la « flapper » du Pirate de haute mer, un de mes personnages préférés du grand Scott, une ravissante pétasse dénommée Ardita Farnam qui criait sur son yacht : « J’en ai assez de tous ces jeunes idiots qui passent leurs heures de loisirs à me courir après d’un bout à l’autre du pays ! »
Peu importe après tout que les spectateurs du film se soient trompés sur son compte. Je suis sûr que Holly Golightly a existé, qu’elle existe encore. Nous avons tous rencontré des jolies filles dont la tête ne tourne que si l’on déverse des cadeaux à leurs pieds. Truman Capote l’a peut-être imaginée, ou bien peut-être était-ce lui, cette menteuse qui fuyait ses origines fermières dans les mondanités, qui sait ? J’adore ce que Holly dit sur Tiffany’s : dès qu’elle a le cafard, elle prend un taxi et se rend dans le magasin. Tiffany’s est son Lexomil. « On a l’impression que rien de très mauvais ne pourrait vous atteindre là, avec tous ces vendeurs aimables et si bien habillés. Et cette merveilleuse odeur d’argenterie et de sacs en crocodile. » Chaque fois que je descends la 5e Avenue à New York, ou même la rue de la Paix à Paris, et que je passe devant la vitrine scintillante de cet antidépresseur de luxe, je songe à cette créature imaginaire qui « brillait comme une enfant de verre ». Holly est inoubliable, et le plus insupportable chez elle, c’est qu’on n’arrive jamais à la détester. Créer un aussi beau personnage de femme devrait être le rêve de tout romancier.
Truman Capote, une vie
Comme Holly Golightly, ce n’est pas son vrai nom : Truman Capote s’appelait Truman Streck-fus Persons. « Mon nom est Persons ! » « Capote » est le nom de son beau-père cubain. Né en 1924 à La Nouvelle-Orléans (qui est la plus belle ville des États-Unis), il est mort soixante ans après à Los Angeles. La Harpe d’herbes (1951) raconte son enfance en Alabama chez ses cousines. Mais c’est grâce à une romance entre un apprenti-écrivain homo et sa voisine du dessous lesbienne et nymphomane épatée par le strass qu’il deviendra célèbre en 1958 : Petit déjeuner chez Tiffany (le film de Blake Edwards est sorti trois ans plus tard). Pour se faire pardonner ce succès d’apparence futile, il écrit ensuite De sang-froid sur un quadruple meurtre dans le Kansas (1966). C’est prétendument le premier roman de non-fiction (même si Stendhal et Flaubert s’étaient inspirés de faits divers bien avant lui). Il donne un bal masqué noir et blanc au Plaza de New York le 28 novembre 1966 auquel j’aurais bien aimé être invité, même si je n’avais qu’un an et deux mois. Puis il sombre dans l’alcool et la cocaïne et meurt d’une overdose de médicaments, ce qui donne moins envie de l’imiter.
Numéro 16 : « Ivre du vin perdu » de Gabriel Matzneff (1981)
Dandy monastique, voluptueux ascétique, libertin orthodoxe… Toute sa vie, le principal talent de Matzneff ne fut pas de survivre à ses contradicteurs mais à ses contradictions internes. Attirons-nous d’entrée l’opprobre général en abordant de front ce que la morale (et son corollaire la police) lui reproche : une œuvre supposément autobiographique qui fait l’éloge des jeunes filles de « moins de seize ans ». Selon moi, les choses sont très simples : il faut séparer l’art de la loi. Tant qu’on ne me prouvera pas que Matzneff est Marc Dutroux, alors qu’on lui flanque la paix comme à Nabokov, Balthus ou Serge Gainsbourg (rappelons l’âge de Melody Nelson dans sa plus belle chanson : « Quatorze automnes et quinze étés »). Faut-il rappeler l’existence de Thomas Mann, André Gide, Ronsard et Montherlant, génies tous fascinés par la beauté de l’adolescence ? L’art doit rester libre, que diable ! Si l’art respecte la loi, il ne raconte plus rien d’intéressant. Il y a une saine différence entre un lecteur et un flic. Un écrivain a le devoir de désobéir aux règles, et son lecteur n’est pas obligé de le dénoncer au commissariat. Par ailleurs, qu’on ne s’y trompe pas : les cent auteurs cités dans ce livre ont tous treize ans. Un romancier est toujours un enfant qui joue. Simplement la plupart couchent avec des personnes plus âgées qu’eux.
Ivre du vin perdu commence par une lettre adressée à Nil, écrivain de 43 ans, par une lycéenne qui s’écrie : « J’ai dix-sept ans demain, la mort ! » Si ce n’est pas là tendre, tel le Christ, des verges pour se faire battre… Ce roman romantique évoque la passion et le désamour de l’été 72 (quand Tatiana a cessé d’aimer l’auteur) : il est la suite de Isaïe réjouis-toi (1974). C’est un roman sur l’échec d’un amour. Il est entièrement tourné vers le passé ; c’est l’histoire d’une vie dans laquelle une sale gamine a fait de merveilleux dégâts. Relisant les lettres enflammées de son ex (« J’aime mon amour pour toi, qui est la seule belle chose que je possède, j’aime ta langue pomme d’api, ton sexe sucre d’orge, tes yeux d’azur, tes cils d’or fin, ta tendresse timide, j’aime ta gaîté et ta mélancolie, tes lèvres ouvertes dans le plaisir (…) Nil, je vous aime à la folie, vous êtes mon île au trésor »), le héros soupire : « Comme nous nous aimions, Seigneur ! » Ce soupir est une splendeur qui fend le cœur. Matzneff est-il un épouvantable libertin dégoûtant ou un incurable amoureux torturé par des bébés ? Les deux, mon capitaine. Et c’est ce qui le rend incapable de vieillesse.
J’aime que toute l’action se passe dans quelques pâtés de maisons proches de mon domicile ; Matzneff a choisi de situer son roman dans le quartier de l’Odéon, où se croisent figures historiques et personnages de fiction (Athos rue Férou, Porthos rue du Vieux-Colombier, Aramis rue Servandoni, Casanova rue de Tournon, et n’oublions jamais que c’est à l’angle de la rue Férou et de la rue de Vaugirard que Madame de La Fayette a écrit La Princesse de Clèves), mais surtout Nil réside dans un grenier au sixième étage d’un immeuble de la rue Monsieur-le-Prince… où j’ai vécu de 7 à 12 ans ; sa fiancée perdue est élève du lycée Montaigne… où j’ai étudié de la sixième à la seconde. Bref, je ne suis pas objectif. Mais je ne suis pas là pour l’être. Matzneff apprécie les coutumes bizarroïdes de mon quartier d’enfance (dîner à la Closerie ou chez Lipp), et ses lieux de culte (l’église Saint-Sulpice, l’hôtel Taranne, le lycée Fénelon, les cinémas Cluny et Bonaparte, le jardin du Luxembourg). Dès que les passions amoureuses virent au vaudeville, son héros fiche le camp à Manille sodomiser des enfants ou en Suisse perdre quelques kilos.
Читать дальше