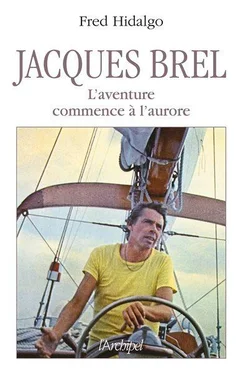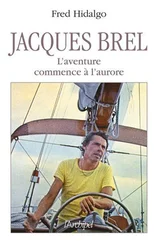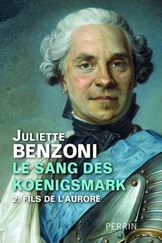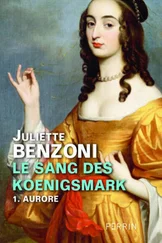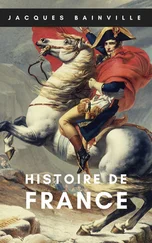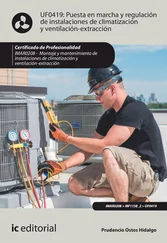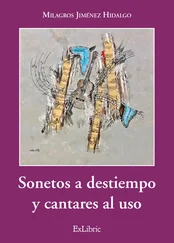En avril 1975, Jacques et Maddly sont aux Grenadines lorsqu’ils rencontrent fortuitement Pierre Perret et sa famille à bord d’un grand voilier de location, l’auteur du Zizi (sorti fin 1974) ayant décidé de faire une pause dans sa carrière : « Nous sommes partis bourlinguer quelques semaines après la sortie de l’album du Zizi ! », écrit-il dans ses mémoires [135] Pierre Perret, op. cit.
en ajoutant par erreur que cela fait déjà « un peu plus de deux ans — une overdose de vacances ! », alors qu’il n’y a pas six mois que son album est paru. Peut-être confond-il cette première rencontre en mer (au cours de laquelle il fait la connaissance de la Doudou) avec des retrouvailles inattendues à Rangiroa, vers novembre 1976. C’est d’autant plus probable qu’il fait dire à Jacques : « J’écris en ce moment. J’en chie ! », alors que celui-ci ne reprendra vraiment l’écriture qu’en septembre 1976, un an et demi plus tard, une fois installé à Hiva Oa ; et que, toujours selon Perret, Brel lui demande : « Quand pourrez-vous venir nous voir à Hiva Oa ? »… alors qu’ils sont à peine en partance, lui et Maddly, pour Panamá et qu’en aucun cas, jusque-là, il ne leur est venu à l’esprit d’interrompre leur tour du monde et encore moins de s’installer aux Marquises.
Toujours est-il qu’en 1998, dans la préface que je lui avais proposé d’écrire pour le livre de Marc Robine [136] Marc Robine, op. cit.
, sachant son amitié pour le Grand Jacques, Pierre Perret témoignait de cette rencontre inattendue : « Quelle éblouissante journée nous avions passée à refaire le monde ensemble ! Après avoir offert, à lui, à la Doudou et aux miens, un mémorable blaff d’oursins au montrachet, qui les avait époustouflés, nous avions repris tous nos souvenirs à zéro, Jacques et moi. » Une journée sur laquelle il reviendra donc, dix ans plus tard : « Jacques semblait plein d’amertume, surtout à cause de ce harcèlement ininterrompu des “rats”, ces paparazzi dont il était la victime depuis l’annonce de sa maladie. “Ils me font chier ! disait-il d’un ton fataliste. Il n’y a qu’en mer qu’on est peinards ! Et encore !” » Et le chapitre intitulé laconiquement « Jacques Brel » s’achève ainsi : « Sur le rafiot qui les ramenait à leur bateau, Jacques, debout, se retourna vers nous et s’adressa à moi avec ses mains en porte-voix : “Pierrot, dit-il, quand tu verras Lama, dis-lui qu’il me reste encore un poumon !” »
Quelques semaines après ces retrouvailles, en mai 1975, Jacques Brel rentre en Europe avec sa compagne pour subir, à la clinique Édith-Cavell de Bruxelles, des examens de contrôle dont se chargera le professeur Charles Nemry, le chirurgien qui l’a opéré en novembre 1974, assisté d’Arthur Gélin. Ils ont mouillé entre-temps à La Guaira, près de Caracas, avant de laisser l’ Askoy , dans la toute récente marina de Carabellada, aux bons soins de Vic et Prisca. Les résultats sont bons, les craintes de récidive écartées. Le couple en profite pour passer quelques jours à Paris, chez Charley Marouani. France-Soir l’apprend, qui consacre un article au chanteur, le 24 mai, en le citant ; il se plaint encore et toujours d’avoir des journalistes à ses trousses et assure qu’il n’a plus envie de travailler.
Il s’empresse donc de regagner Caracas dont il apprécie le caractère exotique (« Les soirs où je suis Caracas / Je Panamá, je Partagas [137] Des néologismes typiquement bréliens, expliquera Marc Robine, « pour décrire une situation en deux mots, sans avoir besoin de plus amples explications. Le panamá est un chapeau et le partagas un cigare ; avec ces deux accessoires, tout le personnage est campé ».
/ Je suis le plus beau, je pars en chasse / Je glisse de palace en palace [138] Knokke-le-Zoute tango , 1977 © Famille Brel.
»), puis le mouillage où patiente son bateau, d’où, le 9 juin, il écrit à nouveau à Charley et à son épouse France : « Comment te dire merci ? Nous avons été, les enfants, émerveillés par votre hospitalité ! […] Nous avons retrouvé l’ Askoy bien vieilli. Alors on frotte, on lave, on repasse, avant de retrouver la fraîcheur des îles et les poissons de toutes les couleurs. » Comme il l’avait noté, juste avant de quitter le port d’Anvers, en entame de son journal de bord : « Le bateau commence à frémir et je crois bien qu’il croit bien qu’il a un peu envie de partir. Je lui dis de rester calme, mais il me fait tout de même un peu la tête. » Un livre de bord sur lequel Jacques Brel, rassuré sur son état de santé, note cette fois : « Le capitaine est OK pour six mois. »
Adieu le Venezuela : l’ Askoy met le cap sur Panamá, faisant escale dans les îles des Petites Antilles néerlandaises de Bonaire et de Curaçao où l’accueil des autorités, malgré le fait que Brel parle assez bien la langue, est proprement détestable. « Après s’être copieusement enguirlandé, en flamand, avec le fonctionnaire de service, rapporte Marc Robine, Jacques quittera le port en pleine nuit, à la sauvette, de peur de voir son bateau cloué à quai par décision administrative. » L’approche du canal, ensuite, est délicate et dangereuse pour des petits bateaux comme l’ Askoy et le Kalais (qui continuent de voguer dans le sillage l’un de l’autre), « de très gros porteurs convergeant jour et nuit vers un goulot d’étranglement, aux abords duquel la densité du trafic vire au cauchemar ». Nouvelle et longue escale, obligatoire cette fois pour les formalités administratives d’entrée dans le canal, au port de Colon.
Près d’un mois s’écoule à quai, le temps de régler aussi le nécessaire et l’indispensable avant d’entreprendre la grande traversée — « le temps de refaire l’avitaillement du bord, de réviser l’accastillage du bateau, d’étudier les cartes pour arrêter la route à suivre ». Et le passage de l’isthme, enfin, peut avoir lieu. Il se déroule sans encombres, à cela près « qu’il faut veiller, à chaque écluse, à ne pas être écrasé contre les parois de béton par les lourds cargos que les remous de la manœuvre, parfois, rendent un peu trop câlins ». Voilà notre cathédrale « de clinfoc et de grand-voiles », après avoir franchi le canal, ancrée au port de Balboa où, le 3 septembre 1975, son capitaine écrit à Charley : « Je lève l’ancre dans vingt jours et, bien sûr, c’est le bordel à bord, comme toujours avant les longues routes. Le climat est dur ici, il pleut beaucoup et la chaleur est pénible. Mais à bord, toujours le bonheur ! Miche me signale les rumeurs de l’Europe et ma mort annoncée me fait rire. Les journalistes sont de doux poètes ! J’aimerais savoir si tu viens cet hiver. Moi, je crois donc rentrer en janvier pour le test médical… »
Charley répondra présent. Comme toujours. Réputé pour la confiance qui l’unissait à « ses » artistes (Adamo, Barbara, Gréco, Montand, Nougaro, Reggiani, Salvador…), Charley Marouani — le neveu de Félix, le fondateur de la dynastie (« Quand je n’arrive pas à dormir, plaisantait Brel, je compte les Marouani ! ») — avait toujours refusé de parler de ses relations avec eux. L’âge aidant et le devoir de mémoire se faisant pressant, il a fini par publier ses souvenirs, où le personnel et le professionnel se mêlent inévitablement. Un témoignage [139] Charley Marouani, Une vie en coulisses ( op. cit. ), dont sont tirés ici des extraits de sa correspondance avec Brel.
aussi captivant que riche d’infos pour l’histoire de la chanson, qui s’ouvre et se referme sur Jacques Brel, signe de l’importance de cet artiste entre tous ; alors même que, depuis ses adieux à la scène, Charley n’avait plus rien à attendre de lui.
Читать дальше