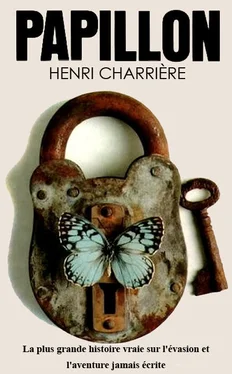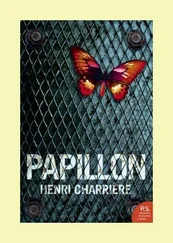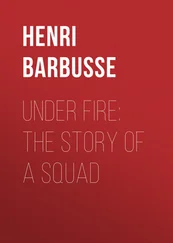— Papi, laisse que je t’embrasse. Je suis content de pouvoir te rendre un grand service à toi et à ton ami : vous êtes internés tous les deux… Oh ! laisse-moi parler ! Toi, Papillon, à vie, et toi, Dega, à cinq ans. Vous avez du pognon ?
— Oui.
— Alors donnez-moi cinq cents francs chacun et demain matin vous serez hospitalisés, toi pour dysenterie. Et toi, Dega, dans la nuit frappe à la porte ou, mieux que ça, que quelqu’un de vous appelle le gaffe et réclame l’infirmier en disant que Dega s’étouffe. Le reste je m’en charge. Papillon, je te demande qu’une chose : si tu te casses, fais-moi avertir à temps, je serai au rendez-vous. A l’hôpital, pour cent francs chacun par semaine, ils vont pouvoir vous garder un mois. Faut faire vite.
Fernandez ressort du cabinet et remet devant nous cinq cents francs à Sierra. Moi je rentre au cabinet et quand je ressors, je lui remets non pas mille mais mille cinq cents francs. Il refuse les cinq cents francs. Je ne veux pas insister. Il me dit :
— Ce pognon que tu me donnes, c’est pour le gaffe. Moi, je ne veux rien pour moi ? On est des amis, non ?
Le lendemain, Dega, moi et Fernandez, nous sommes dans une cellule immense à l’hôpital. Dega a été hospitalisé au milieu de la nuit. L’infirmier de la salle est un homme de trente-cinq ans, on l’appelle Chatal. Il a toutes les instructions de Sierra pour nous trois. Quand le docteur passera, il présentera un examen de selles ou j’apparaîtrai pourri d’amibes. Pour Dega, dix minutes avant la visite, il fait brûler un peu de soufre qu’on lui a fourni et lui fait respirer le gaz avec une serviette sur la tête. Fernandez a une joue énorme : il s’est piqué la peau à l’intérieur de la joue et a soufflé le plus possible pendant une heure. Il l’a fait si consciencieusement, l’enflure est telle qu’elle lui bouche un œil. La cellule est au premier étage d’un bâtiment, il y a près de soixante-dix malades, dont beaucoup de dysenterie. Je demande à l’infirmier où est Julot. Il me dit :
— Juste dans le bâtiment en face. Tu veux que je lui dise quelque chose ?
— Oui. Dis-lui que Papillon et Dega sont là, qu’il se mette à la fenêtre.
L’infirmier entre et sort quand il veut de la salle. Pour cela il n’a qu’à frapper à la porte et un Arabe lui ouvre. C’est un « porte-clef », un bagnard qui sert d’auxiliaire aux surveillants. Sur des chaises, à droite et à gauche de la porte, sont assis trois surveillants, mousqueton sur les genoux. Les barreaux des fenêtres sont des rails de chemin de fer, je me demande comment on va faire pour couper ça. Je m’assieds à la fenêtre.
Entre notre bâtiment et celui de Julot, il y a un jardin plein de jolies fleurs. Julot apparaît à la fenêtre, une ardoise à la main sur laquelle il a écrit à la craie : BRAVO. Une heure après, l’infirmier m’apporte une lettre de Julot. Il me dit : « Je cherche à aller dans ta salle. Si j’échoue, essayez de venir dans la mienne. Le motif c’est que vous avez des ennemis dans votre salle. Alors vous êtes internés ? Courage, on les aura. » L’incident de la Centrale de Beaulieu où nous avons souffert ensemble nous a liés beaucoup l’un à l’autre. Julot était le spécialiste de la masse de bois, c’est pour cela qu’il était surnommé l’homme au marteau. Il arrivait en voiture devant une bijouterie, en plein jour, au moment où les plus beaux bijoux étaient en devanture dans leurs écrins. La voiture, conduite par un autre, s’arrêtait moteur en marche. Il descendait rapidement muni d’une grosse masse de bois, défonçait la vitrine d’un grand coup, prenait le plus d’écrins possible et remontait dans la voiture qui démarrait sur les chapeaux de roue. Après avoir réussi à Lyon, Angers, Tours, Le Havre, il s’attaqua à une grande bijouterie de Paris, à trois heures de l’après-midi, emportant près d’un million de bijoux. Il ne m’a jamais raconté pourquoi et comment il avait été identifié. Il fut condamné à vingt ans et s’évada au bout de quatre. Et c’est en rentrant à Paris, comme il nous l’avait raconté, qu’il fut arrêté : il cherchait son receleur pour l’assassiner car celui-ci n’avait jamais remis à sa sœur une grosse quantité d’argent qu’il lui devait. Le receleur le vit rôder dans la rue où il habitait et avertit la police, Julot fut pris et retourna au bagne avec nous.
Voici une semaine que nous sommes à l’hôpital. Hier, j’ai remis deux cents francs à Chatal, c’est le prix par semaine pour nous maintenir tous les deux à l’hôpital. Pour nous faire estimer, nous donnons du tabac à tous ceux qui n’en n’ont pas. Un dur de soixante ans, un Marseillais nommé Carora, s’est fait ami avec Dega. Il est son conseiller. Il lui dit plusieurs fois par jour que s’il a beaucoup d’argent et que ça se sait au village (par les journaux qui arrivent de France on sait les grosses affaires), il vaut mieux qu’il ne s’évade pas parce que les libérés vont le tuer pour lui voler le plan. Le vieux Dega me fait part de ces conversations avec le vieux Carora. J’ai beau lui dire que le vieux est certainement un bon à rien puisqu’il y a vingt ans qu’il est là, il ne me fait pas cas. Dega est très impressionné des racontars du vieux et j’ai de la peine à le soutenir de mon mieux et de ma foi.
J’ai fait passer un billet à Sierra pour qu’il m’envoie Galgani. C’est pas long. Le lendemain Galgani est à l’hôpital, mais dans une salle sans barreaux. Comment faire pour lui remettre son plan ? Je fais part à Chatal de la nécessité impérieuse que j’ai de parler avec Galgani, je lui laisse croire que c’est une préparation de cavale. Il me dit qu’il peut me l’amener cinq minutes à midi précis. A l’heure du changement de garde, il le fera monter sur la véranda et parler avec moi à la fenêtre, et cela pour rien. Galgani m’est amené à la fenêtre à midi, je lui mets directement le plan dans les mains. Il se le met debout devant moi, il pleure. Deux jours après, je recevais une revue de lui avec cinq billets de mille francs et un seul mot : Merci.
Chatal, qui m’a remis le magazine, a vu l’argent. Il ne m’en parle pas mais moi je veux lui offrir quelque chose, il refuse. Je lui dis :
— Nous voulons nous en aller. Veux-tu partir avec nous ?
— Non, Papillon, je suis engagé ailleurs, je ne veux essayer l’évasion que dans cinq mois, quand mon associé sera libéré. La cavale sera mieux préparée et ce sera plus sûr. Toi, comme tu es interné, je comprends que tu sois pressé, mais d’ici, avec ces barreaux, ça va être très dur. Ne compte pas sur moi pour t’aider, je ne veux pas risquer ma place. Ici, j’attends tranquille que mon ami sorte.
— Très bien, Chatal. Il faut être franc dans la vie je ne te parlerai jamais de rien.
— Mais quand même, dit-il, je te porterai les billets et te ferai les commissions.
— Merci, Chatal.
Celte nuit, on a entendu des rafales de mitraillette. C’est, on l’a su le lendemain, l’homme au marteau qui s’est évadé. Que Dieu l’aide, c’était un bon ami. Il a dû avoir une occasion et en a profilé. Tant mieux pour lui.
Quinze ans après, en 1948, je suis à Haïti où, accompagné d’un millionnaire vénézuélien, je viens traiter avec le président du Casino un contrat pour y tenir le jeu. Une nuit que je sors d’un cabaret où on a bu du Champagne, une des filles qui nous accompagne, noire comme du charbon mais éduquée comme une provinciale de bonne famille française, me dit :
— Ma grand-mère qui est prêtresse du vaudou, vit avec un vieux français. C’est un évadé de Cayenne, il y a vingt ans qu’il est avec elle, il se soûle tout le temps, il s’appelle Jules Marteau.
Je me dessoûle d’un seul coup :
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу