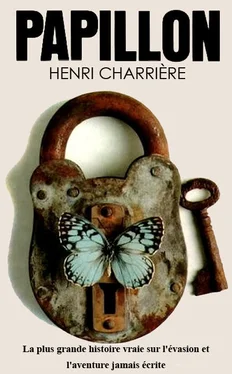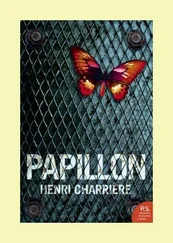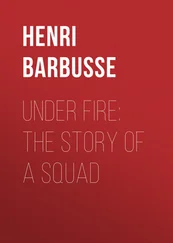Les surveillants se sont retirés au fond du plateau. Au milieu, Barrot, les autres auprès de l’escalier. En face d’eux, en ligne, les six hommes à poil au garde-à-vous.
— Ça, c’est à celui-ci, dit le gaffe qui a fait la fouille, en prenant un couteau et en désignant le propriétaire.
— C’est vrai, c’est à moi.
— Bon, dit Barrot. Il fera le voyage en cellule sur les machines.
Chacun est désigné soit pour les clous, soit pour le tire-bouchon, soit pour les couteaux, et chacun reconnaît être le propriétaire des objets trouvés. Chacun d’eux, toujours à poil, monte les escaliers, accompagné de deux gaffes. Reste par terre un couteau et le plan en or ; un seul homme pour les deux. Il est jeune, vingt-trois ou vingt-cinq ans, bien bâti, un mètre quatre-vingts au moins, un corps athlétique, des yeux bleus.
— C’est à toi, ça, n’est-ce pas ? dit le gaffe, et il tend le plan en or.
— Oui, c’est à moi.
— Qu’est-ce qu’il contient ? dit le commandant Barrot qui l’a pris dans ses mains.
— Trois cents livres anglaises, deux cents dollars et deux diamants de cinq carats.
— Bien, on va voir. » Il ouvre. Comme le commandant est entouré par les autres, on ne voit rien mais on l’entend dire : « C’est exact. Ton nom ? »
— Salvidia Roméo.
— Tu es italien ?
— Oui, Monsieur.
— Tu ne seras pas puni pour le plan, mais pour le couteau, si.
— Pardon, le couteau n’est pas à moi.
— Ne dis pas ça, voyons, je l’ai trouvé dans tes chaussures, dit le gaffe.
— Le couteau n’est pas à moi, je le répète.
— Alors je suis un menteur ?
— Non, vous vous trompez.
— Alors, à qui est le couteau ? dit le commandant Barrot. S’il n’est pas à toi, il est bien à quelqu’un ?
— Il n’est pas à moi, c’est tout.
— Si tu ne veux pas être mis au cachot où tu vas cuire, car ils sont au-dessus des chaudières, dis à qui est le couteau.
— Je ne sais pas.
— Tu te fous de ma gueule ? On trouve un couteau dans tes chaussures et tu ne sais pas à qui il est ? Tu me prends pour un imbécile ? Ou il est à toi, ou tu sais qui l’a mis là. Réponds.
— Il n’est pas à moi et ce n’est pas à moi de dire à qui il est. Je ne suis pas un mouchard. Est-ce que vous me voyez une gueule de garde-chiourme, par hasard ?
— Surveillant, passez les menottes à ce type-là. Tu vas payer cher cette manifestation d’indiscipline.
Les deux commandants parlent entre eux, celui du bateau et celui du convoi. Le commandant du bateau donne un ordre à un second maître qui monte en haut. Quelques instants après, arrive un marin breton, véritable colosse, avec un seau en bois plein d’eau de mer sans doute et une grosse corde de la grosseur du poignet. On attache l’homme à la dernière marche d’escalier, à genoux. Le marin trempe sa corde dans le seau puis il frappe lentement, de toutes ses forces, sur les fesses, les reins et le dos du pauvre diable. Pas un cri ne sort de ses lèvres, le sang coule des fesses et des côtes. Dans ce silence de cimetière, il part un cri de protestation de notre cage :
— Bande de salopards !
C’était tout ce qu’il fallait pour déclencher les cris de tout le monde : « Assassins ! Salauds ! Pourris ! » Plus on menace de nous tirer dessus si on ne se tait pas, plus on hurle, quand tout à coup le commandant crie :
— Mettez la vapeur !
Des matelots tournent des roues et des jets de vapeur arrivent sur nous avec une telle puissance qu’en moins de deux tout le monde est à plat ventre. Les jets de vapeur étaient projetés à la hauteur de poitrine. Une peur collective s’empara de nous. Les brûlés n’osaient pas se plaindre, cela ne dura même pas une minute, mais terrorisa tout le monde.
— J’espère que vous avez compris, les fortes têtes ? Au moindre incident, je fais envoyer la vapeur. Entendu ? Levez-vous !
Seuls trois hommes ont été vraiment brûlés. On les emmena à l’infirmerie. Le flagellé fut remis avec nous. Six ans après il mourrait dans une cavale avec moi.
Pendant ces dix-huit jours de voyage, nous avons le temps de nous renseigner ou d’essayer d’avoir un aperçu du bagne. Rien ne se passera comme on l’aura cru et pourtant Julot aura fait son possible pour nous informer. Par exemple, nous savons que Saint-Laurent-du-Maroni est un village à cent vingt kilomètres de la mer sur un fleuve qui s’appelle Maroni. Julot nous explique :
— C’est dans ce village que se trouve le pénitencier, le centre du bagne. Dans ce centre s’effectue le triage par catégorie. Les relégués vont directement à cent cinquante kilomètres de là, dans un pénitencier nommé Saint-Jean. Les bagnards sont immédiatement classés en trois groupes :
«— Les très dangereux, qui seront appelés dans l’heure même de l’arrivée et mis dans des cellules au quartier disciplinaire en attendant leur transfert aux Iles du Salut. Ils y sont internés à temps ou à vie. Ces Iles sont à cinq cents kilomètres de Saint-Laurent et à cent kilomètres de Cayenne. Elles s’appellent : Royale ; la plus grande, Saint-Joseph, où se trouve la Réclusion du bagne ; et le Diable, la plus petite de toutes. Les bagnards ne vont pas au Diable, sauf de très rares exceptions. Les hommes qui sont au Diable sont des bagnards politiques ;
«— Puis les dangereux de deuxième catégorie : ils resteront sur le camp de Saint-Laurent et seront astreints à des travaux de jardinage et à la culture de la terre. Chaque fois qu’on en a besoin, on les envoie dans des camps très durs : Camp Forestier, Charvin, Cascade, Crique Rouge, Kilomètre 42, dit le camp de la mort ;
«— Puis la catégorie normale : ils sont employés à l’Administration, aux cuisines, au nettoyage du village et du camp ou à différents travaux : atelier, menuiserie, peinture, forge, électricité, matelasserie, tailleur, buanderie, etc.
« Donc l’heure H, c’est celle de l’arrivée : si on est appelé et conduit en cellule, c’est qu’on est interné aux Iles, ce qui enlève tout espoir de s’évader. Une seule chance : vite se blesser, s’ouvrir les genoux ou le ventre pour aller à l’hôpital et, de là, s’évader. Il faut à tout prix éviter d’aller aux Iles. Autre espoir : si le bateau qui doit emporter les internés aux Iles n’est pas prêt à faire le voyage, alors il faut sortir de l’argent et l’offrir à l’infirmier. Celui-ci vous fera une piqûre d’essence de térébenthine dans une jointure, ou passera un cheveu trempé dans de l’urine dans la chair pour que cela s’infecte. Ou il te passera du soufre pour que tu le respires, puis dira au docteur que tu as 40° de fièvre. Pendant ces quelques jours d’attente, il faut aller à l’hôpital à n’importe quel prix.
« Si on n’est pas appelé et qu’on est laissé avec les autres dans des baraques sur le camp, on a le temps d’agir. Dans ce cas, il ne faut pas rechercher un emploi à l’intérieur du camp. Il faut payer le comptable pour avoir au village une place de vidangeur, balayeur, ou être employé à la scierie d’un entrepreneur civil. En sortant travailler hors du pénitencier et en rentrant chaque soir au camp, on a le temps de prendre contact avec des forçats libérés qui vivent dans le village ou avec des Chinois pour qu’ils te préparent la cavale. Eviter les camps autour du village : tout le monde y crève vite ; il y a des camps où aucun homme n’a résisté trois mois. En pleine brousse les hommes sont obligés de couper un mètre cube de bois par jour.
Tous ces renseignements précieux, Julot nous les a remâchés tout le long du voyage. Lui, il est prêt. Il sait qu’il va directement au cachot comme retour d’évasion. Aussi il a un tout petit couteau, plutôt un canif, dans son plan. A l’arrivée, il va le sortir et s’ouvrir le genou. En descendant du bateau il tombera de l’échelle devant tout le monde. Il pense qu’il sera transporté directement du quai à l’hôpital. C’est d’ailleurs exactement ce qui se passera.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу