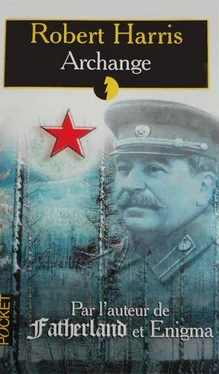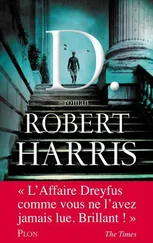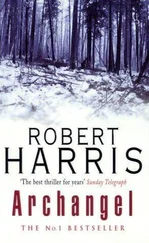Le couteau s’enfonça.
Kelso se réveilla en sursaut, un cri coincé dans la gorge, les yeux écarquillés, le mince drap bouchonné et serré entre ses mains trempées de sueur. Le compartiment qui oscillait doucement était vide au-dessus de lui, et la pénombre bleutée se teintait de gris. Il resta un instant immobile. Il entendait O’Brian respirer profondément, et, lorsqu’il finit par se retourner, il le vit, tête renversée, bouche ouverte, un bras pendant presque jusqu’au sol, l’autre posé en travers du front.
Il lui fallut encore deux bonnes minutes pour que sa panique s’apaise. Il leva le bras au-dessus de sa tête pour soulever un coin du rideau et regarder sa montre. Il se croyait encore au milieu de la nuit, mais il découvrit avec surprise qu’il était déjà sept heures passées. Il avait dormi pendant pratiquement neuf heures.
Il se souleva sur un coude et écarta un peu plus le rideau pour voir aussitôt la tête de Staline flotter vers lui, isolée dans l’aube pâle, au bord de cette voie ferrée. Elle arriva au niveau de la fenêtre puis s’éloigna rapidement.
Kelso resta devant la fenêtre, mais ne vit plus rien d’autre, juste la terre pelée au-delà des rails et le faible éclat des lignes électriques qui semblaient plonger et se soulever, plonger et se soulever entre les pylônes, au rythme du train qui avançait encore. Il ne neigeait pas ici, mais le ciel naissant présentait comme un vide froid et décoloré.
Il comprit alors que quelqu’un avait dû brandir un portrait. Brandir un portrait de Staline.
Il laissa retomber le rideau et balança d’une secousse ses jambes hors de la couchette. Doucement, afin de ne pas réveiller O’Brian, il enfila ses bottes en caoutchouc et ouvrit prudemment la porte sur le couloir désert. Il regarda des deux côtés : personne. Il ferma le loquet derrière lui et se dirigea vers l’arrière du train.
Il traversa une voiture vide identique à celle qu’il venait de quitter, sans cesser de jeter des coups d’œil sur le paysage qui défilait, puis la classe « douce » céda la place à la « dure ». Le train devenait soudain beaucoup plus peuplé : deux rangées de couchettes dans des compartiments ouverts d’un côté du couloir, une seule rangée dans le sens de la longueur de l’autre. Soixante personnes par voiture. Des bagages entassés partout. Des passagers assis, en train de bâiller, les yeux rouges. D’autres en train de ronfler, insensibles au réveil général. Des gens qui faisaient la queue devant les toilettes nauséabondes. Une mère qui changeait la couche sale de son bébé (il sentit l’odeur aigre des selles lactées en passant). Des fumeurs qui se pressaient devant les fenêtres ouvertes, tout au bout du wagon. Le parfum âcre du tabac sans filtre. La fraîcheur bienfaisante de l’air qui s’engouffrait.
Il traversa ainsi quatre voitures « dures » et se trouvait au seuil de la cinquième, ayant décidé que ce serait la dernière (il avait conclu qu’il s’était inquiété pour rien et qu’il devait avoir rêvé puisque la campagne était déserte), quand il vit un autre portrait. Ou plutôt, comme il ne tarda pas à s’en apercevoir, il vit deux portraits s’avancer vers lui, l’un de Staline, l’autre de Lénine, brandis par un couple de vieillards, l’homme bardé de médailles, qui se tenait sur un talus. Le train ralentissait pour l’entrée en gare, et Kelso les vit très distinctement : deux visages tannés, ridés, presque bruns, épuisés. Puis, deux secondes plus tard, il les vit se tourner, soudain rajeunis de plusieurs années, souriant et saluant quelqu’un qu’ils venaient de repérer dans la voiture où Kelso se préparait à entrer.
Le temps parut ralentir avec le train, comme dans un rêve. Une rangée de cheminots en veste matelassée, appuyés sur leurs pics et leurs pelles, levèrent leur poing ganté en signe de salut. La voiture s’assombrit lorsqu’elle s’approcha du quai. Kelso entendit de la musique, étouffée par le crissement métallique des freins : à nouveau le vieil hymne national soviétique…
Parti de Lénine !
Parti de Staline !
… et un petit orchestre en uniforme bleu pâle dériva devant la fenêtre.
Le train s’immobilisa dans un soupir de pneumatiques, et Kelso put lire une pancarte : vologda. Sur le quai, des gens lançaient des acclamations. D’autres accouraient.
Il ouvrit la porte de la voiture et là, juste en face de lui, à moins de douze pas, il trouva le Russe, endormi, toujours vêtu de l’uniforme de son père, sa valise hissée sur le porte-bagages au-dessus de sa tête. Les voyageurs s’étaient respectueusement écartés pour lui faire de la place, et l’observaient.
Le Russe commençait à se réveiller. Sa tête bougea. Il écarta quelque chose de sa figure d’un mouvement de la main et ouvrit brusquement les yeux. Voyant qu’on l’observait, il se redressa lentement, prudemment. Quelqu’un se mit à applaudir et tout le monde l’imita dans la voiture, puis sur le quai, où la foule s’agglutinait à la fenêtre pour voir. Le Russe regarda autour de lui, la lueur affolée se muant dans ses yeux en une expression de stupéfaction. Un homme lui adressa un signe de tête pour l’encourager. Il souriait et applaudissait. Le Russe lui rendit lentement son signe de tête, comme s’il commençait peu à peu à comprendre quelque rituel étranger, et il se mit lui aussi à applaudir, doucement, ce qui ne fit qu’accroître le volume des acclamations. Il hocha modestement la tête, et Kelso se dit qu’il avait dû passer trente ans à rêver à ce moment. Son expression semblait dire : Vraiment, camarade, je suis comme vous — un homme simple, fruste même — mais si le fait de me vénérer peut vous faire plaisir…
Il n’avait pas conscience du regard de Kelso sur lui ; l’historien n’était qu’un visage parmi les autres dans la foule. Au bout de quelques secondes, ce dernier fit demi-tour et dut se frayer un passage dans la bousculade pour repartir en sens inverse.
Son esprit était dans la plus totale confusion.
Le Russe avait dû monter dans le train à Arkhangelsk, une minute ou deux après eux… c’était concevable s’il les avait imités en hélant une voiture. Jusque-là, il pouvait comprendre.
Mais ça ?
Il se cogna contre une femme qui remontait avec peine le couloir, se débattant avec deux grands sacs, un drapeau rouge et un vieil appareil photo.
Il lui demanda : « Qu’est-ce qui se passe ?
— Vous n’avez pas entendu ? Le fils de Staline est parmi nous ! C’est un miracle ! » Elle ne pouvait s’arrêter de sourire. Elle avait des dents en métal.
« Mais comment le savez-vous ?
— C’était à la télévision, répondit-elle, comme si cela expliquait tout. Toute la nuit ! Et quand je me suis réveillée, il y avait toujours les images et on disait qu’on l’avait vu dans le train de Moscou ! »
Quelqu’un la poussa par-derrière et elle se cogna dans Kelso. Elle se retrouva tout près de son visage. Il essaya de se dégager, mais elle s’accrocha soudain à lui, le regardant droit dans les yeux.
« Mais vous, s’exclama-t-elle, vous savez déjà tout ça ! Vous étiez à la télé et vous disiez que c’était vrai ! » Elle l’entoura de ses gros bras. Ses sacs lui rentraient dans le dos. « Merci. Merci. C’est un miracle ! »
Il aperçut une lumière blanche, très vive, qui se déplaçait sur le quai, derrière la tête de la femme, et il se dépêcha de passer. Un projecteur de télévision. Des caméras de télévision. De gros micros gris. Des techniciens qui marchaient à reculons, se bousculant les uns les autres. Et, au milieu de cette mêlée, marchant vers sa destinée, parlant avec assurance parmi toute une phalange de gardes du corps en veste noire, il y avait Vladimir Mamantov.
Читать дальше