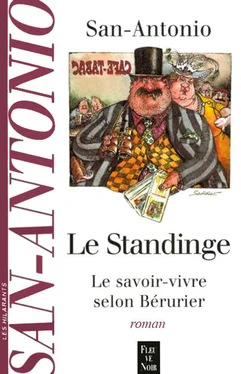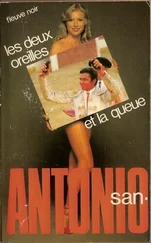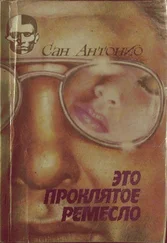Sur ma lancée, je demande les fiches des deux « suicidés ». Et c’est à cet instant, mes ravissantes, que je commence à voir poindre une légère lueur dans ce pot de goudron. Castellini, Corse d’origine, fut également inspecteur à Bordeaux. Et Bardane, quant à lui, était flic à Libourne, c’est-à-dire (pour qui connaît un peu la géographie) à quelques kilomètres de Bordeaux. Conclusion, la ville de Montaigne (Michel Eyquem de) et d’Escarpit (Robert) constitue le dénominateur commun de ces trois messieurs. Voilà un point d’acquis.
Je m’installe dans un bureau libre et je commence à virguler des coups de grelot dans tous les azimuts. Je sonne Bordeaux afin de me faire adresser un vrai catalogue des activités passées de Cantot et des deux suicidés ; ensuite de quoi je demande Paname pour obtenir des renseignements à propos des Dolorosa. Un troisième coup de turlu aux collègues lyonnais m’apprend que les Panamiens n’ont pas reparu au Standing Hôtel. Comme l’ami Cantot n’a pas l’air non plus de rejoindre l’Ecole, je commence à penser très sérieusement que ces pieds nickelés ont eu vent de mon coup fourré de la villa. La poulaille d’entre Rhône et Saône vient de découvrir que le pavillon où l’on séquestrait Mathias a été loué deux jours plus tôt par les Dolorosa à une vieille dame fort convenable qui est marchande de cierges et d’images pieuses sur la colline de Fourvière. Pour l’instant, nous en sommes là.
Je me paie un quatrième appel bigophonique à l’hôpital Edouard-Herriot. L’interne de service m’annonce que l’opération de Mathias a parfaitement réussi, mais que mon malheureux camarade, s’il s’en tire, ne sera pas en état de parler avant au moins quarante-huit plombes.
Quand je vous le disais qu’une longue attente commençait !
La soirée est plutôt tranquille. On visionne un spectacle d’une haute qualité morale à la téloche. Pas besoin de carré blanc. C’est une pièce qui raconte l’histoire d’une dame qui aime son mari. Mais elle est bien malheureuse, la pauvre chérie, car elle s’imagine que le gueux la double avec sa secrétaire. Il rentre tard le soir et il est pris en flagrant délit de mensonge. La brave personne découvre l’amertume du cocufiage avec horreur et désespoir et elle décide de déguster un godet de strychnine pour apprendre à son galopin d’époux à devenir veuf ! Mais juste au moment où elle va siffler sa coupe frelatée, voilà le volage qui radine, la bouche en cœur, avec un œillet à la boutonnière et une rose au slip (rouge la rose, car il s’agit d’un slip Eminence). Il a un gros paquet ficelé-ruban sous le bras. Explication : c’est un bon mari qui préparait un cadeau pour l’anniversaire de sa bobonne. Il lui avait commandé une cuisinière à transistors, made in Japan, qu’il a reçue en pièces détachées because les frais de douane. Le soir, aidé de sa vaillante secrétaire, une fille très bien, fiancée de surcroît à un lieutenant de sapeurs-pompiers, il remontait la cuisinière à transistors (avec bouilloir héliographique, moule à gaufre incorporé, autoclave à valve baveuse, gril figuratif à injection infrarouge et four électronique à semelle compensée). Un drôle de mécano, non ? Y a fallu de la patience pour arriver à reconstituer un appareil semblable juste à l’aide d’une notice écrite en japonais et avec, pour seuls outils, un tournevis et un chausse-pied d’unijambiste.
Faut drôlement aimer sa femme, admettez ! Elle en est bouleversée, à juste raison, madame la délaissée. Elle revient en courant de son erreur. Elle est émue aux larmes ! Transportée jusqu’à dix mille mètres de hauteur ! Elle se baguenaude en plein ciel rose, tout à coup ! Comment qu’elle va vider sa tisane funeste sur l’évier avant de remercier son guerrier bricoleur ! Ça se termine au moment où, pour pas choquer « nos jeunes téléspectateurs », elle lui promet une tarte aux myrtilles pour le dessert. Mais quand on sait écouter entre les fadaises, on devine ce que ça sera, en réalité, la tarte aux myrtilles ! La grande prouesse plumardière, oui, c’est couru ! La séance d’anniversaire, avec mimi vorace, exclamations sous-cutanées et dégradation de matériel de literie au son d’une marche américaine.
Les camarades disent que c’est un spectacle de qualité et qu’on le voit nettement s’accentuer, le redressement. Une émission de cette trempe, ça regonfle un peuple. Il prend conscience de lui-même et de ses possibilités, voyez-vous ! Tout de suite derrière, on nous offre un documentaire sur l’Inde, comme quoi la misère, là-bas, n’affecte que les pauvres. Heureusement, pour relever le standinge de ce peuple, on y trouve encore des vrais maharadjas bien fabuleux, avec palais de marbre aux cours pavées de rubis et de topazes retaillés par Marcel Pagnol. Bref, c’est la féerie indoue dans toute sa splendeur. Dans le court métrage, ils causent pas des bidonvilles pour pas choquer. Ils préfèrent rester dans les joyaux, l’albâtre, le satin et les éléphants blancs caparaçonnés d’or (c’est le peuple qui est cornac, bien entendu). Ils disent pas non plus que toute l’Inde féerique pue la merde ! Car, d’après leur religion, à ces braves sous-alimentés, ils doivent déféquer en plein air au lever et au coucher du soleil. Quand on arrive à Bombay un matin, de l’aéroport jusqu’à la ville, sur près de quarante kilomètres, on voit l’Inde accroupie. Tout un peuple déculotté, ça impressionne. Les senteurs de l’Inde mystérieuse, c’est ça. Mais allez donc le montrer ou le dire dans un documentaire ! Allez filmer toutes ces maigreurs occupées à s’extirper des résidus au bord des routes et se torchant avec de la terre ! C’est pour le coup que la ligue du culte viendrait au renaud, les bien-pensants calfeutrés dans leur rancœur, les ennuyés, les ennuyeux, les préoccupés de-ce-qui-ne-se-fait-pas, les sentencieux, toute la horde confite, bénite et bilieuse des faux culs à faux cols. Qu’ils essaient de nous la faire voir, l’Inde chiante qui se torchonne l’orifice à la glaise cholérique, qui avale des bandes Velpeau pour se nettoyer la boyasse et qui choisit les vautours comme tombeaux ; voui, qu’ils essaient, les gars de 7 Jours du Monde et vous verriez, le Pierrot Lazareff, les bafouilles bouillonnantes qu’on lui déverserait sur le burlingue. Dans l’ombre et la tourbe, dans les rues et les alcôves, dans les bureaux et les confessionnaux ils sont là, les corbeaux déguisés en quidams qui remplissent leurs stylos d’acide chlorhydrique pour l’invectiver, Lazareff, lui dire ce qu’ils pensent d’un vrai journaliste, le biffer, le raturer, le censurer, le menacer, l’éclabousser ; messieurs les cloportes, mesdames les cancrelates, tous les dévergondés de la ceinture de chasteté avec leur trousse à pétitions. Ils vigilantent, les frères de la cote morale ! Ils font le guet, ils font des rondes, ils prennent le quart pour rien laisser passer.
Je fais une nouvelle rafale de téléphones. R.A.S. ! Mathias : état stationnaire. Au Standing Hôtel, les Dolorosa ne sont toujours pas rentrés. Je vais alors au plumard. Mais au lieu de coucher dans mon box, je décide de me zoner dans celui d’Abel Cantot. De cette façon, s’il se pointe, je suis certain de ne pas le rater ! Y a encore des élèves dehors, les attardés du coup de reins. La plus grosse partie des effectifs a rejoint sa base. Les vadrouilleurs ont les châsses soulignés trois fois, les guibolles en coton et le slip aux abonnés absents. J’ai idée que ces dames ont été servies.
Avant de m’étendre sur le pageot du déserteur, je fouille son placard. Je déniche quelque chose d’intéressant : un matériel de plombier dans un carton à chaussures. Je pense que même les plus bêtes d’entre vous (s’ils existent) en ont déjà conclu que c’est Cantot notre assaillant de l’autre nuit. C’est lui qui faisait de la plomberie clandestine à’ l’infirmerie. Décidément, j’ai de plus en plus envie de le retrouver, le gars Abel. Je vous promets d’être son Caïn, mes filles.
Читать дальше