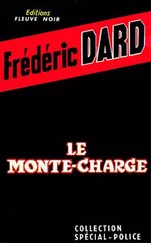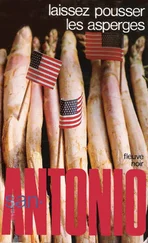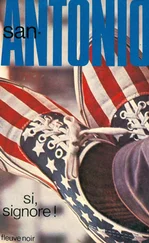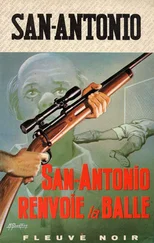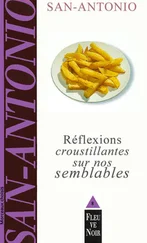San-Antonio
Laissez tomber la fille
S’il existait un bovidé capable de me dire ce que je suis venu maquiller à Paris cet après-midi, je vous jure que je lui offrirais volontiers le premier étage des Galeries Lafayette.
Parce que rappelez-vous que pour venir balader son renifleur dans les rues de Pantruche en ce moment, il faut avoir une belle épaisseur d’idiotie sur la tomate. Laissez-moi vous le dire tout de suite, en long, en large et en technicolor : nous sommes en pleine occupation et la capitale est le dernier endroit de cette saloperie de planète où je puisse porter mes grands pieds. Surtout n’allez pas croire que j’ai une activité quelconque dans un sens ou dans un autre… San-Antonio est un mec réglo. Mon job a toujours été de bosser pour le gouvernement français. Je n’ai jamais travaillé à mon compte, ni pour le compte d’une boîte autre que celle dont la devise est : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Quand je me suis aperçu que la pauvre Marianne l’avait dans le baigneur, j’ai demandé à mes chefs de me mettre en disponibilité et je me suis retiré dans ma crèche de Neuilly. Si bien que je passe mon temps à lire des bouquins policiers et à pêcher le goujon ; tandis que ma brave Félicie (laquelle est ma vioque, comme vous le savez) s’ingénie à faire la bouffe. Seulement, les romans policiers sont tous plus tartouzes les uns que les autres et les goujons ont dû avoir la trouille des chleux car on n’en voit pas la queue d’un depuis quelques mois.
En somme, la vie n’est pas plus marrante pour les rentiers, en ce moment, que pour les rempailleurs de chaises. C’est p’t-être à cause de la mélancolie qui m’envahit que je suis venu en ville. Ce matin, en m’apercevant dans la glace de ma salle de bains, j’ai fait un petit salut au type qui me regardait et qui ressemblait au cousin du négus. Il m’a fallu au moins dix minutes pour comprendre que le cousin du négus c’était moi. J’avais une de ces tronches !.. D’habitude, je suis assez beau gosse, et la preuve c’est que les fillettes préfèrent ma photo à celle de Winston Churchill. Mais ce matin, ma trompette ressemblait à celle d’un fakir auquel un plaisantin aurait remplacé les clous en caoutchouc de sa planche par de vraies pointes provenant de la quincaillerie du coin. J’avais des yeux de lion malade, et ma barbe poussait bleue. Quand ma barbe pousse bleue, c’est que j’ai des ennuis avec mon carburateur ; soit parce que je suis amoureux, soit parce que mon foie revendique son indépendance.
Alors j’ai rasé le cousin du négus et j’ai décidé de l’emmener promener.
Les rues sont tristes comme un roman de Pierre Loti. Tous ces écriteaux rédigés en gothique me flanquent le noir. Paris, en ce mois d’octobre 42 est plus vert qu’un sapin. Mais ici, les sapins portent des bottes qu’ils font sonner sur les pavés… Je rêve d’un bled où les gnaces marchent pieds nus. C’est ça qui doit être reposant ! La nostalgie creuse un trou dans mon estomac. Or, les trous, excepté ceux du gruyère, sont faits pour être comblés. Je me dis que le mien se cicatriserait très bien avec du cognac. Justement, je connais un coin pépère où l’on vous sert des trucs qui font rêver, dans des grands verres. Seulement, ce coin-là se trouve vers la République. Je vais prendre le métro. À ces heures, il n’y a presque personne dans les couloirs. J’arpente ceux de la station Arts et Métiers aux côtés d’un type qui n’a pas l’air plus pressé que moi. Au moment où nous parvenons sur le quai, une rame arrive. Nous grimpons, le type et moi, dans le même wagon. Nous sommes seuls, à croire que nous sommes les deux uniques usagers du métropolitain aujourd’hui.
La rame s’ébranle. Elle parcourt environ deux cents mètres et s’arrête pile.
— Allons, bon ! ronchonne mon compagnon de route, voilà une alerte.
Je me mets à fulminer. C’est bien ma veine, je prends le métro afin d’aller me jeter un remède dans mon usine à distiller les plats garnis, et en fait de cognac, je vais rester une heure ou deux dans ce terrier, en tête à tête avec un mec que je ne connais pas.
Je regarde le type : c’est un grand fifre habillé de sombre. On dirait un professeur de philosophie. Il a les cheveux en brosse (ce qui le grandit encore), des yeux de canard en forme de boutons de bottines et des mains allongées. Son visage respire l’intelligence.
— Je ne sais pas si on peut fumer pendant les alertes ? questionna-t-il.
Je lui réponds que je me fous du règlement comme de mon premier bavoir et, pour le lui prouver, je sors une cigarette de ma poche. Il en fait autant. Nous voilà donc avec l’un et l’autre une Gauloise dans le bec. Nous fouillons nos profondes pour y chercher du feu. C’est bibi qui trouve le premier son briquet. Je l’allume et tends la flamme à mon voisin. Il avance sa tête et aspire. À ce moment-là, nos regards rapprochés se croisent. J’éprouve une curieuse sensation. Mais je ne puis en analyser la nature. Il me semble… Oui, il me semble que les yeux du grand type annoncent quelque chose. Je connais déjà, non pas ces yeux, mais l’espèce d’avertissement qu’ils contiennent.
La cigarette du type grésille.
— Merci, me dit-il.
Il se redresse. Et soudain, je comprends ce qu’il y avait dans son regard. Seulement c’est trop tard. Ce fumier est en train de me tirer des coups de revolver à travers sa poche. Je prends sa marchandise dans la brioche. J’ai l’impression que le tonnerre du ciel éclate dans mon bide. J’en ai le souffle coupé. Un brouillard rouge se forme devant mon regard. La dernière image que j’ai, c’est celle de la poche du gars, déchiquetée par les balles.
Je soupire :
— Ben mon salaud, tu vas avoir une drôle de note de stoppage à régler.
Le brouillard s’épaissit. Mes tripes s’enflamment. Je me mets à geindre et cette fois je sens que je m’évacue dans le bled où les gonzes se baguenaudent avec des petites ailes dans le dos.
Un jour, j’ai traversé le Mont-Cenis. Pour un tunnel, c’est un tunnel. Si vous avez une belle pépée à vos côtés pour faire le voyage, vous pouvez en toute tranquillité lui expliquer ce qu’Adam a raconté à Ève le jour où ils ont joué à papa-maman. Mais si vous voyagez seul, pardon : il ne vous reste plus qu’à fermer vos mirettes et à pioncer. Tout le noir qu’il y avait de disponible dans ce coin des Alpes, on l’a collé dans ce sacré tunnel. Ça dure. Du noir ! et encore du noir !
Et puis, voilà que peu à peu le jour commence à poindre.
J’ouvre les yeux.
— On vient de sortir du tunnel, dis-je.
Je bats des paupières. Le soleil me rentre de partout dans le corps. Je sens sur mes joues quelque chose de tiède ; c’est doux et caressant. Je mets un sacré bout de temps à comprendre que cet air chaud c’est le souffle de Félicie. Aussitôt, mes pensées se mettent en rang comme des petites filles dociles.
— Alors, je vais m’en tirer ?
— Oui, mon grand, murmure Félicie.
Je peux vous dire que je pousse un soupir tellement copieux qu’il gonflerait un dirigeable. Mais voilà qu’une douleur terrible s’installe dans mes tripes. J’esquisse une grimace. Aussitôt, une môme en blanc, tout ce qu’il y a de giron, s’avance en tenant une seringue. Elle rejette mes draps et me plante son engin dans le prose. L’effet ne se fait pas attendre : ma douleur disparaît et je me sens tout ce qu’il y a de gaillard.
— Écoute, M’man, dis-je à Félicie. Tu dois croire que je me suis laissé entraîner dans une histoire quelconque de politique… Eh bien, ma parole, il n’en est rien, et je ne sais pas pourquoi ce bonhomme a craché sa ferraille dans mon garde-manger.
Читать дальше