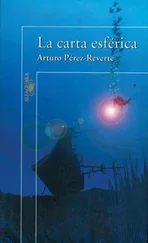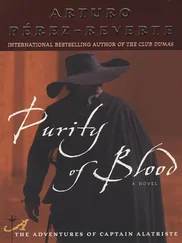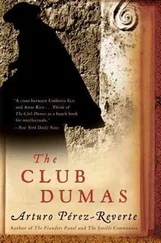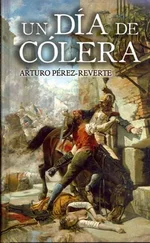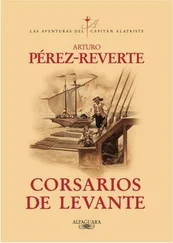Pérez-Reverte,Arturo - Un jour de colère
Здесь есть возможность читать онлайн «Pérez-Reverte,Arturo - Un jour de colère» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, fra. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Un jour de colère
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Un jour de colère: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Un jour de colère»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Un jour de colère — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Un jour de colère», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Las de la discussion, Navarro Falcón retourne à sa table.
— Je ne veux pas entendre un mot de plus !… Est-ce clair ?
Le colonel s’assied et fait mine de se plonger dans ses papiers. Feignant de croire que Velarde ne l’entend pas, il murmure, l’air égaré : « Se battre… Se battre… Mourir pour l’Espagne », et, tout en griffonnant à son tour des dessins sans signification, il forme des vœux pour que là-bas, à Monteleón, Daoiz garde la tête froide, et que lui-même, ici, soit capable de conserver Velarde rivé à sa table. Laisser aujourd’hui cet exalté s’approcher du parc de Monteleón, ce serait comme attacher un cordon allumé à un tonneau de poudre.
Malgré ses excès et son patriotisme passionné, le serrurier Molina n’est pas idiot. Il sait que s’il conduit sa troupe vers le parc par des rues trop larges, il attirera l’attention et que, tôt ou tard, les Français lui barreront le passage. Il recommande donc le silence à la vingtaine de volontaires qui le suivent – dont de nouveaux venus viennent grossir les rangs en cours de route – et, après s’être séparé de ceux qui cherchent le chemin le plus court, il les dirige vers le cours San Pablo en passant par le guichet de San Martín et les rues Hita et Tudescos.
— Sans tapage, hein ?… Ça, ce sera pour plus tard. L’important, c’est de nous procurer des fusils.
À la même heure, d’autres groupes, ceux qui ont été alertés par Molina ou des gens qui marchent sur Monteleón de leur propre initiative, montent par Los Caños et la place Santo Domingo vers la large rue San Bernardo, et de la Puerta del Sol par le carreau de San Luis vers la rue Fuencarral. Certains parviendront au but dans l’heure qui vient ; mais d’autres, confirmant les craintes de Molina, seront anéantis ou dispersés en se heurtant à des détachements français. Tel est le cas de la troupe formée par le chocolatier José Lueco qui, avec les garçons d’écurie Juan Velázquez, Silvestre Álvarez et Toribio Rodríguez, décide de marcher pour son compte en coupant par San Bernardo. Mais dans la rue de la Bola, alors qu’ils sont maintenant une trentaine grâce au renfort des valets d’une hôtellerie et d’une auberge voisines, d’un doreur, de deux apprentis charpentiers, d’un ouvrier typographe et de plusieurs domestiques de maisons particulières, la troupe, qui dispose de quelques carabines, escopettes et fusils de chasse, tombe sur un peloton de fusiliers de la Garde impériale. Le choc est brutal, à bout portant, et, après les premiers coups de navajas et de fusils, les Madrilènes se retranchent au coin de la place Santo Domingo et de la rue Puebla. Pendant un bon moment, n’écoutant que leur courage, ils livrent là un combat acharné qui cause des pertes aux Français, avec l’aide des gens du voisinage qui participent à la bataille en lançant des pots de fleurs et toutes sortes de projectiles depuis les balcons. Finalement, se voyant sur le point d’être encerclée par des renforts qui arrivent des rues adjacentes, leur troupe se disperse en laissant plusieurs morts sur le pavé. José Lueco, blessé d’un coup de sabre au visage et d’une balle à l’épaule, parvient à se réfugier dans une maison proche – à la troisième tentative, car les deux premières portes auxquelles il frappe ne s’ouvrent pas – où il restera caché jusqu’à la fin de la journée.
Comme celui du chocolatier Lueco, d’autres groupes sont presque tout de suite défaits, ou durent juste le temps que les troupes françaises mettent à les trouver et à les disperser. C’est ce qui arrive au petit groupe armé de gourdins et de couteaux que les Français obligent à se débander à coups de canon au coin des rues du Pozo et San Bernardo, blessant José Ugarte, chirurgien de la Maison royale, et María Oñate Fernández, âgée de quarante-trois ans et originaire de Santander. Même chose dans la rue Sacramento, pour une troupe conduite par le curé don Cayetano Miguel Manchón qui, armé d’une carabine et à la tête de quelques jeunes gens résolus, tente de gagner le parc d’artillerie. Une patrouille de cavaliers polonais fond sur eux à l’improviste, le prêtre est atteint d’un coup de sabre qui lui met la cervelle à l’air, et ses hommes, affolés, se dispersent en un instant.
Un autre groupe n’arrivera pas non plus à destination : c’est celui que mène don José Albarrán, médecin de la famille royale, qui, après avoir assisté au massacre de l’esplanade du Palais, recrute une bande d’habitants armés de gourdins, de couteaux et de quelques fusils de chasse, et tente de la faire passer par la rue San Bernardo. Arrêtés par la mitraille que crachent deux canons français mis en batterie devant l’hôtel du duc de Montemar, ils doivent se réfugier dans la rue San Benito ; là, ils se voient pris entre deux feux, car une autre force française qui vient de la place Santo Domingo tire sur eux depuis celle du Gato. Le premier à tomber, d’une balle dans le ventre, est le plâtrier Nicolás del Olmo García, âgé de cinquante-quatre ans. Le groupe se débande et le docteur Albarrán, grièvement blessé et laissé pour mort – il sera sauvé plus tard par ses amis et survivra –, est dépouillé par les soldats de l’armée impériale qui lui prennent sa redingote, sa montre et douze onces d’or qu’il portait sur lui. À son côté, après s’être battu avec pour seules armes une petite épée d’apparat et un pistolet de poche, meurt Fausto Zapata y Zapata, douze ans, cadet des Gardes espagnoles.
Dans une maison de la rue de l’Olivo, un garçon de quatre ans et demi, Ramón de Mesonero Romanos – qui sera par la suite l’un des écrivains les plus populaires et les plus typiques de Madrid –, est également la victime accidentelle des événements. En se précipitant au balcon avec sa famille pour voir une troupe de Madrilènes qui crient « Aux armes ! Aux armes ! Vive Ferdinand VII et mort aux Français ! », le petit Ramón trébuche et s’ouvre le crâne sur le fer forgé de la balustrade. Bien des années après, dans ses Mémoires d’un septuagénaire, il racontera cet épisode : sa mère, Doña Teresa, effrayée par l’état de son fils et par ce qui se passe dans la rue, allume des cierges devant une image de l’Enfant Jésus et récite son rosaire, pendant que le père – le négociant Tomás Mesonero – discute, inquiet, avec leurs voisins. À cet instant se présente chez eux un ami de la famille, le capitaine Fernando Butrón, qui vient de se défaire de son épée et de son uniforme afin, dit-il, d’éviter que les gens qui courent les rues ne l’obligent, comme ils l’ont déjà tenté à trois reprises, à se mettre à leur tête.
— Ils vont partout, surexcités et désorientés, en cherchant quelqu’un pour les diriger, explique Butrón, qui reste en gilet et manches de chemise. Mais tous les militaires ont ordre d’aller s’enfermer dans leurs casernes… Nous n’avons pas le choix.
— Et ils obéissent tous ? demande Doña Teresa Romanos qui, sans cesser de dire son rosaire, lui apporte un verre de clairet frais.
Butrón avale le vin d’un trait et essaye la jaquette anglaise que lui offre le maître de maison. Les manches sont un peu courtes, mais c’est mieux que rien.
— Moi, en tout cas, je compte obéir… Mais je ne sais pas ce qui se passera si cette folie continue.
— Jésus, Marie, Joseph !
Doña Teresa se tord les mains et entame le vingtième Ave María de la matinée. Écroulé sur un canapé à côté de l’image de l’Enfant Jésus, le petit Ramón Mesonero Romanos, un emplâtre imbibé de vinaigre sur le front, pleure à chaudes larmes. De temps à autre, au loin, retentissent des coups de feu.
À la Puerta del Sol, dix mille personnes sont rassemblées, et la foule se répand dans les artères voisines, de la rue Montera au carreau de San Luis, de même que dans les rues Arenal et Postas, et la Calle Mayor, tandis que des groupes armés d’escopettes, de gourdins et de couteaux patrouillent aux alentours pour donner l’alerte en cas de présence française. De la fenêtre de sa maison, au numéro 15 de la rue Valleverde, au coin de la rue Desengaño, Francisco Goya y Lucientes, Aragonais, âgé de soixante-deux ans, membre de l’Académie de San Fernando et peintre de la Maison royale avec cinquante mille réaux de rente, regarde tout avec une expression sévère. Deux fois, il a refusé de céder à son épouse, Josefa Bayeu, qui lui demandait de rabattre le volet et de se retirer à l’intérieur. En gilet, le col de la chemise ouvert et les bras croisés sur sa poitrine, sa tête puissante, encore ornée d’une épaisse chevelure frisée et de favoris gris, un peu penchée, le plus célèbre des peintres espagnols vivants s’obstine à rester là pour observer le spectacle de la rue. Des cris de la foule et des tirs isolés au loin, c’est à peine si des échos parviennent à ses oreilles – une maladie, il y a quelques années, l’a laissé sourd –, bruits amortis qui se confondent avec les rumeurs de son cerveau toujours tourmenté, tendu et aux aguets. Goya est à son balcon depuis que, voici un peu plus d’une heure, León Ortega y Villa, un jeune homme de dix-huit ans qui est son élève, est venu de chez lui, rue Cantarranas, pour demander la permission de ne pas se rendre à l’atelier. « Nous allons probablement devoir nous battre avec les Français », a-t-il dit au peintre en parlant comme d’habitude très fort tout contre son oreille invalide, avant de repartir avec le sourire juvénile et héroïque de ses jeunes années, sans prêter attention aux objurgations de Josefa Bayeu qui lui reprochait de prendre des risques sans tenir compte de l’inquiétude de sa famille.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Un jour de colère»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Un jour de colère» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Un jour de colère» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.