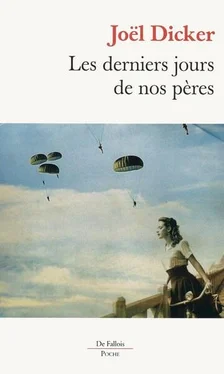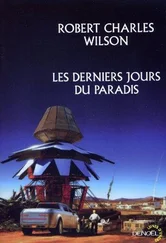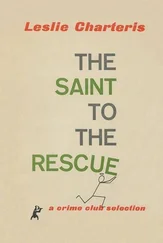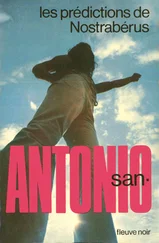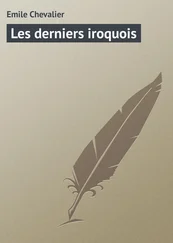Les Alliés avaient ouvert un front en Italie, ils progressaient rapidement ; lorsqu’ils arriveraient dans la région, tout soutien serait utile et l’une des principales tâches de Pal avait été de former les combattants au maniement des armes. Il avait expliqué certaines tactiques de combat et enseigné l’utilisation des explosifs simples, mais lui-même n’était pas tout à fait à l’aise dans cette matière. Il redoutait ses propres leçons, et jurait à chacune que ce serait la dernière. Mais il fallait être en mesure d’attaquer le plus possible, d’effrayer, d’isoler. Il aimait instruire, il aimait être le détenteur du savoir : il espérait que ses élèves posaient sur lui les mêmes regards qu’il avait posés sur les instructeurs des écoles du SOE.
Une fois par mois, lorsque la situation le lui permettait, il disparaissait quelques jours. Deux jours. Jamais plus. Si on lui posait des questions, même un autre agent du SOE, il prenait cet air à la fois mystérieux et agacé qu’il tenait du métier et qui mettait un terme à toute discussion sans paraître ni grossier, ni embarrassé. Chacun avait ses consignes. Le secret était le secret. Les gens, d’ailleurs, parlaient trop. Pas les agents britanniques, mais les résistants. Il avait averti les responsables de réseaux : leurs hommes se montraient trop bavards, souvent malgré eux. Une allusion à un ami proche, une confidence à un conjoint, et c’est tout le réseau qui pouvait être compromis. Il fallait que les cellules de résistance soient petites, que personne ne connaisse personne, au moins chez les exécutants. Il fallait évincer des rangs les bavards, les incapables et les mythomanes.
Il partait donc. De Marseille ou de Nice, il prenait le train jusqu’à Lyon. Depuis son renvoi en France, en février, il y était déjà allé six fois. Il retrouvait Marie. C’était risqué, contraire aux consignes de sécurité qu’il martelait pourtant à tout va, mais il devait le faire, car Marie, un peu amoureuse, continuait à lui servir de courrier jusqu’à Paris. Ainsi Pal égrenait-il sa pile de cartes postales de Genève, écrivant à son père. Il lui disait que tout allait bien.
Les rendez-vous avec Marie étaient fixés par téléphone. Une simple conversation, les mots n’avaient pas d’importance : s’il téléphonait, cela signifiait qu’il viendrait le lendemain. Ils avaient trois lieux de rencontre possibles, et dans la conversation, Pal, glissant l’une des phrases convenues, lui indiquait lequel. Et ils se retrouvaient, ils marchaient un peu ensemble, ils allaient déjeuner ; il jouait de son charme, de ses secrets, de son statut. Puis, dans une ruelle, il faisait mine de l’embrasser et glissait la précieuse enveloppe dans son sac. « Toujours au même endroit », lui murmurait-il. Elle acquiesçait, aimante, subjuguée, docile. Elle ne savait pas ce que contenaient ces enveloppes, mais au vu de la cadence, ce devait être de haute importance. Il devait se passer des événements de premier ordre, elle le savait. D’ailleurs, épluchant les journaux, constatant les bombardements, elle se demandait si Pal en était à l’origine. Peut-être même était-ce lui qui en avait donné l’ordre dans ses messages. Était-elle la cheville ouvrière qui déclenchait ces déluges de feu ? Elle en frissonnait d’excitation.
Il continuait ses mensonges. Il lui faisait croire à l’effort de guerre, glissant parfois une phrase inachevée pleine de sous-entendus. Elle frémissait, il le savait. Bien sûr, son propre comportement le répugnait, mais au moins, s’il lui faisait perdre son temps, il ne lui faisait courir aucun risque. Elle était une gentille Française, avec des papiers en règle, et les cartes postales ne contenaient qu’un texte anodin ; de surcroît, elles n’étaient même pas datées. Si on la contrôlait, si on la fouillait, elle n’aurait aucun problème. Lui dire la vérité alors ? Non, elle ne comprendrait pas. Il n’aimait pas l’utiliser, il n’aimait pas lui mentir, mais il devait continuer à entretenir le mystère pour être certain qu’elle ferait toujours le facteur.
Il comptait ses cartes. Huit. Il en avait reçu huit en tout. Huit cartes postales de Genève. Depuis février, il en avait reçu six. Une par mois, rythme impeccable. Les plus beaux mois de sa vie. Elles arrivaient toujours de la même façon : dans une enveloppe, sans timbre ni adresse, qu’une main anonyme déposait dans sa boîte aux lettres. Mais qui ? Paul-Émile ? Non, si Paul-Émile venait régulièrement à Paris, il serait venu le trouver directement. Son fils, certainement, ne quittait pas Genève, et il avait bien raison.
Le père était heureux comme il ne l’avait plus été depuis le départ de son garçon ; toutes ces cartes, c’était comme si son Paul-Émile était près de lui. Il mangeait davantage désormais, il avait meilleure mine, il avait repris un peu de poids. Souvent, il chantait dans l’appartement. Dehors, il sifflotait.
Les cartes étaient magnifiques. Bien choisies. Genève était telle qu’il se l’était toujours imaginée : une belle ville. Quant au texte, il était succinct et plus ou moins identique à chaque fois. Jamais signé, mais il reconnaissait l’écriture.
Cher Papa,
Tout va bien.
À très vite.
Je t’embrasse.
Tous les soirs, après le dîner, il les relisait, toutes, dans l’ordre chronologique. Puis il les empilait, en les tapotant pour qu’elles soient bien alignées, et il les remettait dans leur cachette. Sous la couverture d’un grand livre couché au-dessus de la cheminée. Sur la couverture cartonnée, il posait le cadre doré dans lequel rayonnait la plus récente photo de son fils. Il posait le cadre bien au milieu du livre, pour appuyer dessus, à la manière d’une presse, afin que les cartes jamais ne se déforment. Fermant les yeux, il imaginait Paul-Émile, banquier émérite, déambulant en costume de prix dans les couloirs de marbre d’une très grande banque. Il était le plus beau des banquiers, le plus fier des hommes.
Dans la chaleur niçoise de la mi-août, Pal avait rejoint Rear à son hôtel : il revenait de Lyon, où il avait retrouvé Marie pour lui remettre une nouvelle enveloppe. Dans la petite chambre qui rappelait furieusement Berne, Pal contemplait, amusé, Rear, moite de sueur, qui jouait avec un appareil photo miniature, nouvelle production des stations expérimentales du SOE. Pal sourit ; rien n’avait changé.
Les deux hommes s’étaient retrouvés par hasard au cours d’une opération associant deux réseaux, et ils s’étaient donné rendez-vous à Nice pour le plaisir de se revoir.
— J’ai entendu parler de toi, dit Rear sans lâcher son occupation. Les réseaux sont impressionnés par ton travail.
— Bah. On fait ce qu’on peut.
— J’ai aussi rencontré un de tes colocataires… un grand roux.
Le visage de Pal s’illumina.
— Key ? Ah, ce bon Key ! Comment va-t-il ?
— Bien. Un bon agent lui aussi. Sacrément efficace !
Pal acquiesça, content de ces bonnes nouvelles. Le plus dur, c’était de ne rien savoir sur personne, et parfois il songeait que Stanislas avait eu raison. Ils n’auraient pas dû se lier. Il essayait de pas trop y penser. Penser, c’était mauvais.
— Des nouvelles d’Adolf ? demanda-t-il.
— Doff ? Il va pas mal. Il est en Autriche maintenant, je crois.
— Il est schleu ?
— Plus ou moins.
Ils pouffèrent. Heil Hitler, mein Lieber ! murmura joyeusement le fils, brandissant le bras en de discrets saluts nazis pendant que Rear était occupé à remettre en place l’objectif minuscule qu’il avait réussi à dévisser dans un geste maladroit. Mais il n’y parvint pas : il l’avait cassé. Pour se consoler, il s’empara d’une petite bouteille de liqueur qu’il avait mise au frais dans le lavabo. Il attrapa un verre à dents, le remplit au tiers et le tendit à Pal, avant de boire directement au goulot.
Читать дальше