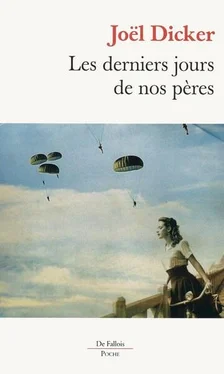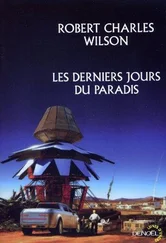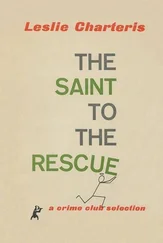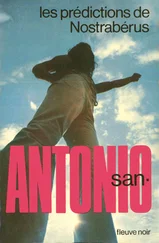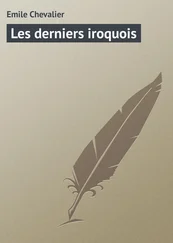Kunszer avait la confiance de Canaris. Quelques années auparavant, Canaris avait fait de l’Amérique l’une de ses priorités ; il y avait installé un important réseau d’agents et l’avait envoyé à Washington. C’était en 1937, et cette année-là, il n’y eut pas un télégramme qui fut émis depuis une ambassade sans qu’il ne fût au courant de son contenu. Il était rentré en Allemagne en 1939, pour la guerre, tandis que le Réseau américain avait mal tourné : démantelé en 1940 par le FBI, partiellement remonté avec des agents issus de la Gestapo, des ignares peu entraînés et incapables, il avait été anéanti à nouveau par les agents fédéraux américains. Et pour de bon cette fois. La Gestapo, décidément, ne servait à rien.
Dès l’occupation de Paris, il y avait reçu des responsabilités. Il était assigné au Gruppe III de l’Abwehr-Paris, la section chargée du contre-espionnage ; le Gruppe I était chargé du renseignement, et le Gruppe II des sabotages en pays ennemi et de la guerre psychologique. L’installation au Lutetia s’était faite en juin 1940. Durant les deux années qui avaient suivi, ils avaient maté la Résistance. Il en allait autrement à présent.
Wilhelm Canaris avait fêté ses cinquante-six ans le premier jour de janvier ; Kunszer lui avait écrit un petit mot pour l’occasion. Il aimait bien Canaris, le « vieux » comme on l’appelait dans le Service, car il devait bien y avoir dix ans qu’il avait les cheveux tout blancs.
Comment frapper le SOE ? Il n’en savait plus rien. Il était découragé. Parfois, il se demandait s’ils gagneraient la guerre. Il ferma la porte de son bureau et posa un disque sur son gramophone. La musique l’apaisait.
Dans la campagne, Faron courait. Il était heureux. Il courait sur la petite route à toutes jambes ; il irait jusqu’à la cabane, en bordure des bois. Il y avait laissé une paire de jumelles. Le jour touchait à sa fin, mais il faisait encore clair. Il aimait ces fins de journées d’été, il aimait ces premières heures du soir encore irradiées de soleil et de chaleur. Il aimait sa vie.
Il courait dans les hautes herbes à présent, caché de la route par de lourds arbres fruitiers ; il portait son habituel costume et, cachée dans son veston, une Sten à crosse rétractable. Il riait.
Il atteignit l’orée du bois qui dominait la grande route et les champs, et il ralentit la cadence pour ne pas déchirer son complet dans les branches basses. Il ne lui fallut ensuite qu’une minute pour rejoindre la cabane, derrière une rangée de hauts chênes, une vieille cabane de chasse en bois vermoulu. D’un coup d’œil par le carreau cassé, il s’assura qu’elle était vide et il entra. Les jumelles étaient sous une latte. Il les porta à ses yeux et par la fenêtre sans vitre, à travers les branchages épais qui le dissimulaient des hommes, il suivit le trait gris de la route, au loin, et il arrêta son regard sur la colonne de fumée qui s’élevait de l’amas de voitures, satisfait.
Sur la butte, tapis dans les herbes, au-dessus de la petite route, ils avaient attendu, fébriles. C’était une longue ligne droite ; avertis depuis presque une minute par la corne de brume d’un éclaireur posté en amont, ils avaient vu le convoi venir de loin. Malgré la tension qui lui nouait les entrailles, Faron avait souri : son information s’était révélée exacte, le gradé et son convoi avaient bien emprunté cette route pour quitter la région. Il avait déclenché l’attaque en lançant sa grenade.
Ils étaient sept, et sept grenades avaient été jetées presque simultanément sur les deux voitures : la voiture du gradé, et son escorte. Escorte minable, elle n’avait rien vu venir. Faron et ses six hommes s’étaient mis à couvert le temps de la déflagration, puis ils avaient ouvert le feu sur les deux voitures ; la première était couchée sur l’aile, la seconde était intacte mais immobilisée. Ils avaient mitraillé sans discontinuer, et les voitures, qui n’étaient pas blindées, avaient été transpercées par la mitraille. Le déluge de Sten avait duré au moins trente secondes. Une éternité.
Derrière les arbres, Faron jubilait. Ah, ç’avait été une belle embuscade ; il était fier de sa petite troupe, les six meilleurs hommes du réseau qu’il entraînait. Il y a quelques mois encore, ils ne savaient rien faire, et aujourd’hui, ils s’étaient battus comme des lions. Il était fier d’eux, fier de lui. Ils avaient tout fait comme il leur avait appris : les positions, la détermination, la communication. Au son de la corne de brume, ils avaient armé les Sten, dégoupillé les grenades, serrant fort la cuillère. Puis, lorsqu’il avait jeté la sienne, tous l’avaient imité. Explosion formidable. Et ils avaient ouvert le feu, ne laissant aucune chance aux assaillis. Lui, tireur d’élite, était en charge d’abattre les chauffeurs, pour qu’ils ne puissent pas fuir ; une rafale avait suffi, la première voiture ayant été presque retournée par le souffle des grenades ; simultanément, quatre tireurs avaient mitraillé les carrosseries, sans répit, visant les hommes mais tirant partout, comme il l’avait ordonné. Difficile d’être précis avec les Sten, il ne fallait pas lésiner sur les munitions. Pour Faron, le clou du spectacle avait été son tireur d’appoint, qui avait rempli son rôle à merveille. Le tireur d’appoint était l’une de ses inventions de guerre : son rôle était de rester prêt au tir mais de ne rien faire, attentif à ses camarades : si l’une des Sten s’enrayait, ou lorsqu’un camarade changeait ses chargeurs, le tireur d’appoint prenait immédiatement le relais, et ainsi le feu ne cessait jamais. L’ennemi ne disposait d’aucun répit pour contre-attaquer. Et lorsque la Sten arrêtée pouvait reprendre sa tâche, le tireur d’appoint rapprêtait aussitôt son arme au tir. Faron était enchanté du rendement ; c’était une technique améliorée, une méthode de son cru et, un jour, il l’enseignerait à Lochailort. Il s’y voyait bien instructeur. Il était un grand soldat.
Ils ne s’étaient vu opposer aucune résistance. Les Allemands avaient tous péri, assis sur leur banquette en cuir. Et s’il en était un qui respirait encore, il ne tarderait pas à se vider de son sang. Faron avait hésité à redescendre la butte pour achever un éventuel survivant ; il avait vite renoncé. Cela n’en valait pas la peine. S’approcher des voitures, ç’aurait été risquer de se prendre une balle si l’un des occupants, animé par la force du désespoir, était parvenu à dégainer son Luger. En fait, Faron avait espéré qu’au moins une de ses victimes survivrait à l’attaque. Car ce n’était pas le nombre de morts qui était important, et, dans ce cas précis, il était même insignifiant : quelques militaires, fussent-ils haut gradés, ce n’était rien sur une armée d’un million d’hommes. Tuer n’était d’ailleurs pas le but de ces opérations ; il fallait créer un contexte de terreur générale, non pas pour la poignée de malheureux dans le convoi, mais pour tous les soldats allemands sur sol français. Alors, s’il y avait un survivant, c’était même mieux. Il raconterait la surprise, l’horreur, la panique, l’impuissance, les cris, la détermination des assaillants, les camarades morts et qui, une minute plus tôt, plaisantaient gaiement, là, juste sur le siège à côté. Et en entendant les propos du rescapé, prononcés sur un lit d’hôpital qui serait son seul horizon pour les prochains mois, et davantage peut-être, tous seraient frappés du message de Faron : la mort, la souffrance, les blessures atroces, voici ce qui les attendait, eux qui avaient osé violer la France. Et ils n’y seraient nulle part en sécurité.
Читать дальше