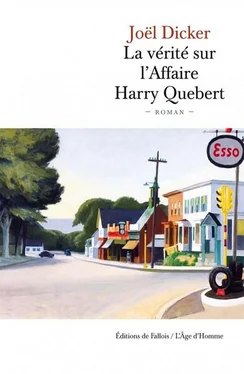*
Une demi-heure après ma découverte, je débarquai de toute urgence dans le bureau de Gahalowood, au quartier général de la police d’État. Il était évidemment furieux que je sois allé voir Stern sans le consulter au préalable.
— Vous êtes intenable, l’écrivain ! Intenable !
— Je n’ai fait que lui rendre visite, expliquai-je. J’ai sonné, j’ai demandé à le voir et il m’a reçu. Je ne vois pas le mal.
— Je vous avais dit d’attendre !
— Mais attendre quoi, sergent ? Votre sainte bénédiction ? Que des preuves tombent du ciel ? Vous avez gémi que vous ne vouliez pas vous frotter à lui, alors j’ai agi. Vous gémissez, moi j’agis ! Et regardez ce que j’ai trouvé chez lui !
Je lui montrai les photos sur mon téléphone.
— Un tableau ? me dit Gahalowood d’un air dédaigneux.
— Regardez bien.
— Nom de Dieu… On dirait…
— Nola ! Il y a un tableau de Nola Kellergan chez Elijah Stern.
J’envoyai par e-mail les photos à Gahalowood qui les imprima en grand format.
— C’est bien elle, c’est Nola, constata-t-il en comparant avec des photos d’époque qu’il avait dans son dossier.
La qualité de l’image n’était pas bonne mais il n’y avait pas de doute possible.
— Donc, il y a bien un lien entre Stern et Nola, dis-je. Nancy Hattaway affirme que Nola entretenait une relation avec Stern et voilà que je trouve un portrait de Nola dans son atelier. Et je ne vous ai pas tout dit : la maison de Harry appartenait à Elijah Stern jusqu’en 1976. Techniquement, lorsque Nola disparaît, c’est Stern qui est le propriétaire de Goose Cove. Merveilleuses coïncidences, non ? Bref, demandez un mandat et appelez la cavalerie : on va faire une perquisition en règle chez Stern et on le boucle.
— Un mandat de perquisition ? Mais mon pauvre ami, vous êtes complètement fou ! Et sur la base de quoi ? De vos photos ? Elles sont illégales ! Ces preuves n’ont aucune validité : vous avez fouillé une maison sans autorisation. Je suis coincé. Il faut autre chose pour nous attaquer à Stern, et d’ici là, il se sera certainement débarrassé du tableau.
— Sauf qu’il ne sait pas que j’ai vu le tableau. Je lui ai parlé de Luther Caleb, et il s’est énervé. Quant à Nola, il a prétendu la connaître très vaguement alors qu’il possède un tableau d’elle à moitié nue. Je ne sais pas qui a peint ce tableau, mais il y en a d’autres dans l’atelier signés LC. Luther Caleb peut-être ?
— Cette histoire prend une tournure que je n’aime pas, l’écrivain. Si je m’en prends à Stern et que je me plante, je suis très mal barré.
— Je sais, sergent.
— Allez parler de Stern à Harry. Essayez d’en savoir plus. Moi je vais creuser la vie de ce Luther Caleb. On a besoin d’éléments solides.
Dans la voiture, entre le quartier général de la police et la prison, j’appris par la radio que l’ensemble des livres de Harry était désormais retiré des programmes scolaires de la quasi-totalité des États du pays. C’était le fond du fond : en moins de deux semaines, Harry avait tout perdu. Il était désormais un auteur interdit, un professeur répudié, un être haï par toute une nation. Quelle que soit l’issue de l’enquête et du procès, son nom était à jamais sali ; on ne pourrait désormais plus parler de son œuvre sans mentionner l’immense controverse de cet été passé avec Nola, et pour éviter les esclandres, les célébrations culturelles ne se hasarderaient certainement plus à associer Harry Quebert à leur programme. C’était la chaise électrique intellectuelle. Le pire était que Harry avait pleinement conscience de cette situation ; en arrivant dans la salle de visite, sa première parole à mon intention fut :
— Et s’ils me tuent ?
— Personne ne vous tuera, Harry.
— Mais ne suis-je pas déjà mort ?
— Non. Vous n’êtes pas mort ! Vous êtes le grand Harry Quebert ! L’importance de savoir tomber, vous vous rappelez ? L’important, ce n’est pas la chute, parce que la chute, elle, est inévitable, l’important c’est de savoir se relever. Et nous nous relèverons.
— Vous êtes un chic type, Marcus. Mais les œillères de l’amitié vous empêchent de voir la vérité. Au fond, la question n’est pas tant de savoir si j’ai tué Nola, ou Deborah Cooper, ou même le Président Kennedy. Le problème est que j’ai eu cette relation avec cette gamine et que c’était un acte impardonnable. Et ce bouquin ? Qu’est-ce qui m’a pris d’écrire ce bouquin !
Je répétai :
— Nous nous relèverons, vous verrez. Vous vous rappelez cette raclée que je me suis prise à Lowell, dans ce hangar transformé en salle de boxe clandestine. Je ne me suis jamais aussi bien relevé.
Il se força à sourire, puis il demanda :
— Et vous ? Avez-vous reçu de nouvelles menaces ?
— Disons que chaque fois que je rentre à Goose Cove je me demande ce qui m’y attend.
— Trouvez celui qui fait ça, Marcus. Trouvez-le et foutez-lui une trempe du tonnerre. Je ne supporte pas l’idée que quelqu’un vous menace.
— Ne vous en faites pas.
— Et votre enquête ?
— Ça avance… Harry, j’ai commencé à écrire un livre.
— C’est formidable !
— C’est un livre sur vous. J’y parle de nous, de Burrows. Et je parle de votre histoire avec Nola. C’est un livre d’amour. Je crois en votre histoire d’amour.
— C’est un bel hommage.
— Alors vous me donnez votre bénédiction ?
— Bien entendu, Marcus. Vous savez, vous avez probablement été l’un de mes plus proches amis. Vous êtes un magnifique écrivain. Je suis très flatté d’être le sujet de votre prochain livre.
— Pourquoi utilisez-vous le passé ? Pourquoi dites-vous que j’ai été l’un de vos plus proches amis ? Nous le sommes toujours, non ?
Il eut un regard triste :
— J’ai dit ça comme ça.
Je lui attrapai les épaules.
— Nous serons toujours amis, Harry ! Je ne vous laisserai jamais tomber. Ce livre, c’est la preuve de mon indéfectible amitié.
— Merci, Marcus. Je suis touché. Mais l’amitié ne doit pas être le motif de ce livre.
— Comment ça ?
— Vous souvenez-vous de notre conversation, le jour où vous avez obtenu votre diplôme à Burrows ?
— Oui, nous avons fait une longue marche ensemble à travers le campus. Nous sommes allés jusqu’à la salle de boxe. Vous m’avez demandé ce que je comptais faire à présent, j’ai répondu que j’allais écrire un livre. Et là, vous m’avez demandé pourquoi j’écrivais. Je vous ai répondu que j’écrivais parce que j’aimais ça et vous m’avez répondu…
— Oui, que vous ai-je répondu ?
— Que la vie n’avait que peu de sens. Et qu’écrire donnait du sens à la vie.
— C’est cela, Marcus. Et c’est l’erreur que vous avez commise il y a quelques mois, lorsque Barnaski vous a réclamé un nouveau manuscrit. Vous vous êtes mis à écrire parce que vous deviez écrire un livre et non pas pour donner du sens à votre vie. Faire pour faire n’a jamais eu de sens : il n’y avait donc rien d’étonnant à ce que vous ayez été incapable d’écrire la moindre ligne. Le don de l’écriture est un don non pas parce que vous écrivez correctement, mais parce que vous pouvez donner du sens à votre vie. Tous les jours, des gens naissent, d’autres meurent. Tous les jours, des cohortes de travailleurs anonymes vont et viennent dans de grands buildings gris. Et puis il y a les écrivains. Les écrivains vivent la vie plus intensément que les autres, je crois. N’écrivez pas au nom de notre amitié, Marcus. Écrivez parce que c’est le seul moyen pour vous de faire de cette minuscule chose insignifiante qu’on appelle vie une expérience valable et gratifiante.
Читать дальше