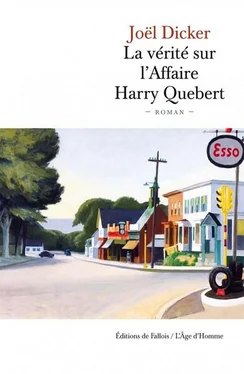— Je n’en sais rien.
— Est-ce que examens médico-légaux serait un terme plus adéquat ?
— Je me contrefous du terme précis. Ce que je peux vous dire, c’est qu’on lui a brisé le crâne ! Brisé ! Bam ! Bam !
Comme il accompagnait ses mots de gestes et mimait des coups de batte, je demandai :
— Alors c’était avec une batte ?
— Mais je n’en sais rien, bougre d’emmerdeur !
— Une femme ? Un homme ?
— Quoi ?
— Est-ce qu’une femme aurait pu porter ces coups ? Pourquoi forcément un homme ?
— Parce que le témoin visuel de l’époque, Deborah Cooper, a formellement identifié un homme. Bon, cette conversation est terminée, l’écrivain. Vous m’agacez beaucoup trop.
— Mais vous, qu’est-ce que vous pensez de cette affaire ?
Il sortit de son porte-monnaie une photo de famille.
— J’ai deux filles, l’écrivain. Quatorze et dix-sept ans. Je ne peux pas imaginer vivre ce que le père Kellergan a vécu. Je veux la vérité. Je veux la justice. La justice, ce n’est pas la somme de simples faits : c’est un travail bien plus complexe. Alors je vais poursuivre mon enquête. Si je découvre la preuve de l’innocence de Quebert, croyez-moi, il sera libéré. Mais s’il est coupable, soyez certain que je ne laisserai pas Roth faire au jury un de ses tours d’esbroufe dont il a le secret pour libérer les criminels. Parce que ça non plus, ce n’est pas de la justice.
Gahalowood, sous ses airs de bison agressif, avait une philosophie qui me plaisait.
— Au fond, vous êtes un chic type, sergent. Je vous paie des beignets et on continue de papoter ?
— Je ne veux pas de beignets, je veux que vous foutiez le camp. J’ai du travail.
— Mais il faut que vous m’expliquiez comment on enquête. Je ne sais pas enquêter. Comment dois-je faire ?
— Au revoir, l’écrivain. Je vous ai assez vu pour le reste de la semaine. Peut-être même le reste de ma vie.
J’étais déçu de ne pas être pris au sérieux et je n’insistai pas. Je lui tendis la main pour le saluer, il me broya les phalanges de sa grosse poigne et je m’en allai. Mais sur le parking extérieur, je l’entendis qui me hélait : « L’écrivain ! » Je me retournai et je le vis qui faisait trotter sa grosse masse dans ma direction.
— L’écrivain, me dit-il lorsqu’il m’eut rejoint, le souffle court. Les bons flics ne s’intéressent pas au tueur… mais à la victime. C’est à propos de la victime que vous devez vous interroger. Il faut commencer par le début, par avant le meurtre. Pas par la fin. Vous faites fausse route en vous concentrant sur le meurtre. Vous devez vous demander qui était la victime… Demandez-vous qui était Nola Kellergan…
— Et Deborah Cooper ?
— Si vous voulez mon avis, tout est lié à Nola. Deborah Cooper n’a été qu’une victime collatérale. Trouvez qui était Nola : vous trouverez son meurtrier et celui de la mère Cooper par la même occasion.
Qui était Nola Kellergan ? C’est la question que je comptais bien poser à Harry en me rendant à la prison d’État. Il avait mauvaise mine. Il semblait très préoccupé par le contenu de son casier de fitness.
— Vous avez tout trouvé ? me demanda-t-il avant même de me saluer.
— Oui.
— Et vous avez tout brûlé ?
— Oui.
— Le manuscrit aussi ?
— Le manuscrit aussi.
— Pourquoi ne m’avez-vous pas confirmé que c’était fait ? J’étais mort d’inquiétude ! Et où étiez-vous pendant ces deux jours ?
— Je menais mon enquête. Harry, pourquoi est-ce que cette boîte se trouvait dans un casier de fitness ?
— Je sais que ça va vous paraître bizarre… Après votre visite à Aurora, en mars, j’ai eu peur que quelqu’un d’autre trouve la boîte. Je me suis dit que n’importe qui pouvait tomber dessus : un visiteur sans gêne, la femme de ménage. J’ai jugé qu’il était plus prudent de cacher mes souvenirs ailleurs.
— Vous les avez cachés ? Mais ça fait de vous un coupable. Et ce manuscrit. C’était celui des Origines du mal ?
— Oui. La toute première version.
— J’ai reconnu le texte. Il n’y avait pas de titre sur la couverture…
— Le titre m’est venu après coup.
— Après la disparition de Nola, vous voulez dire ?
— Oui. Mais ne parlons pas de ce manuscrit, Marcus. Il est maudit, il n’a attiré que le mal autour de moi, la preuve : Nola est morte et je suis en prison.
Nous nous dévisageâmes un instant. Je déposai sur la table un sac en plastique dans lequel était le contenu de mon paquet.
— Qu’est-ce que c’est ? demanda Harry.
Sans répondre, j’en sortis un appareil à minidisque auquel était branché un micro, permettant d’effectuer des enregistrements. Je l’installai devant Harry.
— Marcus, nom d’un chien, qu’est-ce que vous fabriquez ? Ne me dites pas que vous avez conservé cette satanée machine…
— Bien sûr, Harry. Je l’ai gardée précieusement.
— Rangez-moi ça, voulez-vous ?
— Ne faites pas votre mauvaise tête, Harry…
— Mais que diable voulez-vous faire de cet engin ?
— Je veux que vous me parliez de Nola, d’Aurora, de tout. De l’été 1975, de votre livre. J’ai besoin de savoir. La vérité, Harry, doit figurer quelque part.
Il sourit tristement. J’enclenchai l’enregistreur et je le laissai parler. C’était une jolie scène : dans ce parloir de prison, où, parmi les tables en plastique, des maris retrouvaient leur femme, des pères retrouvaient leurs enfants, je retrouvais mon vieux maître qui me racontait son histoire.
Ce soir-là, je dînai de bonne heure, sur la route du retour vers Aurora. Après quoi, comme je n’avais pas envie de retourner tout de suite à Goose Cove et me retrouver seul dans cette immense maison, je longeai longuement la côte en voiture. Le jour déclinait, l’océan scintillait : tout était magnifique. Je passai le Sea Side Motel, la forêt de Side Creek, Side Creek Lane, Goose Cove, je traversai Aurora et je me rendis jusqu’à la plage de Grand Beach. Je marchai jusqu’au bord de l’eau, puis je m’assis sur les galets pour contempler la nuit naissante. Les lumières d’Aurora dansaient au loin dans le miroir des vagues ; les oiseaux d’eau poussaient des cris stridents, des rossignols chantaient dans les buissons alentour, j’entendais les cornes de brume des phares. Je mis en marche l’enregistreur, et la voix de Harry retentit dans l’obscurité :
Vous connaissez la plage de Grand Beach, Marcus ? C’est la première d’Aurora lorsqu’on a rrive depuis le Massachusetts. Parfois je m’y rends à la tombée de la nuit et je regarde les lumières de la ville. Et je repense à tout ce qui s’y est passé depuis trente ans. Cette plage est celle sur laquelle je m’arrêtai, le jour de mon arrivée à Aurora. C’était le 20 mai 1975. J’avais trente-quatre ans. J’arrivais de New York où je venais de décider de prendre mon destin en main : j’avais tout plaqué, j’avais quitté mon poste d’enseignant en littérature, j’avais rassemblé mes économies et j’avais décidé de tenter une aventure d’écrivain : m’isoler en Nouvelle-Angleterre et y écrire le roman dont je rêvais.
J’avais d’abord pensé louer une maison dans le Maine, mais un agent immobilier de Boston m’avait convaincu de porter mon choix sur Aurora. Il m’avait parlé d’une maison de rêve qui correspondait exactement à ce que je cherchais : c’était Goose Cove. À l’instant où je suis arrivé devant cette maison, j’en suis tombé amoureux. C’était l’endroit qu’il me fallait : une retraite calme et sauvage, sans être complètement isolée non plus, car à quelques miles seulement d’Aurora. La ville me plaisait beaucoup également. La vie y semblait douce, les enfants jouaient dans les rues en toute insouciance, le taux de criminalité était inexistant ; c’était un endroit de carte postale. La maison de Goose Cove était bien au-dessus de mes moyens mais l’agence de location accepta que je paie en deux fois, et je fis mes calculs : si je ne dépensais pas trop d’argent, je pourrais joindre les deux bouts. Et puis j’avais un pressentiment : celui que je faisais le bon choix. Je ne m’y trompai pas, puisque cette décision transforma ma vie : le livre que j’écrivis cet été-là allait faire de moi un homme riche et célèbre.
Читать дальше