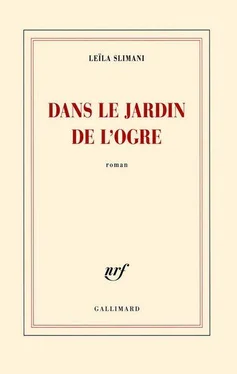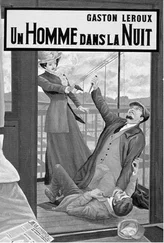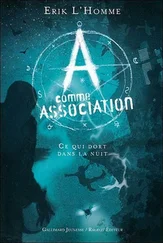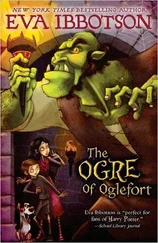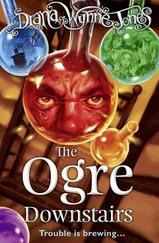Adèle les entend parler de Paris, de la boutique de Nicolas Verdon dans le 17 eet du travail d’Isabelle, dans une agence de publicité. Elle paraît plus âgée que son mari. Elle parle fort, rit beaucoup. On a beau être à la campagne, en plein été, elle porte une élégante blouse en soie noire. Elle a même mis des boucles d’oreilles. Quand Richard veut lui servir un verre de rosé, elle pose délicatement sa main sur son verre. « Ça ira pour moi. Je risque d’être pompette. »
Adèle revient s’asseoir avec eux, traînant Lucien dans son sillage.
« Richard nous racontait que vous aviez quitté Paris pour la campagne, s’enthousiasme Nicolas. Vous êtes bien ici. De la terre, des pierres, des arbres, que des choses vraies. Tout ce dont je rêve pour ma retraite.
— Oui. Cette maison est merveilleuse. »
Ils regardent tous en direction de l’allée de tilleuls que Richard a fait planter, deux par deux, face à face. Le soleil traverse les feuilles et répand sur le jardin une lumière phosphorescente, couleur menthe à l’eau.
Richard parle de son travail, de ce qu’il appelle « sa vision de la médecine ». Il raconte des histoires de patients, des histoires drôles et émouvantes qu’il ne raconte jamais à Adèle et qu’elle écoute, les yeux baissés. Elle voudrait que les invités s’en aillent et qu’ils restent là, tous les deux, dans la fraîcheur du soir. Qu’ils finissent, même en silence, même un peu fâchés, la bouteille de vin posée sur la table. Et qu’ils montent, l’un derrière l’autre, se coucher.
« Vous travaillez, Adèle ?
— Non. Mais j’étais journaliste à Paris.
— Et ça ne vous manque pas ?
— Travailler quarante heures par semaine pour gagner le même salaire que la nounou, je ne sais pas si c’est enviable, la coupe Richard.
— Tu me donnes une cigarette ? »
Richard sort le paquet de sa poche et le pose sur la table. Il a beaucoup bu.
Ils mangent sans appétit. Adèle est une mauvaise cuisinière. Les invités ont beau lui faire des compliments, elle sait que la viande est trop cuite, que les légumes n’ont aucun goût. Isabelle mâche lentement, le visage crispé, comme si elle avait peur de s’étouffer.
Adèle fume sans arrêt. Ses lèvres sont bleuies par le tabac. Elle soulève les sourcils quand Nicolas lui demande :
« Alors, Adèle, vous qui êtes dans le milieu, la situation en Égypte, vous en pensez quoi ? »
Elle ne lui dit pas qu’elle ne lit plus les journaux. Qu’elle n’allume pas la télévision. Qu’elle a même renoncé à voir des films. Elle a trop peur des histoires, d’amour, des scènes de sexe, des corps nus. Elle est trop nerveuse pour supporter l’agitation du monde.
« Je ne suis pas spécialiste de l’Égypte. Par contre…
— En revanche, corrige Richard.
— Oui, en revanche, j’ai beaucoup travaillé en Tunisie. »
La conversation devient commune, s’émousse, ralentit. Une fois épuisés tous les sujets que des inconnus peuvent aborder sans risque, ils ne trouvent plus grand-chose à se dire. On entend des bruits de fourchettes et de déglutition. Adèle se lève, la cigarette collée aux lèvres, un plat dans chaque main.
« Le grand air, ça fatigue. » Les Verdon répètent la plaisanterie trois fois et finissent par partir, presque poussés par Richard qui leur fait de grands signes, debout dans l’allée de gravier. Il les regarde rentrer chez eux, se demandant quels secrets, quelles failles, peut bien cacher ce couple ennuyeux.
« Tu les as trouvés comment ? demande-t-il à Adèle.
— Je ne sais pas. Gentils.
— Et lui ? Tu le trouves comment, lui ? »
Adèle ne lève pas les yeux de l’évier.
« Je te l’ai dit. Je les ai trouvés gentils. »
Adèle monte dans la chambre. Par la fenêtre, elles voient les Verdon tirer les volets. Elle s’allonge et ne bouge plus. Elle l’attend.
Pas une seule fois, ils n’ont fait chambre à part. La nuit, Adèle écoute son souffle, ses ronflements, tous ces bruits rauques qui font la vie à deux. Elle ferme les yeux et se fait toute petite. Le visage au bord du lit, la main dans le vide, elle n’ose pas se retourner. Elle pourrait déplier un genou, tendre le bras, faire semblant de dormir et effleurer sa peau. Mais elle ne bouge pas. Si elle le touchait, même par inadvertance, il pourrait se mettre en colère, changer d’avis, la jeter dehors.
Quand elle est sûre qu’il dort, Adèle se tourne. Elle le regarde, dans le lit qui tremble, dans cette chambre où tout lui paraît fragile. Plus aucun geste, jamais, ne sera innocent. Elle en conçoit une terreur et une joie immenses.
Lorsqu’il était interne, Richard a fait un stage aux urgences de la Pitié-Salpêtrière. Le genre de stage où on vous répète qu’« ici on apprend beaucoup, sur la médecine et la nature humaine ». Richard traitait surtout des cas de grippe, des accidentés de la route, des victimes d’agression, des malaises vagaux. Il pensait qu’il verrait des cas sortant de l’ordinaire. Le stage s’était révélé d’un ennui profond.
Il se souvient très bien de l’homme qui a été admis cette nuit-là. Un clochard dont le pantalon était souillé de merde. Il avait les yeux révulsés, de l’écume aux lèvres et son corps était secoué de tremblements. « Il convulse ? avait demandé Richard à son chef de service.
— Non. Il est en manque. Delirium tremens. Délire tremblant. »
Quand ils arrêtent de boire, les alcooliques sévères sombrent dans une crise de manque d’une violence insoutenable. « Trois à cinq jours après l’arrêt de la boisson, le malade se met à avoir des hallucinations vives, souvent visuelles et associées à des animaux rampants, le plus souvent à des serpents ou à des rats. Il est dans un état de désorientation extrême, souffre de délire paranoïde, est en proie à l’agitation. Certains entendent des voix, d’autres font des crises d’épilepsie. Lorsqu’ils ne sont pas pris en charge, une mort subite peut s’ensuivre. Les crises étant souvent pire la nuit, le patient aura besoin de compagnie. »
Richard avait veillé le clochard, qui se tapait la tête contre les murs et agitait les bras dans les airs pour faire fuir quelque chose. Il l’avait empêché de se faire mal, lui avait administré des calmants. Impassible, il avait découpé le pantalon souillé et frotté le corps du clochard. Il lui avait nettoyé le visage et taillé la barbe dans laquelle du vomi avait séché. Il lui avait même donné un bain.
Le matin, quand le patient avait repris le peu d’esprit qu’il lui restait, Richard avait tenté de lui expliquer. « Il ne faut pas arrêter comme ça. C’est très dangereux, vous voyez bien. Je sais, vous n’avez peut-être pas eu le choix, mais il y a des méthodes, des protocoles pour les gens dans votre cas. » L’homme ne le regardait pas. Le visage violet et gonflé, l’œil mangé par un ictère, il était de temps en temps ébranlé par un frisson, comme si un rat venait de lui courir sur le dos.
Au bout de quinze ans de pratique, le docteur Robinson peut dire qu’il connaît le corps humain. Que rien ne le rebute, que rien ne lui fait peur. Il sait déceler les signes, recouper les indices. Trouver des solutions. Il sait même mesurer la douleur, lui qui demande aux patients, « sur une échelle de un à dix, vous diriez que vous souffrez comment ? ».
Auprès d’Adèle, il a le sentiment d’avoir vécu avec une malade sans symptômes, d’avoir côtoyé un cancer dormant, qui ronge et ne dit pas son nom. Quand ils ont emménagé dans la maison, il a attendu qu’elle tombe. Qu’elle s’agite. Comme n’importe quelle toxicomane privée de sa drogue, il était convaincu qu’elle perdrait la raison et il s’y était préparé. Il s’était dit qu’il saurait quoi faire si elle devenait violente, si elle le rouait de coups, si elle se mettait à hurler la nuit. Si elle se scarifiait, qu’elle s’enfonçait un couteau sous les ongles. Il réagirait en scientifique, lui prescrirait des médicaments. Il la sauverait.
Читать дальше