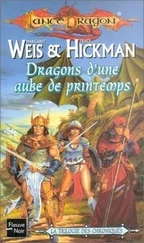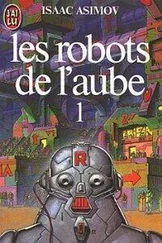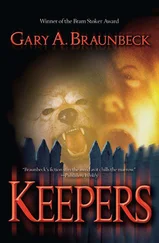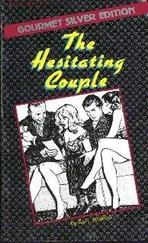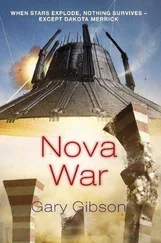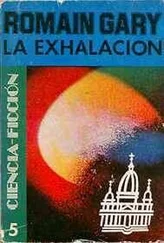Le débarquement dans le Midi coupa court à mon projet de parachutage. J'obtins immédiatement un ordre de mission tonitruant et impératif du général Corniglion-Molinier et avec l'aide des Américains – mon document portait, selon la formule habilement trouvée par le général lui-même, la mention: «Mission urgente de récupération» – je fus transporté de jeep en jeep jusqu'à Toulon; à partir de là, ce fut un peu plus compliqué. Mon ordre de mission péremptoire m'ouvrait cependant toutes les routes, et je me souviens de la remarque de Corniglion-Molinier, lorsqu'avec sa gentillesse toujours un peu sardonique il m'eut signé le document et que je le remerciai:
– Mais c'est très important pour nous, votre mission. C'est très important, une victoire…
Et l'air lui-même avait autour de moi une ivresse triomphale. Le ciel paraissait plus proche, plus conciliant, chaque olivier était un signe d'amitié et la Méditerranée venait vers moi par-dessus les cyprès et les pins, par-dessus les barbelés, les canons et les chars bousculés comme une nourrice retrouvée. J'avais fait prévenir ma mère de mon retour par dix messages différents qui avaient dû converger sur elle de tous côtés quelques heures à peine après l'entrée à Nice des troupes alliées. Le B.C.R.A. avait même transmis un message en code pour le maquis, huit jours auparavant. Le capitaine Vanurien, qui avait été parachuté dans la région deux semaines avant le débarquement, devait entrer en rapport avec elle immédiatement et lui dire que j'arrivais. Les camarades anglais du réseau Buckmaster m'avaient promis de veiller sur elle pendant les combats. J'avais beaucoup d'amis et ils comprenaient. Ils savaient bien qu'il ne s'agissait ni d'elle, ni de moi, mais de notre vieux compagnonnage humain, de notre coude à coude fraternel à la poursuite d'une œuvre commune de justice et de raison. Il y avait, dans mon cœur, une jeunesse, une confiance, une gratitude, dont la mer antique, notre plus fidèle témoin, devait si bien connaître les signes, depuis le premier retour d'un de ses fils victorieux à la maison. Le ruban vert et noir de la Libération bien en évidence sur ma poitrine, au-dessus de la Légion d'honneur, de la Croix de Guerre et de cinq ou six autres médailles dont je n'avais oublié aucune, les galons de capitaine sur les épaules de mon battle-dress noir, la casquette sur l'œil, l'air plus dur que jamais, à cause de la paralysie faciale, mon roman en français et en anglais dans la musette bourrée de coupures de presse et, dans ma poche, la lettre qui m'ouvrait les rangs de la Carrière, avec juste ce qu'il fallait de plomb dans le corps pour faire le poids, ivre d'espoir, de jeunesse, de certitude et de Méditerranée, debout, enfin, debout dans la clarté, sur un rivage béni où nulle souffrance, nul sacrifice, nul amour n'étaient jamais jetés au vent, où tout comptait, se tenait, signifiait, était pensé et accompli selon un art heureux, je revenais à la maison après avoir démontré l'honorabilité du monde, après avoir donné une forme et un sens au destin d'un être aimé.
Des G. I. noirs, assis sur les pierres, avec des sourires si grands et étincelants qu'ils en paraissaient éclairés de l'intérieur, comme si la lumière leur venait du cœur, levaient les mitraillettes en l'air à notre passage, et leur rire amical avait toute la joie et le bonheur des promesses tenues:
– Victory, man, victory!
Victoire, homme, victoire! Nous reprenions enfin possession du monde et chaque tank renversé ressemblait à la carcasse d'un dieu abattu. Des goumiers accroupis, aux visages aigus et jaunes sous le turban du chèche, faisaient cuire un bœuf entier sur un feu de bois; dans les vignes bouleversées, une queue d'avion était plantée comme une épée brisée, et, parmi les oliviers, sous les cyprès, des casemates de ciment borgnes, un canon mort pendait parfois avec son œil bête et rond de vaincu.
Debout, dans la jeep, dans ce paysage où les oliviers, les vignes, les orangers semblaient accourus de toutes parts pour m'accueillir, et où les trains renversés, les ponts écroulés, les barbelés tordus et emmêlés comme des haines mortes étaient à chaque tournant balayés par la clarté, ce fut seulement sur les pontons du Var que je cessai de voir les mains et les visages, que je ne cherchai plus à reconnaître les mille coins familiers, que je ne répondis plus aux signes joyeux des femmes et des enfants, et que je demeurai là, debout, accroché au pare-brise, tendu tout entier vers la ville qui approchait, vers le quartier, la maison, la silhouette aux bras ouverts qui devait m'attendre déjà sous le drapeau victorieux.
Je devrais interrompre ici ce récit. Je n'écris pas pour jeter une ombre plus grande sur la terre. Il m'en coûte de continuer et je vais le faire le plus rapidement possible, en ajoutant vite ces quelques mots, pour que tout soit fini et pour que je puisse laisser retomber ma tête sur le sable, au bord de l'Océan, dans la solitude de Big Sur où j'ai essayé en vain de fuir la promesse de finir ce récit.
A l'Hôtel-Pension Mermonts où je fis arrêter la jeep, il n'y avait personne pour m'accueillir. On y avait vaguement entendu parler de ma mère, mais on ne la connaissait pas. Mes amis étaient dispersés. Il me fallut plusieurs heures pour connaître la vérité. Ma mère était morte trois ans et demi auparavant, quelques mois après mon départ pour l'Angleterre.
Mais elle savait bien que je ne pouvais pas tenir debout sans me sentir soutenu par elle et elle avait pris ses précautions.
Au cours des derniers jours qui avaient précédé sa mort, elle avait écrit près de deux cent cinquante lettres, qu'elle avait fait parvenir à son amie en Suisse. Je ne devais pas savoir – les lettres devaient m'être expédiées régulièrement – c'était cela, sans doute, qu'elle combinait avec amour, lorsque j'avais saisi cette expression de ruse dans son regard, à la clinique Saint-Antoine, où j'étais venu la voir pour la dernière fois.
Je continuai donc à recevoir de ma mère la force et le courage qu'il me fallait pour persévérer, alors qu'elle était morte depuis plus de trois ans.
Le cordon ombilical avait continué à fonctionner.
C'est fini. La plage de Big Sur est vide sur cent kilomètres, mais lorsque je lève parfois la tête, je vois des phoques sur l'un des deux rochers devant moi, et sur l'autre, des milliers de cormorans, de mouettes et de pélicans, et parfois aussi le jet d'eau des baleines qui passent au large, et lorsque je reste ainsi une heure ou deux immobile sur le sable, un vautour se met à tourner lentement au-dessus de moi.
Il y a bien des années, maintenant, que ma chute s'est accomplie, et il me semble que c'est ici, sur les rochers de la plage de Big Sur que je suis tombé et que voilà une éternité que j'écoute et essaye de comprendre le murmure de l'Océan.
Je n'ai pas été vaincu loyalement.
J'ai les cheveux grisonnants, à présent, mais ils me cachent mal, et je n'ai pas vraiment vieilli, bien que je doive approcher maintenant de mes huit ans. Je ne voudrais surtout pas que l'on s'imagine que j'attache à tout cela trop d'importance, je refuse de donner à ma chute une signification universelle, et si le flambeau m'a été arraché des mains, je souris d'espoir et d'anticipation, en pensant à toutes les mains qui sont prêtes à le saisir, et à toutes nos forces cachées, latentes, naissantes, futures, qui n'ont pas encore donné. Je ne tire de ma fin aucune leçon, aucune résignation, je n'ai renoncé qu'à moi-même et il n'y a vraiment pas grand mal à cela.
Sans doute ai-je manqué de fraternité. Sans doute n'est-il pas permis d'aimer un seul être, fût-il votre mère, à ce point.
Mon erreur a été de croire aux victoires individuelles. Aujourd'hui que je n'existe plus, tout m'a été rendu. Les hommes, les peuples, toutes nos légions me sont devenus alliés, je ne parviens pas à épouser leurs querelles intestines et demeure tourné vers l'extérieur, au pied du ciel, comme une sentinelle oubliée. Je continue à me voir dans toutes les créatures vivantes et maltraitées et je suis devenu entièrement inapte aux combats fratricides.
Читать дальше