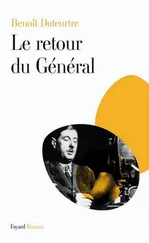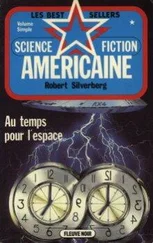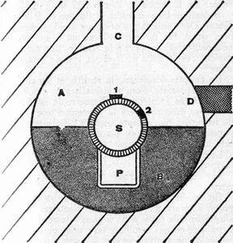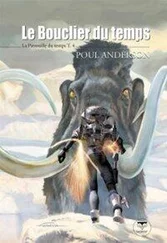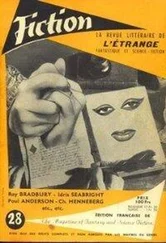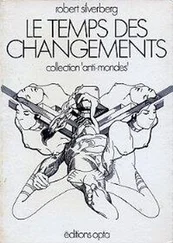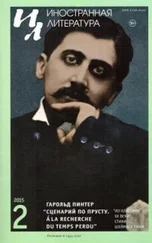– II a raison, il faut faire quelque chose pour le village.
A gauche du maire se tient Robert Pommier, le second adjoint.
Qui est Pommier? Ancien préposé de l'Électricité de France, il occupe sa retraite en entretenant ses voitures. Chaque matin, devant chez lui, il frotte, lustre, astique l'une de ses carrosseries (il en possède trois). Tous les deux jours, il se rend avec sa femme au centre commercial de la ville voisine; le lendemain matin, il s'agite а nouveau devant son garage, jet d'eau en main, pour nettoyer l'auto de la veille. Pommier est un homme méfiant. Lorsqu'un touriste en promenade, traversant le village, lui dit «bonjour», il le regarde passer sans répondre, l'oeil mauvais.
А droite du maire se tient Serge Navet, le premier adjoint.
Qui est Navet? L'homme le plus riche de la commune, propriétaire de l'usine d'incinération d'ordures située dans la lande, а deux kilomètres. Amoureux des machines, du développement, des grands projets, Navet prône l'industrialisation du village par les autochtones. Dès les années soixante, il a travaillé sur une chaîne de montage, avant de fonder sa propre entreprise. Il fut l'un des premiers habitants а posséder une voiture. Il aimerait doter la contrée des avantages d'une banlieue moderne: crèche, dispensaire, école de tir, élevage de chiens… Pour commencer, il rêve d'un vaste complexe d'incinération dont les cheminées s'aligneraient entre les pins et l'océan.
Le maire, de son côté, cherche а concilier l’industrie et le tourisme. Propriétaire d'un hôtel-restaurant, il sait que les estivants, randonneurs, baigneurs représentent un fonds de commerce pour ce village situé а quelques encablures de la mer, sur une côte encore sauvage. Mais ses trois cents électeurs l'ont doté d'une mission et d’un empire plus considérables: des milliers d'hectares des kilomètres de route, une usine en plein essor, grâce а sa matière première gratuite et inépuisable: l'ordure. А la soif de modernité de ses administrés, le maire doit savoir répondre. Fort de son pouvoir, il sent grandir son influence auprès des notables politiques régionaux, prestige qui lut permettra peut-être un jour – comme l'espère sa soeur, la secrétaire de mairie – de briguer un mandat de conseiller général.
Allié а Navet et а Pommier, le maire vient de lancer son plan de bataille. Avant la réunion, il a organisé un dîner а l'auberge. Les hommes sont éméchés. On dirait que leurs visages vont éclater, étranglés par leurs cravates. Certains ont conservé leur casquette. Ils se regardent autour de la table, les yeux brillants, et répètent:
– Il faut faire quelque chose pour le village.
Navet insiste:
– Nous vivons comme des exclus, en marge du progrès!
Les mots «progrès» et «exclus» ricochent d'une oreille а l'autre, réveillant une vieille frustration. Depuis longtemps, les paysans se sentent sur la touche. Le monde rural revendique: il a acquis l’éducation, l'auto, la télé; il ne s'arrêtera pas là. Robert Pommier lance sa formule:
– On ne veut pas être sacrifiés!
Les autres reprennent au vol, expriment par des grognemenrs leur désir d'entrer dans une nouvelle société. Les yeux cachés par ses lunettes teintées, Navet scande:
– Nous n'accepterons pas cette fracture sociale!
Propriétaire d'un vaste domaine dans la lande, Navet a donné corps, quelques années plus tôt, au rêve de son épouse: une maison coloniale aux murs habillés de bois, colonnes, terrasses et balcons comme ceux d' Autant en emporte le vent … A l'approche de la retraite, il incarne la réussite sociale au village. La plupart des habitants ont un frère, un fils, un neveu employé а l'usine; mais Navet sait se montrer simple. Il n'est pas bêcheur. II a gardé son accent, ses habitudes de bistrot. Il savoure sa victoire avec modestie.
Il se tourne vers le maire; leurs deux regards se consultent silencieusement pour déclencher la seconde phase des opérations. Dans la salle, les hommes s'énervent en répétant, sur un ton obstiné:
– Ni sacrifiés!
– Ni exclus!
– Désenclavons le village!
Ils énumèrent ces richesses dont on les a privés: réseau autoroutier, hypermarchés, zones industrielles, trains а grande vitesse, plate-forme de lancement de satellites… Et, tandis qu'une voix éteinte prône la patience, d'autres voix parlent plus fort pour exiger tout, tout de suite!
Le maire entreprend alors, pour les calmer, de dévoiler les premières mesures de son plan. D’une voix posée, modeste, il rappelle ses concitoyens а la réalité:
– Évidemment, notre commune n'a que de petits moyens. Nous ne sommes pas riches…
Les membres du conseil se regardent, abattus par des siècles d'injustice. Pommier allume une gitane maïs.
– Toutefois, poursuit le maire…
Une lueur brille dans les yeux.
– Toutefois, mes relations au conseil général et а la direction départementale de l'Équipement m'ont valu la promesse d'un Contrat d'aide au développement . J'ai le texte sous les yeux: «revaloriser les sites», «désenclaver les petites communes», «stimuler l'économie locale»…
Le maire laisse passer un silence. Il observe ses conseillers, s'avachit sur la table pour ne pas se donner trop d'importance. Il poursuit:
– Ayant mis bout а bout les différentes ressources dont nous pourrions disposer – subvention du département, taxe d'habitation, taxe professionnelle -, et en accord avec les industriels locaux (il se tourne solennellement vers Navet), voici les grands axes du plan de développement que je soumets а la délibération du conseil municipal:
1) Extension de l'usine d'incinération, qui fournit la majeure partie des ressources budgétaires de la commune… C'est capital!
2°) Cette extension permettra le financement d’un parking, de toilettes publiques et d'autres équipements favorisant la halte du touriste dans notre village.
3°) Programme de gestion du paysage traditionnel: construction d'un sentier de découverte balisé conduisant du village au littoral.
4°) Élargissement de la route départementale, première étape d'un plan de désenclavement routier…»
Un mouvement d'approbation passe dans le conseil. Le maire poursuit:
«- Cet élargissement favorisera les flux touristiques et les flux de poids lourds chargés d'alimenter l'usine en ordures.
5°) Ouverture d'un terrain de motocross en bordure de l'espace dunaire.
6°) Organisation d'une fête traditionnelle avec accueil convivial et verre de l'amitié.»
S'éloignant de l'hôtel, Patrick traversa les prairies où paissaient des troupeaux de moutons. Il s'enfonça dans la lande par un sentier, plongea dans la lumière jaune d'un pétit bois de sureau, déboucha dans un champ de trèfles et retrouva bientôt la trace du sentier, fier de s'orienter aisément, quand un touriste ordinaire se serait égare.
Chaque année, au printemps, Patrick venait passer une semaine au village, pour se reposer des tournées qu'il n'avait pas accomplies. Quarante ans, comédien au chômage, originaire de la région, il aimait la campagne et les conversations de bistrot. Grand et mince, le visage osseux, il portait par habitude une queue-de-cheval, qu'il avait longtemps considérée comme une marque d'affranchissement.
Patrick jouait les rôles comiques avec un certain talent, mais un tic absurde entravait – selon lui – l'épanouissement de sa carrière. A intervalles réguliers mais imprévisibles, sa bouche se crispait, il clignait de l'oeil а deux ou trois reprises, puis le symptôme passait. Adolescent, ses parents l'avaient envoyé consulter une psychologue; faute de le guérir, celle-ci l'avait persuadé de suivre sa vocation (elle évoquait le cas d'un acteur célèbre qui maîtrisait ses tics dès qu'il entrait en scène). Malgré un prix de théâtre, obtenu avec félicitations du Jury, la carrière n'avait pas suivi. Patrick vivait а Paris dans une chambre de bonne, donnait des cours dans un conservatoire de banlieue, séduisait parfois l'une de ses élèves; mais il n'aimait rien tant que ces promenades dans la lande, ce petit voyage rituel au cours duquel il se confrontait, pendant huit jours, aux questions de la nature,
Читать дальше