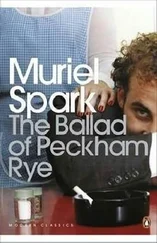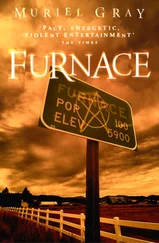Ce petit échange me perturbe et tandis que j’arpente les allées du marché, Gégène emplit tout entier mes pensées. Je n’ai jamais crédité les pauvres de grandeur d’âme sous prétexte qu’ils sont pauvres et au fait des injustices de la vie. Mais je les croyais au moins unis dans la haine des grands propriétaires. Gégène me détrompe et m’apprend cela : s’il y a bien une chose que les pauvres détestent, ce sont les autres pauvres.
Au fond, ce n’est pas absurde.
Je parcours distraitement les allées, rallie le coin des fromagers, achète du parmesan à la coupe et un beau morceau de soumaintrain.
Lorsque je suis angoissée, je me rends au refuge. Nul besoin de voyager ; m’en aller rejoindre les sphères de ma mémoire littéraire suffit à l’affaire. Car quelle plus noble distraction, n’est-ce pas, quelle plus distrayante compagnie, quelle plus délicieuse transe que celle de la littérature ?
Me voici donc subitement devant un éventaire d’olives, à penser à Riabinine. Pourquoi Riabinine ? Parce que Gégène porte une redingote désuète, avec de longs pans ornés de boutons très bas par-derrière, qui m’a fait penser à celle de Riabinine. Dans Anna Karénine , Riabinine, négociant en bois portant redingote, vient conclure chez Lévine, l’aristocrate campagnard, une vente avec Stépane Oblonski, l’aristocrate moscovite. Le négociant jure par ses grands dieux qu’Oblonski gagne à la transaction tandis que Lévine l’accuse de dépouiller son ami d’un bois qui vaut trois fois plus. La scène est précédée d’un dialogue où Lévine demande à Oblonski s’il a compté les arbres de son bois.
— Comment cela, compter les arbres ? s’exclame le gentilhomme, autant compter les sables de la mer !
— Sois certain que Riabinine les a comptés, rétorque Lévine.
J’affectionne tout particulièrement cette scène, d’abord parce qu’elle se déroule à Pokrovskoie, dans la campagne russe. Ah, la campagne russe... Elle a ce charme si spécial des contrées sauvages et cependant unies à l’homme par la solidarité de cette terre dont nous sommes tous faits... La plus belle scène d’Anna Karénine se passe à Pokrovskoie. Lévine, sombre et mélancolique, tente d’oublier Kitty. C’est le printemps, il s’en va aux champs faucher avec ses paysans. La tâche lui semble d’abord trop rude. Bientôt, il va crier grâce, quand le vieux paysan qui mène la ligne ordonne un répit. Puis le fauchage reprend. De nouveau, Lévine tombe d’épuisement mais, une seconde fois, le vieux lève la faux. Repos. Et la ligne se remet en marche, quarante gars abattant les andains et avançant vers la rivière tandis que le soleil se lève. Il fait de plus en plus chaud, les bras et les épaules de Lévine sont inondés de sueur mais au gré des arrêts et des reprises, ses gestes d’abord gauches et douloureux se font de plus en plus fluides. Une bienheureuse fraîcheur nappe soudain son dos. Pluie d’été. Peu à peu, il déleste ses mouvements de l’entrave de sa volonté, entre dans la transe légère qui donne aux gestes la perfection des actes mécaniques et conscients, sans réflexion ni calcul, et la faux semble se manier d’elle-même tandis que Lévine se délecte de cet oubli dans le mouvement qui rend le plaisir de faire merveilleusement étranger aux efforts de la volonté.
Ainsi en va-t-il de bien des moments heureux de notre existence. Déchargés du fardeau de la décision et de l’intention, voguant sur nos mers intérieures, nous assistons comme aux actions d’un autre à nos divers mouvements et en admirons pourtant l’involontaire excellence. Quelle autre raison pourrais-je avoir d’écrire ceci, ce dérisoire journal d’une concierge vieillissante, si l’écriture ne tenait pas elle-même de l’art du fauchage ? Lorsque les lignes deviennent leurs propres démiurges, lorsque j’assiste, tel un miraculeux insu, à la naissance sur le papier de phrases qui échappent à ma volonté et, s’inscrivant malgré moi sur la feuille, m’apprennent ce que je ne savais ni ne croyais vouloir, je jouis de cet accouchement sans douleur, de cette évidence non concertée, de suivre sans labeur ni certitude, avec le bonheur des étonnements sincères, une plume qui me guide et me porte.
Alors, j’accède, dans la pleine évidence et texture de moi-même, à un oubli de moi qui confine à l’extase, je goûte la bienheureuse quiétude d’une conscience spectatrice.
Enfin, remontant en charrette, Riabinine se plaint ouvertement à son commis des façons des beaux messieurs.
— Et par rapport à l’achat, Mikhaïl Ignatitch ? lui demande le gaillard.
— Hé, hé !... répond le négociant.
Comme nous concluons vite, de l’apparence et de la position, à l’intelligence des êtres... Riabinine, comptable des sables de la mer, habile comédien et manipulateur brillant, n’a cure des préjugés qui portent sur sa personne. Né intelligent et paria, la gloire ne l’attire pas ; seules le jettent sur les routes la promesse du profit et la perspective de s’en aller détrousser poliment les seigneurs d’un système imbécile qui le tient en mépris mais ne sait le freiner. Ainsi suis-je, pauvre concierge résignée à l’absence de faste — mais anomalie d’un système qui s’en révèle grotesque et dont je me gausse doucement, chaque jour, en un for intérieur que personne ne pénètre.
Si tu oublies le futur
Tu perds
Le présent
Aujourd’hui, nous sommes allés à Chatou voir mamie Josse, la mère de papa, qui est depuis deux semaines dans une maison de retraite. Papa est allé avec elle quand elle s’y est installée et là, on y est allés tous ensemble. Mamie ne peut plus vivre toute seule dans sa grande maison de Chatou : elle est quasiment aveugle, elle a de l’arthrose et ne peut presque plus marcher ni tenir quelque chose dans ses mains et elle a peur dès qu’elle est toute seule. Ses enfants (papa, mon oncle François et ma tante Laure) ont bien essayé de gérer l’affaire avec une infirmière privée mais elle ne pouvait quand même pas rester 24 heures sur 24, sans compter que les amies de mamie étaient elles aussi déjà en maison de retraite et que ça semblait donc une bonne solution.
La maison de retraite de mamie, c’est quelque chose. Je me demande combien ça coûte par mois, un mouroir de luxe ? La chambre de mamie est grande et claire, avec des beaux meubles, des beaux rideaux, un petit salon attenant et une salle de bains avec une baignoire en marbre. Maman et Colombe se sont extasiées devant la baignoire en marbre, comme si ça avait le moindre intérêt pour mamie que la baignoire soit en marbre alors que ses doigts sont en béton... En plus, le marbre, c’est moche. Papa, lui, n’a pas dit grand-chose. Je sais qu’il se sent coupable que sa mère soit dans une maison de retraite. « On ne va quand même pas la prendre avec nous ? » a dit maman quand ils croyaient tous ies deux que je n’entendais pas (mais j’entends tout, spécialement ce qui ne m’est pas destiné). « Non, Solange, bien sûr que non... » a répondu papa sur un ton qui voulait dire : « Je fais comme si je pensais le contraire tout en disant "non, non" d’un air las et résigné, en bon mari qui se soumet et comme ça je garde le beau rôle. » Je connais bien ce ton-là chez papa. Il signifie : « Je sais que je suis lâche mais que personne ne s’avise de me le dire. » Évidemment, ça n’a pas loupé : « Tu es vraiment lâche », a dit maman en balançant rageusement un torchon dans l’évier. Dès qu’elle est en colère, c’est curieux, il faut qu’elle jette quelque chose. Une fois, elle a même jeté Constitution. « Tu n’en as pas plus envie que moi », a-t-elle repris en récupérant le torchon et en l’agitant sous le nez de papa. « De toute façon, c’est fait », a dit papa, ce qui est une parole de lâche puissance dix.
Читать дальше