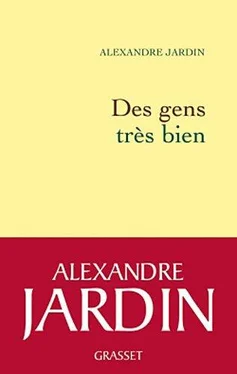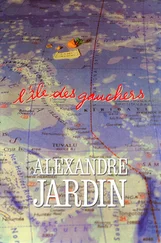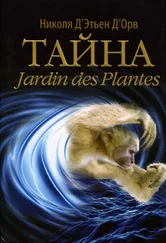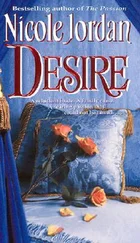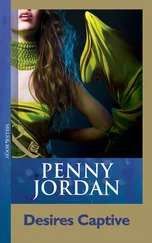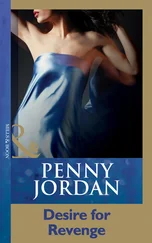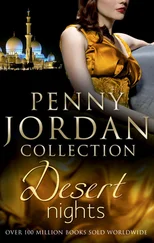Sans affirmer que ce témoignage fondamental prouve surtout que Vichy pouvait savoir ou savait ; car, jusqu'à preuve du contraire, il entre dans les obligations des Renseignements généraux de renseigner le chef du gouvernement.
Mais si Joly semble ne pas insister sur ce qui me frappe, moi, dans son document majeur (tout en reproduisant en fac-similé les pages manuscrites clés du rapport Sadosky), sans doute est-ce tout simplement parce que sa névrose - nous en avons tous ! - est distincte de la mienne. Mon hérédité blessée m'a rendu si sensible à ces interrogations ! Sommes-nous tous condamnés à ne percevoir que ce qui résonne avec nos douleurs ? A moins que Laurent Joly, en historien émérite, n'ait pas tiré les mêmes conclusions que moi par souci d'éviter un anachronisme ; car cette révélation fracassante passe bien dans le récit de Sadosky pour quelque chose de quasi normal, ne méritant aucun étonnement.
Lorsque j'ai refermé ce livre désespérant, j'ai repris le combat pour développer Lire et faire lire. A marche forcée. Il me fallait une dose d'espoir, de réparation aussi. Un jour, nous réussirons à faire des Français un peuple du livre.
De la nécessité de trahir
Trois grands traîtres ont gouverné mes songes : Charles de Gaulle, le Portugais Gil Eanes et le mahatma Gandhi. Je leur dois une passion folle pour la renaissance, fût-ce au prix d'une rupture sans appel avec les croyances de leur milieu d'origine ou d'adoption. Sans doute sommes-nous constitués de nos admirations plus que de nos gènes.
Le 18 juin 1940, qu'accomplit de Gaulle? Il rompt avec la culture d'obéissance qui lui a été inculquée depuis l'enfance, avec sa caste militaire qui se range d'un seul homme sous le pavillon de la collaboration. Toute la France catholique et maurrassienne, ou presque, se dandine dans le sillage du maréchal Pétain ; lui se dresse contre son ancien chef. Culturellement, de Gaulle ne devait pas être à Londres ; il y est pourtant. Né dans une famille conservatrice sensible à la mystique de l'Empire, il ne devait pas non plus être le grand décolonisateur qu'il se révélera être. Anticommuniste de famille, il gouverne avec le Parti communiste à la Libération. Sans cesse, il s'arrache à ses déterminismes. Homme de toutes les rigidités privées, il se découvre surdoué de la trahison politique dès que l'intérêt général le commande. Les Pieds Noirs en savent quelque chose. Sans cette aptitude exceptionnelle à liquider ses anciennes fidélités, que serait devenue la France ?
Au XVe siècle, Gil Eanes est le premier navigateur occidental à doubler le cabo Bojador dit cap de la Peur, situé au large du Maroc méridional. Pendant deux mille ans, les Européens y ont vu la limite physique du monde, le cap effrayant au-delà duquel on tombait dans le vide ou on sombrait dans une insondable mer de ténèbres. Ce mur psychologique, supposément infranchissable, est pourtant enfoncé en mai 1434 par Gil Eanes, un capitaine portugais qui, le premier, ose transgresser cette trouille multiséculaire en s'aventurant le long de la côte africaine. Il récuse tout ce que son père marin lui a enseigné, désobéit aux mythes anciens qui avaient alors statut de vérités et ouvre la route aux grandes explorations. En 1434, cet infidèle à l'héritage occidental fait renaître le monde. Gil Eanes n'a pas cru à la vérité de ses pères et pairs. Nous devons à son incroyable déloyauté une Terre ronde.
Ce culotté m'a fait aimer l'idée de franchir tous les caps de la Peur.
Quant à l'intrépide Gandhi, il brave avec détermination l'opinion de sa caste - qui le répudie pour cela - en s'embarquant en 1888 pour aller suivre des études de droit à Londres. Placé immédiatement hors caste par le chef de sa communauté, il ose devenir lui-même en se coulant pendant cinq ans dans le moule du parfait gentleman britannique. Puis, admis au barreau d'Angleterre et du pays de Galles, Gandhi divorce d'avec sa nouvelle classe blanche privilégiée et file s'établir en Afrique du Sud où il rompra avec ses intérêts en s'engageant dans un combat qui fera de lui le libérateur de six cents millions d'Indiens. Nettoyant lui-même ses latrines (tâche strictement réservée aux intouchables), il ne cesse d'enfreindre les dogmes de la nation dont il se fait le héraut. Indépendantiste intensément paradoxal, il exige de ses troupes (renâclantes) une participation sans état d'âme à l'effort de guerre britannique. Sans son génie de l'infidélité, sans doute n'aurait-il pas rejoint des fidélités supérieures.
J'aime ces félons de beau calibre, ces adeptes du coup de grisou identitaire qui, par-delà les apparences, s'inscrivent dans des fidélités profondes. Et si l'avenir était aux traîtres ?
Mort d'un ami
Le 11 septembre 2001, l'incroyable s'engouffra dans nos téléviseurs. Je voulus aussitôt y voir un événement faisant écho aux transes disciplinées de Nuremberg. Ce n'était pas tant la scène filmée - qui repassait en boucle sur nos écrans, donnant la sensation d'un chaos toujours recommencé - qui m'imposa sa charge émotionnelle que la sensation d'être à nouveau en présence de l'impensable. Ce pataquès aérien respirait la rumination politique d'exception, ourdie par des âmes mirobolantes. L'odeur du tout est possible flottait à nouveau sur le réel.
Comme lorsque Hitler imagina de remodeler la biologie humaine.
Tout en donnant à l'Allemagne l'habitude de ne décider que des choses déraisonnables.
Mais le plus saisissant pour moi ne survint que le lendemain du jour où les Twin Towers s'effondrèrent en poudre. En tout début de soirée, encore étourdi par ce tourniquet d'émotions planétaires, je reçus un appel couperet de Leni Frank. Sa voix était blanche :
- Zac vient de mourir à New York.
- Dans les tours ?
- Non, accident cardiaque.
- Pardon ?
- Son cœur a lâché d'un coup, pendant qu'il dormait. Trop gros sans doute. Tout Zac...
Ce soir-là, frappé à l'os, je n'ai rien dit à mon entourage.
J'avais trop mal pour être triste.
J'ai même ri abondamment, pour ligaturer mon chagrin.
Depuis l'adolescence, notre amitié était restée inapparente ; dans les coulisses de nos vies surmenées. Notre lien avait été entièrement dédié à nos échanges véhéments sur le pire. Zac me désidérait de ma honte. Nous n'avions pas su nous accrocher autrement.
Et il s'en allait fortuitement, sans que nous ayons jamais osé parler de sa grand-mère, encore vivante, et de son brumeux grand-père SS mort en 1945. Légataires de souvenirs assourdissants, nous n'avions pas su aborder le dossier de sa propre culpabilité. En s'occupant de la mienne, avait-il pris soin de la sienne ? S'était-il chargé d'éclairer ma conscience pour approcher en biais ses propres interrogations ?
A l'enterrement, dans le cimetière juif de Bagneux, près de Paris, le clan des Frank était là, enlacé. Détruit par le séisme d'un étrange lendemain du 11-Septembre où Ben Laden n'avait aucune part. Zac n'avait pas eu de fils (ni d'enfant) pour réciter le kaddish ; comme s'il avait - consciemment ? - renoncé à perpétuer son lignage difficile. Stériliser son ADN partiellement nazi semblait avoir été sa réponse instinctive.
Seule, une très vieille dame se trouvait à l'écart, engoncée dans une chaise roulante poussée par une infirmière solennelle. Elle avait fait le voyage depuis Montreux, en Suisse : c'était Eva, sa grand-mère allemande exilée au pied des Alpes, en un lieu aussi pur qu'avait été glauque et violent son passé. L'hitlérienne de la famille se tenait digne et droite comme un cri, en retrait, ne demandant rien. Elle pleurait.
En sortant du cimetière, l'octogénaire est venue directement vers moi et m'a interpellé de sa voix étrange. Elle possédait, dans les harmoniques, un vibrato qui trahissait le côté construit de son élocution ; comme si elle s'était contrainte, de longue date, à dompter son accent germanique :
Читать дальше