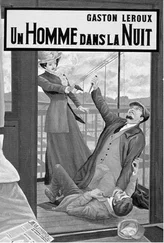L’inscription blanche toute fraîche luisait sur la façade noire criblée de trous. Les traînées de peinture avaient dégouliné le long du mur et formaient des taches sur le sol. « Nos murs sont brisés, pas nos cœurs ! »
Oui, mais c’est parce que vous n’en avez pas ! Que des grandes phrases, des formules creuses sur les murs des maisons, à la radio, au-dessus des portails des camps.
À chacun selon son dû ! « A chacun » y avait-on écrit et pas toujours uniquement aux autres ! Vous comprenez ? Regardez autour de vous, la gueule que ça a, tout ça, tout est foutu… A chacun selon son dû !
Il appuya plus fort sur les pédales, tourna à droite dans la rue de Varsovie, prit de nouveau place dans une file de cyclistes qui se dirigeait vers le port de l’Est. Ils roulaient à la file indienne, disciplinés, s’efforçant de rester dans l’étroit chemin qu’on avait dégagé entre les ruines.
En rangs. Comme vous l’avez appris.
Le passage s’élargit. Il accéléra pour dépasser ceux qui pédalaient devant lui. Le vent froid de la course lui piquait les yeux. Il avait trop longtemps fait partie de la cohorte des suivistes. Crétin d’électeur sans cervelle de 1933, il avait détourné le regard, ne s’était intéressé à rien. Jusqu’à ce qu’il se retrouve broyé lui-même sous les meules brunes. Et c’est à partir de là qu’il avait commencé à comprendre ce que cette lie entendait réellement par discipline, éducation et ordre. Il dépassa un groupe d’ouvriers avant la légère montée qui menait au pont Oberbaum. Ils l’encouragèrent de la voix :
« Vas-y, camarade, fonce, file, magne-toi de terminer enfin l’arme-miracle ! »
Au milieu du pont, il entendait encore le rire des hommes qui le poursuivait.
Les premiers rayons de soleil faisaient scintiller les vaguelettes sur la Spree. Il ralentit, se servit de la déclivité pour descendre en roue libre vers la gare de Görlitz. Il atteignit rapidement sa destination. Il allait enfin pouvoir vérifier si l’information que la Frick lui avait lâchée sous les coups se révélait exacte.
Le café était plus grand qu’il ne l’avait imaginé. Une vaste salle s’ouvrait devant lui, s’élargissant vers le fond. Devant les fenêtres, des banquettes et devant chaque banquette, une table et des chaises. Un large passage les séparait du long comptoir assiégé par des hommes qui parlaient haut et fort. Beaucoup portaient des bleus de travail, des salopettes de mécanicien, des habits de maçon ou des velours de charpentier.
Quelques individus, assis seuls à une table, lisaient le journal ou prenaient leur petit déjeuner. Une délicieuse odeur d’oignons, de saucisse de foie et de pain grillé le disputait à celle de la fumée de cigarettes qui stagnait dans la pièce.
Il passa lentement devant le comptoir où il ne restait plus une seule place libre et chercha une table du côté du mur aveugle, une place au fond d’où il pourrait garder un œil sur la porte. Personne ne paraissait vraiment faire attention à lui.
Les nombreux clients et les chaudes vapeurs de cuisine conféraient à la pièce une chaleur supportable. Il quitta son lourd manteau, le suspendit avec son chapeau à une patère surchargée et contempla les deux femmes blondes affairées derrière le comptoir. La plus jeune s’occupait des boissons, tirait des bières pression ou remplissait des verres de schnaps. L’autre devait avoir dix ans de plus. Elle prenait les commandes, servait les repas et les boissons. Elle se déplaçait avec habileté entre les tables, le comptoir et la cuisine, dont elle ouvrait la porte battante d’un solide coup de reins. Il n’aurait su dire pourquoi, mais elle lui rappelait un peu Lotti. Pas à cause de son physique. Lotti était brune, avait plutôt le type du Sud. Mais cette serveuse en avait des airs, cette féminité voluptueuse, indéniable. Il ne pouvait s’empêcher de la regarder et elle finit par le remarquer. Elle se dirigea vers lui en s’essuyant les mains à son tablier.
— Bonjour ! Monsieur désire ?
Il jeta un bref coup d’œil à la courte carte.
— Je crois que je vais prendre un pot de camomille, un sandwich à la saucisse de foie avec des cornichons et des œufs brouillés.
— Je vous apporte ça tout de suite.
Elle lui sourit, tourna les talons et disparut derrière la porte battante de la cuisine.
Le café se remplissait. Certains s’arrêtaient de discuter, quittaient le comptoir, saluaient bruyamment à la ronde et sortaient, tout aussitôt remplacés par de nouveaux groupes qui s’y pressaient à leur tour. Comptoir et tables étaient complets. Il s’étonna de voir autant d’hommes à cette heure matinale. Sans doute à cause du changement d’équipes. Le bistrot était au carrefour des quartiers de Kreuzberg, Friedrichshain et Neukölln, et les ouvriers venaient vraisemblablement des usines environnantes pour arroser d’une bière avec schnaps le début ou la fin du travail.
Il connaissait cette atmosphère chaude et tranquille et n’arrivait pas à s’en défaire. Jadis, il s’autorisait tous les jeudis une soirée dans son bistrot habituel. Toujours après la fermeture du magasin. Des années durant. Une soupe aux pois cassés, puis un schnaps et quatre demis. Il avait maintenu ce jour de sortie, même après son mariage avec Lotti et la naissance de Fritzchen. C’était son jour, son jeudi sans famille.
Le café lui sembla une oasis en plein milieu d’un désert de ruines. Ou une île pour buveurs de bière, pour hommes seuls dont les femmes ou les familles avaient été évacuées à la campagne. Ou pour ceux qui commençaient à se rendre compte que leurs hurlements d’enthousiasme pour le Führer les avaient bel et bien mis dans de beaux draps et qui voulaient noyer cette lueur d’intelligence dans l’alcool. Il se leva et se fraya un chemin jusqu’à la table des journaux. Les quotidiens étaient déjà pris. Restaient les hebdomadaires, Der Stürmer, Der Schwarze Korps et Das Reich. Il se décida à contrecœur pour Das Reich et regagna sa place.
« Bataille défensive sur le secteur nord du front est. » Il ne s’intéressa pas particulièrement aux nouvelles de la guerre, pas plus qu’à un article où il était question d’une insurrection à Varsovie. En revanche, un éditorial de Goebbels attira son attention : « Prêts à tout et déterminés ». Dès les premières lignes, il comprit que leur auteur sentait la fin proche… C’était le dernier sursaut, puis c’en serait fini de la gloire, des forfanteries, des grandes gueules.
« À la guerre, il n’y a pas d’erreur plus grave que de se faire de vaines illusions au moment où l’on remporte des succès. Un peuple n'est pas vaincu parce qu'il a subi une série de revers militaires. Il en faut beaucoup pour vaincre une grande nation, et le plus souvent elle ne l’est vraiment que quand elle se déclare elle-même perdue. Du Führer au dernier homme, à la dernière femme, au dernier enfant même, la nation est prête à tout et déterminée à tout. Nous sommes simplement nés dans le malheur et d’effroyables douleurs. Le monde nouveau que nous rêvons n'est pas perdu. Nous n'en abandonnerons pas l’idée jusqu'à ce que le destin nous exauce. Les faibles peuvent périr, restent les forts. A nous de décider de quel côté nous sommes. Qui pourrait douter de notre choix ! »
Il se prit la tête dans les mains et jeta un œil à travers la fenêtre à moitié tendue d’un rideau de dentelle. Il a raison, le pied-bot. Certes, pas au sens où il l’entend, mais ce qu’il dit est vrai, à condition de mettre ses paroles en perspective : un homme n’est pas vaincu parce qu’il a subi une série d’échecs personnels. Il en faut beaucoup pour ôter la vie à un homme, et il n’est définitivement perdu que lorsqu’il s’est dit lui-même perdu.
Читать дальше