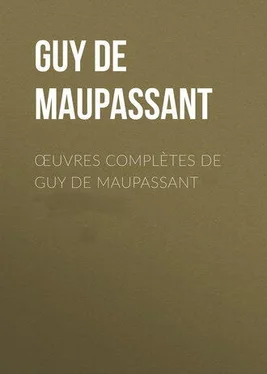Guy de Maupassant - Les sœurs Rondoli (1884)
Здесь есть возможность читать онлайн «Guy de Maupassant - Les sœurs Rondoli (1884)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Классическая проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Les sœurs Rondoli (1884)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Les sœurs Rondoli (1884): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Les sœurs Rondoli (1884)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La plupart des contes ont fait l'objet d'une publication antérieure dans des journaux comme Le Gaulois ou Gil Blas, parfois sous le pseudonyme de Maufrigneuse.
Les sœurs Rondoli (1884) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Les sœurs Rondoli (1884)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Or, un soir, comme il se trouvait à Rouen il voulut aller embrasser sa femme qu’il n’avait point vue depuis une semaine ; et il prit le train de neuf heures qui devait le mettre à minuit chez lui.
Il avait sa clef. Il entra sans bruit, frémissant de plaisir, tout heureux de lui faire cette surprise. Elle s’était enfermée, quel ennui ! Alors il cria à travers la porte : « Jeanne, c’est moi ! »
Elle dut avoir grand’peur, car il l’entendit sauter du lit et parler seule comme dans un rêve. Puis elle courut à son cabinet de toilette, l’ouvrit et le referma, traversa plusieurs fois sa chambre dans une course rapide, nu-pieds, secouant les meubles dont les verreries sonnaient. Puis, enfin, elle demanda : « C’est bien toi, Alexandre ? »
Il répondit : « Mais oui, c’est moi, ouvre donc ! »
La porte céda, et sa femme se jeta sur son cœur en balbutiant : « Oh ! quelle terreur ! quelle surprise ! quelle joie ! »
Alors, il commença à se dévêtir, méthodiquement, comme il faisait tout. Et il reprit, sur une chaise, son pardessus qu’il avait l’habitude d’accrocher dans le vestibule. Mais, soudain, il demeura stupéfait. La boutonnière portait un ruban rouge !
Il balbutia : « Ce… ce… ce paletot est décoré ! »
Alors sa femme, d’un bond, se jeta sur lui, et lui saisissant dans les mains le vêtement : « Non… tu te trompes… donne-moi ça. »
Mais il le tenait toujours par une manche, ne le lâchant pas, répétant dans une sorte d’affolement : « Hein ?… Pourquoi ?… Explique-moi ?… À qui ce pardessus ?… Ce n’est pas le mien, puisqu’il porte la Légion d’honneur ? »
Elle s’efforçait de le lui arracher, éperdue, bégayant : « Écoute… écoute… donne-moi ça… Je ne peux pas te dire… c’est un secret… écoute. »
Mais il se fâchait, devenait pâle : « Je veux savoir comment ce paletot est ici. Ce n’est pas le mien. »
Alors, elle lui cria dans la figure : « Si, tais-toi, jure-moi… écoute… eh bien ! tu es décoré ! »
Il eut une telle secousse d’émotion qu’il lâcha le pardessus et alla tomber dans un fauteuil.
« Je suis… tu dis… je suis… décoré.
— Oui… c’est un secret, un grand secret… »
Elle avait enfermé dans une armoire le vêtement glorieux, et revenait vers son mari, tremblante et pâle. Elle reprit : « Oui, c’est un pardessus neuf que je t’ai fait faire. Mais j’avais juré de ne te rien dire. Cela ne sera pas officiel avant un mois ou six semaines. Il faut que ta mission soit terminée. Tu ne devais le savoir qu’à ton retour. C’est M. Rosselin qui a obtenu ça pour toi… »
Sacrement, défaillant, bégayait : « Rosselin… décoré… Il m’a fait décorer… moi… lui… ah !… »
Et il fut obligé de boire un verre d’eau.
Un petit papier blanc gisait par terre, tombé de la poche du pardessus. Sacrement le ramassa, c’était une carte de visite. Il lut : « Rosselin – député. »
« Tu vois bien », dit la femme.
Et il se mit à pleurer de joie.
Huit jours plus tard l’Officiel annonçait que M. Sacrement était nommé chevalier de la Légion d’honneur, pour services exceptionnels.
13 novembre 1883
Châli
À Jean Béraud
* * *
L’amiral de la Vallée, qui semblait assoupi dans son fauteuil, prononça de sa voix de vieille femme : « J’ai eu, moi, une petite aventure d’amour, très singulière, voulez-vous que je vous la dise ? »
Et il parla, sans remuer, du fond de son large siège, en gardant sur les lèvres ce sourire ridé qui ne le quittait jamais, ce sourire à la Voltaire qui le faisait passer pour un affreux sceptique.
I
J’avais trente ans alors, et j’étais lieutenant de vaisseau, quand on me chargea d’une mission astronomique dans l’Inde centrale. Le gouvernement anglais me donna tous les moyens nécessaires pour venir à bout de mon entreprise et je m’enfonçai bientôt avec une suite de quelques hommes dans ce pays étrange, surprenant, prodigieux.
Il faudrait vingt volumes pour raconter ce voyage. Je traversai des contrées invraisemblablement magnifiques ; je fus reçu par des princes d’une beauté surhumaine et vivant dans une incroyable magnificence. Il me sembla pendant deux mois, que je marchais dans un poème, que je parcourais un royaume de féeries sur le dos d’éléphants imaginaires. Je découvrais au milieu des forêts fantastiques des ruines invraisemblables ; je trouvais, en des cités d’une fantaisie de songe, de prodigieux monuments, fins et ciselés comme des bijoux, légers comme des dentelles et énormes comme des montagnes, ces monuments, fabuleux, divins, d’une grâce telle qu’on devient amoureux de leurs formes ainsi qu’on peut être amoureux d’une femme, et qu’on éprouve à les voir, un plaisir physique et sensuel. Enfin, comme dit M. Victor Hugo, je marchais, tout éveillé dans un rêve.
Puis j’atteignis enfin le terme de mon voyage, la ville de Ganhara, autrefois une des plus prospères de l’Inde centrale, aujourd’hui bien déchue, et gouvernée par un prince opulent, autoritaire, violent, généreux et cruel, le Rajah Maddan, un vrai souverain d’Orient, délicat et barbare, affable et sanguinaire, d’une grâce féminine et d’une férocité impitoyable.
La cité est dans le fond d’une vallée au bord d’un petit lac, qu’entoure un peuple de pagodes baignant dans l’eau leurs murailles.
La ville, de loin, forme une tache blanche qui grandit quand on approche, et peu à peu on découvre les dômes, les aiguilles, les flèches, tous les sommets élégants et sveltes des gracieux monuments indiens.
À une heure des portes environ, je rencontrai un éléphant superbement harnaché, entouré d’une escorte d’honneur que le souverain m’envoyait. Et je fus conduit en grande pompe, au palais.
J’aurais voulu prendre le temps de me vêtir avec luxe, mais l’impatience royale ne me le permit pas. On voulait d’abord me connaître, savoir ce qu’on aurait à attendre de moi comme distraction ; puis on verrait.
Je fus introduit, au milieu de soldats bronzés comme des statues et couverts d’uniformes étincelants, dans une grande salle entourée de galeries, où se tenaient debout des hommes habillés de robes éclatantes et étoilées de pierres précieuses.
Sur un banc pareil à un de nos bancs de jardin sans dossier, mais revêtu d’un tapis admirable, j’aperçus une masse luisante, une sorte de soleil assis : c’était le Rajah, qui m’attendait, immobile dans une robe de plus pur jaune serin. Il portait sur lui dix ou quinze millions de diamants, et seule, sur son front, brillait la fameuse étoile de Delhi qui a toujours appartenu à l’illustre dynastie des Parihara de Mundore dont mon hôte était descendant.
C’était un garçon de vingt-cinq ans environ, qui semblait avoir du sang nègre dans les veines, bien qu’il appartînt à la plus pure race hindoue. Il avait les yeux larges, fixes, un peu vagues, les pommettes saillantes, les lèvres grosses, la barbe frisée, le front bas et des dents éclatantes, aiguës, qu’il montrait souvent dans un sourire machinal.
Il se leva et vint me tendre la main, à l’anglaise, puis me fit asseoir à son côté sur un banc si haut que mes pieds touchaient à peine à terre. On était fort mal là-dessus.
Et aussitôt il me proposa une chasse au tigre pour le lendemain. La chasse et les luttes étaient ses grandes occupations, et il ne comprenait guère qu’on pût s’occuper d’autre chose.
Il se persuadait évidemment que je n’étais venu si loin que pour le distraire un peu et l’accompagner dans ses plaisirs.
Comme j’avais grand besoin de lui, je tâchai de flatter ses penchants. Il fut tellement satisfait de mon attitude qu’il voulut me montrer immédiatement un combat de lutteurs, et il m’entraîna dans une sorte d’arène située à l’intérieur du palais.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Les sœurs Rondoli (1884)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Les sœurs Rondoli (1884)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Les sœurs Rondoli (1884)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.