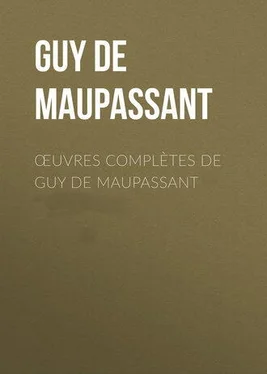Puis ce fut une sorte de torpeur de l'âme, de bien-être somnolent, malgré les douleurs qui persistaient, mais qui cessaient cependant d'être pénibles. C'était une de ces souffrances qu'on consent à supporter, et non plus ces déchirements affreux contre lesquels tout notre corps torturé proteste.
Bientôt l'étrange et charmante sensation de vide que j'avais dans la poitrine s'étendit, gagna les membres qui devinrent à leur tour légers, légers comme si la chair et les os se fussent fondus et que la peau seule fût restée, la peau nécessaire pour me faire percevoir la douceur de vivre, d'être couché dans ce bien-être. Je m'aperçus alors que je ne souffrais plus. La douleur s'en était allée, fondue aussi, évaporée. Et j'entendis des voix, quatre voix, deux dialogues, sans rien comprendre des paroles. Tantôt ce n'étaient que des sons indistincts, tantôt un mot me parvenait. Mais je reconnus que c'étaient là simplement les bourdonnements accentués de mes oreilles. Je ne dormais pas, je veillais, je comprenais, je sentais, je raisonnais avec une netteté, une Profondeur, une puissance extraordinaires, et une joie d'esprit, une ivresse étrange venue de ce décuplement de mes facultés mentales.
Ce n'était pas du rêve comme avec du haschich, ce n'étaient pas les visions un peu maladives de l'opium ; c'étaient une acuité prodigieuse de raisonnement, une manière nouvelle de voir, de juger, d'apprécier les choses et la vie, avec la certitude, la conscience absolue que cette manière était la vraie.
Et la vieille image de l'Ecriture m'est revenue soudain à la pensée. Il me semblait que j'avais goûté à l'arbre de science, que tous les mystères se dévoilaient, tant je me trouvais sous l'empire d'une logique nouvelle, étrange, irréfutable. Et des arguments, des raisonnements, des preuves me venaient en foule, renversés immédiatement par une preuve, un raisonnement, un argument plus forts. Ma tête était devenue le champ de lutte des idées. J'étais un être supérieur, armé d'une intelligence invincible, et je goûtais une jouissance prodigieuse à la constatation de ma puissance...
Cela dura longtemps, longtemps. Je respirais toujours l'orifice de mon flacon d'éther. Soudain, je m'aperçus qu'il était vide. Et la douleur recommença.
Pendant dix heures, je dus endurer ce supplice contre lequel il n'est point de remèdes, puis je dormis, et le lendemain, alerte comme après une convalescence, ayant écrit ces quelques pages, je partis pour SaintRaphaël.
V.
Saint-Raphaël, 11 avril
Nous avons eu, pour venir ici, un temps délicieux, une petite brise d'ouest qui nous a amenés en six bordées. Après avoir doublé le Dramont, j'aperçus les villas de Saint-Raphaël cachées dans les sapins, dans les petits sapins maigres que fatigue tout le long de l'année l'éternel coup de vent de Fréjus. Puis je passai entre les lions, jolis rochers rouges qui semblent garder la ville et j'entrai dans le port ensablé vers le fond, ce qui force à se tenir à cinquante mètres du quai, puis je descendis à terre.
Un grand rassemblement se tenait devant l'église. On mariait là-dedans. Un prêtre autorisait en latin, avec une gravité pontificale, l'acte animal, solennel et comique qui agite si fort les hommes, les fait tant rire, tant souffrir, tant pleurer. Les familles, selon l'usage, avaient invité tous leurs parents et tous leurs amis à ce service funèbre de l'innocence d'une jeune fille, à ce spectacle inconvenant et pieux des conseils ecclésiastiques précédant ceux de la mère et de la bénédiction publique, donnée à ce qu'on voile d'ordinaire avec tant de pudeur et de souci.
Et le pays entier, plein d'idées grivoises, mû par cette curiosité friande et polissonne qui pousse les foules à ce spectacle, était venu là pour voir la tête que feraient les deux mariés. J'entrai dans cette foule et je la regardai.
Dieu, que les hommes sont laids ! Pour la centième fois au moins, je remarquais au milieu de cette fête que, de toutes les races, la race humaine est la plus affreuse. Et là-dedans une odeur de peuple flottait, une odeur fade et nauséabonde de chair malpropre, de chevelures grasses et d'ail, cette senteur d'ail que les gens du Midi répandent autour d'eux, par la bouche, par le nez et par la peau, comme les roses jettent leur parfum.
Certes les hommes sont tous les jours aussi laids et sentent tous les jours aussi mauvais, mais nos yeux habitués à les regarder, notre nez accoutumé à les sentir, ne distinguent leur hideur et leurs émanations que lorsque nous avons été privés quelque temps de leur vue et de leur puanteur.
L'homme est affreux ! Il suffirait, pour composer une galerie de grotesques à faire rire un mort, de prendre les dix premiers passants venus, de les aligner et de les photographier avec leurs tailles inégales, leurs jambes trop longues ou trop courtes, leurs corps trop gros ou trop maigres, leurs faces rouges ou pâles, barbues ou glabres, leur air souriant ou sérieux.
Jadis, aux premiers temps du monde, l'homme sauvage, l'homme fort et nu, était certes aussi beau que le cheval, le cerf ou le lion. L'exercice de ses muscles, la libre vie, l'usage constant de sa vigueur et de son agilité entretenaient chez lui la grâce du mouvement qui est la première condition de la beauté, et l'élégance de la forme que donne seule l'agitation physique.
Plus tard, les peuples artistes, épris de plastique, surent conserver à l'homme intelligent cette grâce et cette élégance, par les artifices de la gymnastique. Les soins du corps, les jeux de force et de souplesse, l'eau glacée et les étuves firent des Grecs de vrais modèles de beauté humaine ; et ils nous laissèrent leurs statues, comme enseignement, pour nous montrer ce qu'étaient les corps de ces grands artistes.
Mais aujourd'hui, ô Apollon, regardons la race humaine s'agiter dans les fêtes ! Les enfants, ventrus dès le berceau, déformés par l'étude précoce, abrutis par le collège qui leur use le corps à quinze ans en courbaturant leur esprit avant qu'il soit nubile, arrivent à l'adolescence, avec des membres mal poussés, mal attachés, dont les proportions normales ne sont jamais conservées.
Et contemplons la rue, les gens qui trottent avec leurs vêtements sales ! Quant au paysan ! Seigneur Dieu ! Allons voir le paysan dans les champs, l'homme souche, noué, long comme une perche, toujours tors, courbé, plus affreux que les types barbares qu'on voit aux musées d'anthropologie.
Et rappelons-nous combien les nègres sont beaux de forme, sinon de face, ces hommes de bronze, grands et souples, combien les Arabes sont élégants de tournure et de figure !
D'ailleurs, j'ai, pour une autre raison encore, l'horreur des foules.
Je ne puis entrer dans un théâtre ni assister à une fête publique. J'y éprouve aussitôt un malaise bizarre, insoutenable, un énervement affreux comme si je luttais de toute ma force contre une influence irrésistible et mystérieuse. Et je lutte en effet contre l'âme de la foule qui essaie de pénétrer en moi.
Que de fois j'ai constaté que l'intelligence s'agrandit et s'élève, dès qu'on vit seul, qu'elle s'amoindrit et s'abaisse dès qu'on se mêle de nouveau aux autres hommes. Les contacts, les idées répandues, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est forcé d'écouter, d'entendre et de répondre, agissent sur la pensée. Un flux et reflux d'idées va de tète en tête, de maison en maison, de rue en rue, de ville en ville, de peuple à peuple, et un niveau s'établit, une moyenne d'intelligence pour toute agglomération nombreuse d'individus.
Les qualités d'initiative intellectuelle, de libre arbitre, de réflexion sage et même de pénétration de tout homme isolé, disparaissent en général dès que cet homme est mêlé à un grand nombre d'autres hommes.
Читать дальше