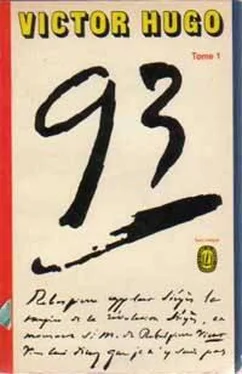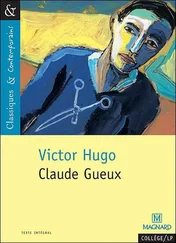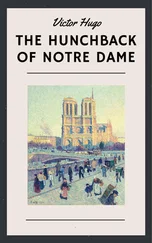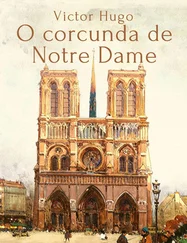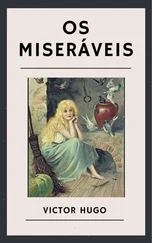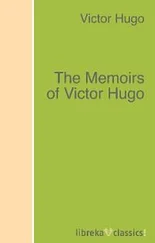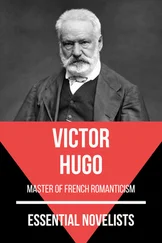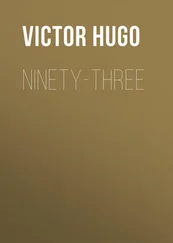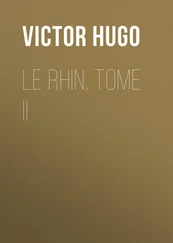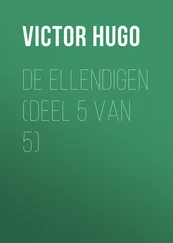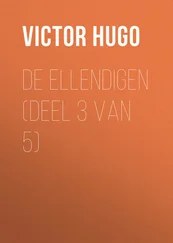– Le chirurgien est calme, dit Gauvain, et les hommes que je vois sont violents.
– La révolution, répliqua Cimourdain, veut pour l’aider des ouvriers farouches. Elle repousse toute main qui tremble. Elle n’a foi qu’aux inexorables. Danton, c’est le terrible, Robespierre, c’est l’inflexible, Saint-Just, c’est l’irréductible, Marat, c’est l’implacable. Prends-y garde, Gauvain. Ces noms-là sont nécessaires. Ils valent pour nous des armées. Ils terrifieront l’Europe.
– Et peut-être aussi l’avenir, dit Gauvain.
Il s’arrêta, et repartit:
– Du reste, mon maître, vous faites erreur, je n’accuse personne. Selon moi, le vrai point de vue de la révolution, c’est l’irresponsabilité. Personne n’est innocent, personne n’est coupable. Louis XVI, c’est un mouton jeté parmi des lions. Il veut fuir, il veut se sauver, il cherche à se défendre; il mordrait, s’il pouvait. Mais n’est pas lion qui veut. Sa velléité passe pour crime. Ce mouton en colère montre les dents. Le traître! disent les lions. Et ils le mangent. Cela fait, ils se battent entre eux.
– Le mouton est une bête.
– Et les lions, que sont-ils?
Cette réplique fit songer Cimourdain. Il releva la tête et dit: Ces lions-là sont des consciences. Ces lions-là sont des idées. Ces lions-là sont des principes.
– Ils font la Terreur.
– Un jour, la révolution sera la justification de la Terreur.
– Craignez que la Terreur ne soit la calomnie de la révolution.
Et Gauvain reprit:
– Liberté, Égalité, Fraternité, ce sont des dogmes de paix et d’harmonie. Pourquoi leur donner un aspect effrayant? Que voulons-nous? conquérir les peuples à la république universelle. Eh bien, ne leur faisons pas peur. À quoi bon l’intimidation? Pas plus que les oiseaux, les peuples ne sont attirés par l’épouvantail. Il ne faut pas faire le mal pour faire le bien. On ne renverse pas le trône pour laisser l’échafaud debout. Mort aux rois, et vie aux nations. Abattons les couronnes, épargnons les têtes. La révolution, c’est la concorde, et non l’effroi. Les idées douces sont mal servies par les hommes incléments. Amnistie est pour moi le plus beau mot de la langue humaine. Je ne veux verser de sang qu’en risquant le mien. Du reste je ne sais que combattre, et je ne suis qu’un soldat. Mais si l’on ne peut pardonner, cela ne vaut pas la peine de vaincre. Soyons pendant la bataille les ennemis de nos ennemis, et après la victoire leurs frères.
– Prends garde, répéta Cimourdain pour la troisième fois. Gauvain, tu es pour moi plus que mon fils, prends garde!
Et il ajouta, pensif:
– Dans des temps comme les nôtres, la pitié peut être une des formes de la trahison.
En entendant parler ces deux hommes, on eût cru entendre le dialogue de l’épée et de la hache.
Cependant la mère cherchait ses petits.
Elle allait devant elle. Comment vivait-elle? Impossible de le dire. Elle ne le savait pas elle-même. Elle marcha des jours et des nuits; elle mendia, elle mangea de l’herbe, elle coucha à terre, elle dormit en plein air, dans les broussailles, sous les étoiles, quelquefois sous la pluie et la bise.
Elle rôdait de village en village, de métairie en métairie, s’informant. Elle s’arrêtait aux seuils. Sa robe était en haillons. Quelquefois on l’accueillait, quelquefois on la chassait. Quand elle ne pouvait entrer dans les maisons, elle allait dans les bois.
Elle ne connaissait pas le pays, elle ignorait tout, excepté Siscoignard et la paroisse d’Azé, elle n’avait point d’itinéraire, elle revenait sur ses pas, recommençait une route déjà parcourue, faisait du chemin inutile. Elle suivait tantôt le pavé, tantôt l’ornière d’une charrette, tantôt les sentiers dans les taillis. À cette vie au hasard, elle avait usé ses misérables vêtements. Elle avait marché d’abord avec ses souliers, puis avec ses pieds nus, puis avec ses pieds sanglants.
Elle allait à travers la guerre, à travers les coups de fusil, sans rien entendre, sans rien voir, sans rien éviter, cherchant ses enfants. Tout étant en révolte, il n’y avait plus de gendarmes, plus de maires, plus d’autorité. Elle n’avait affaire qu’aux passants.
Elle leur parlait. Elle demandait:
– Avez-vous vu quelque part trois petits enfants?
Les passants levaient la tête.
– Deux garçons et une fille, disait-elle.
Elle continuait:
– René-Jean, Gros-Alain, Georgette? Vous n’avez pas vu ça?
Elle poursuivait:
– L’aîné a quatre ans et demi, la petite a vingt mois.
Elle ajoutait:
– Savez-vous où ils sont? on me les a pris.
On la regardait et c’était tout.
Voyant qu’on ne la comprenait pas, elle disait:
– C’est qu’ils sont à moi. Voilà pourquoi.
Les gens passaient leur chemin. Alors elle s’arrêtait et ne disait plus rien, et se déchirait le sein avec les ongles.
Un jour pourtant un paysan l’écouta. Le bonhomme se mit à réfléchir.
– Attendez donc, dit-il. Trois enfants?
– Oui.
– Deux garçons?
– Et une fille.
– C’est ça que vous cherchez?
– Oui.
– J’ai ouï parler d’un seigneur qui avait pris trois petits enfants et qui les avait avec lui.
– Où est cet homme? cria-t-elle. Où sont-ils?
Le paysan répondit:
– Allez à la Tourgue.
– Est-ce que c’est là que je trouverai mes enfants?
– Peut-être bien que oui.
– Vous dites?…
– La Tourgue.
– Qu’est-ce que c’est que la Tourgue?
– C’est un endroit.
– Est-ce un village? un château? une métairie?
– Je n’y suis jamais allé.
– Est-ce loin?
– Ce n’est pas près.
– De quel côté?
– Du côté de Fougères.
– Par où y va-t-on?
– Vous êtes à Ventortes, dit le paysan, vous laisserez Ernée à gauche et Coxelles à droite, vous passerez par Lorchamps et vous traverserez le Leroux.
Et le paysan leva sa main vers l’occident.
– Toujours devant vous en allant du côté où le soleil se couche.
Avant que le paysan eût baissé son bras, elle était en marche.
Le paysan lui cria:
– Mais prenez garde. On se bat par là.
Elle ne se retourna point pour lui répondre, et continua d’aller en avant.
IX UNE BASTILLE DE PROVINCE
Le voyageur qui, il y a quarante ans, entré dans la forêt de Fougères du côté de Laignelet en ressortait du côté de Parigné, faisait, sur la lisière de cette profonde futaie, une rencontre sinistre. En débouchant du hallier, il avait brusquement devant lui la Tourgue.
Non la Tourgue vivante, mais la Tourgue morte. La Tourgue lézardée, sabordée, balafrée, démantelée. La ruine est à l’édifice ce que le fantôme est à l’homme. Pas de plus lugubre vision que la Tourgue. Ce qu’on avait sous les yeux, c’était une haute tour ronde, toute seule au coin du bois comme un malfaiteur. Cette tour, droite sur un bloc de roche à pic, avait presque l’aspect romain tant elle était correcte et solide, et tant dans cette masse robuste l’idée de la puissance était mêlée à l’idée de la chute. Romaine, elle l’était même un peu, car elle était romane; commencée au neuvième siècle, elle avait été achevée au douzième, après la troisième croisade. Les impostes à oreillons de ses baies disaient son âge. On approchait, on gravissait l’escarpement, on apercevait une brèche, on se risquait à entrer, on était dedans, c’était vide. C’était quelque chose comme l’intérieur d’un clairon de pierre posé debout sur le sol. Du haut en bas, aucun diaphragme; pas de toit, pas de plafonds, pas de planchers, des arrachements de voûtes et de cheminées, des embrasures à fauconneaux, à des hauteurs diverses, des cordons de corbeaux de granit et quelques poutres transversales marquant les étages, sur les poutres les fientes des oiseaux de nuit, la muraille colossale, quinze pieds d’épaisseur à la base et douze au sommet, çà et là des crevasses, et des trous qui avaient été des portes, par où l’on entrevoyait des escaliers dans l’intérieur ténébreux du mur. Le passant qui pénétrait là le soir entendait crier les hulottes, les tète-chèvres, les bihoreaux et les crapauds-volants, et voyait sous ses pieds des ronces, des pierres, des reptiles, et sur sa tête, à travers une rondeur noire qui était le haut de la tour et qui semblait la bouche d’un puits énorme, les étoiles.
Читать дальше