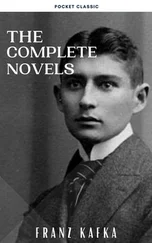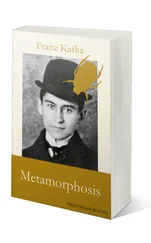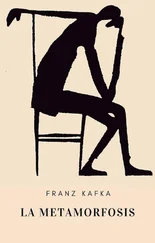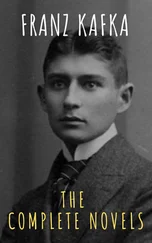– Je vous remercie», répondit K.
Il se releva lentement, regarda Mlle Montag, puis la table, puis la fenêtre – la maison d’en face était tout ensoleillée – et se dirigea vers la porte; Mlle Montag le suivit quelques pas comme si elle n’avait pas complètement confiance, mais parvenus devant la porte, ils durent reculer tous deux, car elle s’ouvrit, poussée par le capitaine Lanz. K. ne l’avait encore jamais vu d’aussi près. C’était un homme de grande taille, qui pouvait avoir quarante ans; son visage était charnu et hâlé; il s’inclina légèrement pour saluer les deux personnes, puis se dirigea vers Mlle Montag et lui baisa respectueusement la main. Il avait une grande aisance de mouvements; sa politesse envers Mlle Montag jurait avec l’attitude de K.; cependant, Mlle Montag n’avait pas l’air d’en tenir rigueur à K., il lui sembla même qu’elle voulait le présenter au capitaine. Mais K. n’y tenait nullement; il n’eût pu se montrer aimable ni avec elle ni avec lui; ce baisemain avait associé à ses yeux la jeune fille à un groupe de conjurés qui, tout en se donnant l’apparence la plus inoffensive et la plus désintéressée, travaillait secrètement à le tenir éloigné de Mlle Bürstner. Ce ne fut pas la seule chose que K. crut voir; il s’aperçut aussi que Mlle Montag avait choisi un bon moyen quoiqu’il présentât deux tranchants; elle s’arrangeait pour exagérer l’importance des relations entre K. et Mlle Bürstner, et surtout l’importance de l’entretien demandé, et tournait la chose de telle sorte que ce fût K. qui parût tout exagérer; il fallait lui montrer qu’elle faisait fausse route; K. ne voulait rien exagérer, il savait que Mlle Bürstner était une petite dactylo qui ne lui résisterait pas longtemps. Encore ne faisait-il intentionnellement pas entrer en ligne de compte ce qu’il avait appris d’elle par Mme Grubach. Ce fut en réfléchissant à tout cela qu’il quitta la pièce sur un imperceptible salut; il voulait retourner tout de suite dans sa chambre, mais un petit rire de Mlle Montag lui fit penser qu’il pourrait peut-être lui ménager une surprise ainsi qu’au capitaine Lanz. Il regarda autour de lui, l’œil et l’oreille au guet, épiant le bruit qui risquerait de présager un dérangement. Mais le calme régnait partout. On n’entendait que la conversation qui venait de la salle à manger et la voix de Mme Grubach dans le couloir de la cuisine. L’occasion semblait favorable, K. alla frapper à la porte de Mlle Bürstner; comme rien ne bougeait, il frappa de nouveau, mais cette fois non plus, nulle réponse. Dormait-elle ou était-elle vraiment fatiguée? Ou bien ne camouflait-elle sa présence que parce qu’elle pressentait que ce ne pouvait être que K. qui frappait aussi doucement. K. pensa qu’elle faisait semblant d’être absente; il recommença plus fort, et, voyant que son toc-toc n’avait aucun résultat, ouvrit finalement la porte avec prudence, non sans éprouver le sentiment de commettre une faute, et, qui pis est, une faute inutile. Il n’y avait personne dans la chambre; elle ne rappelait d’ailleurs guère celle que K. avait connue. Maintenant, il y avait deux lits le long du mur; près de la porte, on voyait trois chaises surchargées de linge et d’habits; une armoire était grande ouverte. Mlle Bürstner avait dû partir pendant que Mlle Montag entretenait K. dans la salle à manger; il n’en fut pas trop déconcerté, car il ne s’attendait guère à rencontrer la jeune fille; c’était par défi, pour braver Mlle Montag, qu’il avait fait cette tentative; il ne lui en fut que plus pénible d’apercevoir en refermant, par la porte qui donnait sur la salle à manger, Mlle Montag causant tranquillement avec le capitaine Lanz; ils étaient peut-être là depuis le moment où K. avait ouvert la porte; ils évitaient de se donner l’air d’observer, parlaient à voix basse et ne suivaient ses mouvements que comme on le fait dans une conversation en regardant distraitement autour de soi. Mais ces regards pesaient terriblement à K., il regagna sa chambre en hâte, en longeant le mur du couloir.
LE BOURREAU.
L’un des soirs suivants, comme K. passait dans le corridor qui séparait son bureau de l’escalier principal – il avait été l’un des derniers à s’en aller et il ne restait plus à la banque que deux domestiques en train de liquider les dernières expéditions dans le petit rond de lumière d’une lampe électrique – il entendit pousser des soupirs derrière une porte qu’il avait toujours prise pour celle d’un simple cabinet de débarras. Tout étonné, il s’arrêta et écouta encore une fois pour être sûr de ne pas se tromper; il y eut d’abord un moment de silence, puis les soupirs recommencèrent. Sa première idée fut d’aller chercher un domestique pour le cas où il aurait besoin d’un témoin; mais il fut pris d’une si grande curiosité qu’il fit voler littéralement la porte sous sa main. Il se trouvait, comme il l’avait pensé, dans un cabinet de débarras; le seuil était tout encombré d’imprimés inutilisables et de vieux encriers en terre cuite, mais trois hommes occupaient le milieu, un peu courbés à cause du plafond bas. Ils étaient éclairés par une bougie fixée sur un rayon.
«Que faites-vous là?» demanda K., dont l’émotion précipitait le débit, mais sur un ton de voix assourdi.
L’un des hommes, qui avait l’air d’être le maître des deux autres, et qu’on apercevait le premier, était vêtu d’une sorte de combinaison de cuir sombre très décolletée qui laissait les bras entièrement nus. Il ne répondit rien. Mais les deux autres crièrent:
«Maître! nous devons être fouettés parce que tu t’es plaint de nous au juge d’instruction.»
Ce fut alors que K. reconnut en eux les inspecteurs Franz et Willem et vit que le troisième tenait en effet une verge à la main pour les battre.
«Comment! dit K., les yeux fixés sur eux, je ne me suis pas plaint; j’ai simplement exposé ce qui s’était passé chez moi, où vous ne vous êtes évidemment pas conduits d’une façon irréprochable.
– Monsieur, dit Willem pendant que Franz cherchait à se cacher derrière lui pour se protéger du troisième, si vous saviez combien nous sommes mal payés, vous ne vous jugeriez pas ainsi. J’ai une famille à nourrir et Franz voulait se marier. On cherche à s’enrichir comme on peut et ce n’est pas par le seul travail qu’on y parvient, même en s’échinant comme un bœuf. Votre beau linge m’a tenté; naturellement, il est interdit aux inspecteurs d’agir ainsi; j’avais tort; mais il est de tradition que le linge nous revienne; il en a toujours été ainsi croyez-m’en; c’est assez naturel d’ailleurs, car à quoi ces choses-là pourraient-elles bien servir à ceux qui ont le malheur d’être arrêtés? Évidemment, si le public apprend l’histoire, il faut que le délit soit puni.
– Je ne savais pas ce que vous me dites là, je n’ai d’ailleurs nullement demandé votre châtiment, il ne s’agissait pour moi que d’une question de principe.
– Franz, dit alors Willem à son collègue, ne te disais-je pas que ce monsieur n’avait pas demandé notre punition? Tu vois bien maintenant qu’il ne savait même pas que nous devions être punis.
– Ne te laisse pas émouvoir par ces discours, dit le troisième à K., la punition est aussi juste qu’inévitable.
– Ne l’écoute pas, dit Willem en s’interrompant seulement pour porter à sa bouche la main sur laquelle le bourreau venait de lui donner un coup de verge. Nous ne sommes punis que parce que tu nous as dénoncés, sans quoi il ne nous serait rien arrivé, même si l’on avait appris ce que nous avons fait; nous avions toujours montré tous les deux, mais surtout moi, que nous étions de bons gardiens. Tu avoueras toi-même que nous avons fait bonne garde du point de vue de l’autorité. Nous pouvions espérer avancer et nous serions certainement devenus fustigeurs nous aussi, comme l’inspecteur qui est là et qui a eu le bonheur de ne jamais être dénoncé – car cela n’arrive vraiment que très rarement – et maintenant, maître, tout est perdu, voilà notre carrière finie, on ne nous emploiera plus qu’à des travaux encore plus subalternes que la garde des prévenus, et, par-dessus le marché, nous avons à recevoir cette terrible bastonnade.
Читать дальше