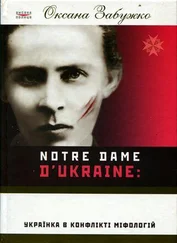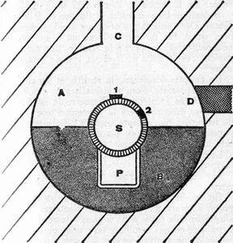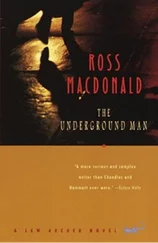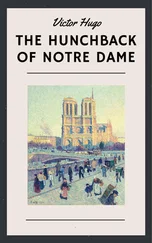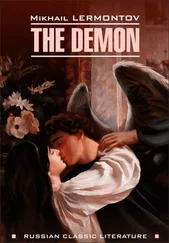J’étais comme un fou; je m’élançai sur le perron, sautai sur mon cheval circassien que l’on promenait encore dans la cour et me précipitai à toute haleine sur la route de Piatigorsk. Je poussai sans pitié mon cheval fatigué qui soufflait et, tout couvert d’écume, m’emporta au milieu du chemin pierreux.
Le soleil s’était déjà caché dans les nuages noirs étendus sur les crêtes des montagnes au couchant. Dans les ravins, il faisait déjà sombre et humide. Le Podkumok bondissait sur les cailloux, et mugissait d’une manière sourde et monotone. Je galopais, suffoqué par l’impatience. La pensée que je ne la trouverais pas à Piatigorsk, m’avait frappé au cœur comme un coup de marteau! Un moment, un seul moment la voir encore, lui dire adieu, lui presser la main… Je priais, je maudissais, je pleurais, je riais… Non! rien ne pourrait exprimer mon inquiétude et mon désespoir!… Devant la possibilité de la perdre pour toujours, Viéra m’était devenue plus chère que tout au monde!… plus chère que la vie, que l’honneur, que le bonheur!… Dieu sait quels desseins affreux, quelles folles idées fourmillaient dans ma tête! Et cependant je galopais toujours, fouettant sans pitié, lorsque je m’aperçus que mon cheval soufflait plus péniblement. Déjà deux fois il avait butté sur un chemin uni… J’avais encore cinq verstes pour arriver à Essentuki, village cosaque, où j’aurais pu monter un autre cheval.
Tout eût été sauvé si mon cheval avait eu encore la force de courir dix minutes. Mais soudain en passant un petit ravin qui est à la sortie des montagnes et à un tournant rapide, il s’abattit. Je me débarrassai promptement et cherchai à le relever en le tirant par les rênes; ce fut en vain! À peine si un faible gémissement passait à travers ses dents serrées. Au bout d’un moment il expira; je restai au milieu du steppe, ayant perdu ma dernière espérance. J’essayai d’aller à pied; mes jambes fléchirent. Épuisé par les émotions de la journée et l’insomnie, je m’affaissai sur l’herbe humide et me mis à pleurer comme un enfant…
Je restai longtemps couché dans l’herbe, immobile, pleurant amèrement, et je n’essayai point d’arrêter mes larmes et mes sanglots. Je croyais que ma poitrine éclaterait; toute ma fermeté, tout mon sang-froid s’étaient dissipés comme une fumée. Mon âme était sans force, ma raison éteinte, et si quelqu’un m’avait vu en ce moment, il se serait détourné de moi avec mépris.
Lorsque la rosée nocturne et le vent de la montagne eurent rafraîchi ma tête et que mes pensées eurent repris leur cours ordinaire, je compris qu’il était inutile et déraisonnable de courir après un bonheur évanoui. Que m’aurait-il fallu encore? La voir? Pourquoi? Tout n’était-il pas fini entre nous? Un triste baiser d’adieu n’enrichirait pas beaucoup mes souvenirs et après lui, notre séparation n’en eût été que plus pénible.
Il me restait cependant une consolation, c’est que je pouvais pleurer. Et au surplus, toute cette irritation nerveuse n’avait peut-être pour cause qu’une nuit passée sans sommeil, deux minutes de pose devant la bouche d’un pistolet et le vide de mon estomac.
Tout était pour le mieux! cette nouvelle souffrance avait, comme on dit en langage militaire, produit en moi une heureuse diversion . Pleurer est très sain et puis certainement si je n’étais pas parti à cheval et si je n’avais pas été contraint de faire pour le retour quinze ventes, je n’aurais pu fermer les yeux et dormir de toute la nuit.
En arrivant à Kislovodsk, à cinq heures du matin, je me jetai sur mon lit et m’endormis du sommeil de Napoléon après Waterloo.
Lorsque je me réveillai, il faisait déjà sombre dehors et je m’assis auprès de la fenêtre entr’ouverte, mon habit déboutonné. La brise de la montagne vint rafraîchir ma poitrine encore agitée par la fatigue d’un sommeil lourd. Au loin, derrière la rivière, à travers la cime des épais tilleuls qui l’ombragent, je voyais briller les lumières du village, et de la forteresse. Dans notre cour tout était calme et chez les princesses tout était éteint. Le docteur entra chez moi; sa mine était sombre et contre l’ordinaire il ne me tendit pas la main.
«D’où venez-vous, docteur?
– De chez la princesse Ligowska, sa fille est malade. C’est une crise nerveuse; mais ce n’est pas de cela que je viens vous parler. Voici ce qu’il y a: l’autorité commence à avoir des soupçons et quoiqu’il soit impossible qu’on ait des preuves positives, je vous invite à vous tenir davantage sur vos gardes. La princesse m’a dit aujourd’hui qu’elle savait que vous vous étiez battu pour sa fille. C’est ce vieillard qui lui a tout raconté… Comment s’appelle-t-il? Il a été témoin de votre querelle avec Groutchnitski à l’hôtel. Je suis venu vous prévenir. Adieu! Peut-être ne nous reverrons-nous plus; on vous enverra qui sait où!»
Il s’était arrêté sur le seuil de la porte, avec l’envie de me serrer la main… Et si je lui en avais exprimé le plus petit désir, il se serait jeté à mon cou. Mais je restai froid comme un marbre et il sortit.
Voilà les hommes; ils sont tous ainsi: ils calculent d’avance toutes les bonnes ou mauvaises conséquences d’un événement. Ils vous aident, vous approuvent, vous encouragent même en voyant l’impossibilité d’un autre expédient; mais après ils s’en lavent les mains et se détournent avec indignation de celui qui a osé prendre sur lui tout le fardeau de la responsabilité. Ils sont tous ainsi, même les meilleurs, même les plus intelligents.
Le surlendemain matin, je reçus l’ordre de l’autorité supérieure de partir pour la forteresse de N… et j’allai faire mes adieux à la princesse.
Elle fut étonnée lorsque, me demandant si j’avais quelque chose de particulièrement sérieux à lui dire, je lui répondis que je lui souhaitais d’être heureuse, etc…
– Mais moi j’ai besoin de causer sérieusement avec vous.
Je m’assis en silence.
Il était clair qu’elle ne savait par où commencer; son visage était devenu livide et ses doigts enflés frappaient sur la table; enfin elle commença ainsi, d’une voix entrecoupée:
Écoutez-moi, Monsieur Petchorin, je crois que vous êtes un honnête homme.
Je m’inclinai.
Même j’en suis convaincue, continua-t-elle, quoique votre conduite inspire quelques doutes. Mais vous pouvez avoir des motifs que je ne connais pas et vous devez maintenant me les confier. Vous avez protégé ma fille contre la calomnie, vous vous êtes battu à cause d’elle, et par conséquent vous avez risqué votre vie… Ne me répondez pas, je sais que vous ne l’avouez pas, parce que M. Groutchnitski a été tué (elle se signa). Que Dieu lui pardonne je l’espère, et à vous aussi!… Cela ne me regarde pas… Je n’ose pas vous accuser, parce que ma fille, quoique involontairement, en a été le motif… Elle m’a tout dit… tout, je crois; vous lui avez exprimé de l’amour, elle vous a avoué le sien (ici elle soupira péniblement). Mais elle est malade, et je suis persuadée que ce n’est pas une simple maladie. Un chagrin secret la tue; elle ne me l’a pas avoué, mais je suis sûre que vous en êtes la cause… Écoutez-moi! Peut-être croyez-vous que je tiens au rang, à une grande richesse; détrompez-vous! Je veux le bonheur de ma fille. Votre situation pour le moment n’est pas à envier; mais tout peut s’arranger. Vous avez de la fortune, ma fille vous aime, et elle a été élevée de façon à rendre son mari heureux. Je suis riche et n’ai que cette fille… parlez; par quoi êtes-vous empêché? Voyez, je ne devrais pas vous dire tout cela: mais je compte sur votre cœur, sur votre honneur. Pensez que je n’ai qu’une fille… une fille unique.
Читать дальше