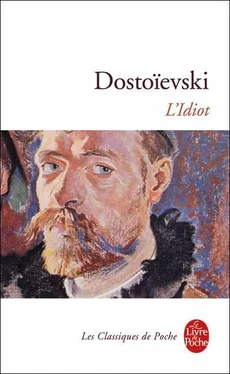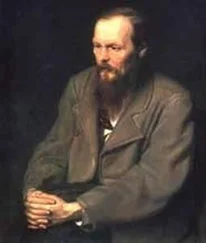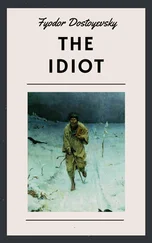Rogojine partit d’un bruyant éclat de rire. Son hilarité avait quelque chose de convulsif. Elle détonnait, succédant chez lui à l’humeur sombre dans laquelle il avait été plongé jusque-là.
– C’est adorable! Franchement, on ne trouverait pas mieux! s’exclamait-il d’une voix haletante, presque à bout de souffle. – L’un ne croit pas en Dieu; l’autre y croit tellement qu’il fait sa prière avant d’égorger les gens! Non, mon cher, on n’invente pas une chose pareille! Ha! ha! cela dépasse tout!…
– Le lendemain matin, j’allai faire un tour en ville, poursuivit le prince dès que Rogojine se fut calmé (bien qu’un rire intermittent et spasmodique continuât d’errer sur ses lèvres). J’aperçus un soldat ivre, complètement débraillé qui titubait le long du trottoir en bois. Il m’accosta et me dit: «Achète-moi cette croix d’argent, barine [69]je te la cède pour vingt kopeks elle est bien en argent». Et il montra, fixée à un cordon bleu très usé, une croix qu’il venait probablement d’ôter de son cou. À première vue, c’était une croix d’étain à huit branches [70], de grande dimension, avec un relief de style byzantin. Je tirai une pièce de vingt kopeks et la lui donnai, puis je me passai la croix autour du cou. Je lus sur sa figure la joie qu’il éprouvait à l’idée d’avoir roulé un barine stupide et il courut, sans aucun doute, au cabaret pour y boire ses vingt kopeks. À ce moment-là, mon ami, tout ce que j’observais en Russie produisait sur moi la plus vive impression. Autrefois, je ne comprenais rien à notre pays, j’étais un parfait ignare. À l’étranger, pendant les cinq années que j’y ai vécu, je n’avais gardé de la Russie qu’un souvenir fantaisiste. Je poursuivis ma promenade et je me dis; j’attendrai encore avant de faire condamner ce judas. Dieu sait ce qui se passe dans ses pauvres cœurs d’ivrognes! En rentrant à l’hôtel une heure plus tard, je rencontrai une paysanne avec un nourrisson dans les bras. C’était une femme encore jeune et l’enfant pouvait avoir six semaines. Il souriait à sa mère, pour la première fois, disait-elle, depuis sa naissance. Je la vis se signer soudain avec une indicible piété. «Pourquoi fais-tu cela?» lui dis-je. J’avais alors la manie de poser des questions. – «Autant, répondit-elle, une mère éprouve de joie en voyant le premier sourire de son enfant, autant Dieu en éprouve chaque fois qu’il voit, du haut du Ciel, un pécheur Le prier du fond du cœur.» Voilà presque textuellement ce que m’a dit cette femme du peuple; elle a exprimé cette pensée si profonde, si subtile, si purement religieuse où se synthétise toute l’essence du christianisme, qui reconnaît en Dieu un Père céleste se réjouissant à la vue de l’homme comme un père à la vue de son enfant. C’est la pensée fondamentale du Christ. Une simple femme du peuple! Il est vrai que c’était une mère… Et qui sait si ce n’était pas la femme du soldat qui m’avait vendu la croix? Écoute-moi, Parfione, tu m’as posé tout à l’heure une question, voici ma réponse: l’essence du sentiment religieux échappe à tous les raisonnements) aucune faute, aucun crime, aucune forme d’athéisme n’a de prise sur elle. Il y a et il y aura éternellement dans ce sentiment quelque chose d’insaisissable et d’inaccessible à l’argumentation des athées. Mais le plus remarquable, c’est qu’on n’observe cela nulle part avec autant de clarté et de spontanéité que dans le cœur des Russes! Voilà ma conclusion. C’est une des premières convictions que j’ai acquises en étudiant notre Russie. Il y a de belles choses à faire, Parfione, surtout sur notre terre russe, crois-moi! Rappelle-toi les rencontres et les entrevues que nous avons eues à Moscou à une certaine époque… Ah! je n’avais aucune envie de revenir ici maintenant! Et je ne pensais pas du tout te rencontrer dans de pareilles conditions!… Enfin, n’en parlons plus!… Adieu, au revoir! que Dieu ne t’abandonne pas!
Il fit demi-tour et descendit l’escalier.
– Léon Nicolaïévitch! lui cria d’en haut Parfione, lorsqu’il eut atteint le premier palier, cette croix que tu as achetée au soldat, l’as-tu sur toi?
– Oui, je l’ai sur moi, dit le prince en s’arrêtant.
– Montre-la-moi.
– Encore une nouvelle fantaisie!
Le prince réfléchit un instant, remonta l’escalier et, sans détacher la croix de son cou, la fit voir à Rogojine.
– Donne-la-moi, dit celui-ci.
– Pourquoi? Est-ce que tu…
Le prince avait de la répugnance à se séparer de cette croix.
– Pour la porter; je te donnerai la mienne à la place.
– Tu veux que nous échangions nos croix? C’est bien, Parfione; si tu le désires, je ne demande pas mieux; scellons notre fraternité [71]!
Le prince enleva sa croix d’étain; Parfione en fit autant de la sienne, qui était en or, et ils firent l’échange. Mais Parfione restait silencieux et le prince remarqua avec une douloureuse surprise que la physionomie de son nouveau frère avait gardé son expression de défiance et qu’un sourire amer et presque sarcastique continuait à s’y traduire, du moins par intermittence.
Sans dire un mot, Rogojine se décida à prendre la main du prince et, après un moment d’hésitation, l’entraîna à sa suite en lui soufflant d’une voix à peine perceptible: «Viens!». Ils traversèrent le palier du premier étage et sonnèrent à une porte qui faisait vis-à-vis à celle par où ils étaient sortis. On vint rapidement leur ouvrir. Une petite vieille, toute voûtée et vêtue de noir, la tête enveloppée d’un mouchoir fit sans desserrer les dents un profond salut à Rogojine. Celui-ci posa à la vieille une rapide question et, au lieu d’attendre la réponse, conduisit le prince à travers une suite de chambres obscures, froides et parfaitement tenues où s’alignaient d’austères vieux meubles, recouverts de housses blanches et propres. Puis, sans s’annoncer, il le fit entrer dans une petite pièce qui ressemblait à un salon et que partageait une cloison d’acajou, avec deux portes aux extrémités. Cette cloison devait dissimuler une chambre à coucher. Dans le coin du salon, près d’un poêle, une petite vieille était assise dans un fauteuil. Elle ne paraissait pas extrêmement âgée: son visage, plein et assez frais, était plutôt agréable, mais ses cheveux étaient tout blancs et, au premier coup d’œil, on s’apercevait qu’elle était complètement en enfance. Elle portait une robe de laine noire, un fichu noir autour du cou et un bonnet d’une blancheur immaculée avec des rubans noirs. Elle avait un tabouret sous les pieds. À son côté se tenait une autre petite vieille proprette, qui paraissait plus âgée et vivait sans doute à ses crochets; vêtue de deuil et coiffée, elle aussi, d’un bonnet blanc, elle tricotait silencieusement un bas. Ces deux femmes ne devaient jamais échanger une parole. À la vue de Rogojine et du prince, la première vieille fit un sourire et témoigna de son contentement par plusieurs petits saluts avenants.
– Mère, dit Rogojine après lui avoir baisé la main, je te présente mon grand ami, le prince Léon Nicolaïévitch Muichkine. Nous avons échangé nos croix. À Moscou il a été pendant quelque temps un frère pour moi et m’a rendu de grands services. Bénis-le, mère, comme tu bénirais ton propre fils. Attends, chère vieille, laisse-moi disposer ta main pour…
Mais la vieille, sans attendre l’aide de Rogojine, leva la main droite, joignit trois doigts et par trois fois bénit dévotement le prince. Après quoi elle lui fit encore de la tête un petit signe plein de douceur et de tendresse.
– Allons-nous-en, Léon Nicolaïévitch! dit Parfione, je ne t’avais amené que pour cela…
Читать дальше