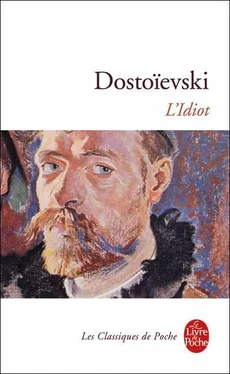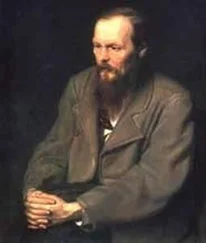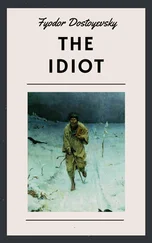Le prince s’approcha de la porte cochère et lut sur un écriteau: «Maison de Rogojine, bourgeois honoraire héréditaire [64]». Surmontant ses hésitations, il poussa une porte vitrée, qui se referma avec bruit derrière lui, et monta au premier étage par le grand escalier. Cet escalier était en pierre et grossièrement construit; il disparaissait dans la pénombre entre des murs peints en rouge. Le prince savait que Rogojine occupait, avec sa mère et son frère, tout le premier étage de cette triste demeure. Le domestique qui lui ouvrit la porte le conduisit sans l’annoncer à travers un dédale de pièces: ils entrèrent d’abord dans une salle de parade dont les parois imitaient le marbre; le parquet était de chêne, le mobilier, lourd et grossier, dans le style de 1820. Puis ils s’engagèrent dans une série de petites chambres qui faisaient des crochets et des zigzags; il fallait ici monter deux ou trois marches; là en redescendre autant. À la fin ils frappèrent à une porte. Ce fut Parfione Sémionovitch lui-même qui ouvrit. En apercevant le prince il resta stupéfait et pâlit au point de ressembler, pendant quelques instants, à une statue de pierre; la fixité de son regard exprimait la frayeur, sa bouche était crispée par un sourire hébété. La présence du prince lui apparaissait comme un événement inconcevable et presque miraculeux. Le visiteur, qui s’attendait à produire un effet de ce genre, n’en fut pas moins saisi.
– Parfione, je suis peut-être importun; dans ce cas je vais m’en aller, se décida-t-il à dire d’un air gêné.
– Du tout, du tout! répliqua Parfione, en reprenant ses esprits. Donne-toi donc la peine d’entrer.
Ils se tutoyaient. À Moscou ils avaient eu l’occasion de se voir souvent et longuement. Il y avait même eu, dans leurs rencontres, des moments qui avaient laissé une impression ineffaçable au cœur de l’un et de l’autre. Plus de trois mois s’étaient écoulés depuis qu’ils s’étaient vus.
Le visage de Rogojine était toujours pâle; de légères et furtives convulsions le crispaient encore. Bien qu’il eût fait entrer le visiteur, il continuait à ressentir un trouble indicible. Il invita le prince à s’asseoir dans un fauteuil près de la table, mais l’autre, s’étant retourné par hasard, s’arrêta net sous un regard d’une impressionnante étrangeté. Il s’était senti comme transpercé, en même temps qu’un souvenir récent, pénible et confus lui revenait à l’esprit. Au lieu de s’asseoir, il se figea dans une immobilité complète et, pendant un moment, regarda Rogojine droit dans les yeux; ceux-ci se mirent à briller d’un éclat encore plus vif. Enfin Rogojine ébaucha un sourire, mais où se trahissaient son trouble et sa détresse.
– Pourquoi me regardes-tu avec cette fixité? balbutia-t-il. Assieds-toi.
Le prince s’assit.
– Parfione, dit-il, parle-moi franchement: savais-tu que je devais arriver aujourd’hui à Pétersbourg, oui ou non?
– Je pensais bien que tu viendrais, et tu vois que je ne me suis pas trompé, répliqua-t-il avec un sourire fielleux; mais comment pouvais-je deviner que tu arriverais aujourd’hui?
Le ton de brusquerie et d’irritation sur lequel fut proférée cette question, qui contenait en même temps une réponse, fut pour le prince un nouveau motif de surprise.
– Quand même tu aurais su que j’arrivais aujourd’hui, pourquoi t’emporter ainsi? fit-il avec douceur, tandis que le trouble le gagnait.
– Mais toi, pourquoi me poses-tu cette question?
– Ce matin, en descendant du train, j’ai remarqué dans la foule une paire d’yeux tout pareils à ceux que tu fixais tout à l’heure sur moi par derrière.
– Tiens! tiens! À qui appartenaient ces yeux? marmonna Rogojine d’un air soupçonneux. Mais le prince crut remarquer qu’il avait tressailli.
– Je ne sais; c’était dans la foule; peut-être même ai-je été le jouet d’une illusion. Ces derniers temps je suis sujet à ce genre de mirages. Mon cher Parfione, je me sens dans un état voisin de celui où je me trouvais il y a cinq ans, lorsque j’avais des attaques.
– Il se peut que tu aies été en effet le jouet d’une illusion; je n’en sais rien, murmura Parfione.
Il n’était guère en train de faire un sourire engageant. Celui qui parut sur son visage refléta des sentiments disparates qu’il avait été incapable de composer.
– Eh bien, est-ce que tu vas repartir pour l’étranger? demanda-t-il; puis subitement: – Te rappelles-tu comme nous nous sommes rencontrés l’automne dernier, dans le train de Pskov à Pétersbourg… Tu te souviens de ton manteau et de tes guêtres?
Cette fois Rogojine se mit à rire avec une franche malignité, à laquelle il était heureux d’avoir trouvé une occasion de donner libre cours.
– Tu t’es complètement fixé ici? demanda le prince en jetant un coup d’œil autour du cabinet.
– Oui, je suis chez moi. Où veux-tu que j’aille?
– Il y a longtemps que nous ne nous sommes vus. J’ai entendu sur ton compte des choses dont j’ai peine à te croire capable.
– On raconte tant de choses, répliqua sèchement Rogojine.
– Pourtant tu as chassé toute ta bande; toi-même tu restes sous le toit paternel et ne fais plus d’escapades. C’est bien. La maison est-elle à toi, ou appartient-elle en commun à ta famille?
– La maison est à ma mère. Son appartement est de l’autre côté du corridor.
– Et où habite ton frère?
– Mon frère, Sémione Sémionovitch, habite dans une aile.
– Est-il marié?
– Il est veuf. Quel besoin as-tu de savoir cela?
Le prince le regarda sans répondre; devenu soudain pensif, il parut n’avoir pas entendu la question. Rogojine n’insista pas et attendit. Tous deux restèrent un instant silencieux.
– J’ai reconnu ta maison au premier coup d’œil et à cent pas de distance, dit le prince.
– Comment cela?
– Je ne saurais le dire. Ta maison a le même air que toute votre famille et que votre genre de vie. Mais si tu me demandes de t’expliquer d’où je tire cette impression, j’en serai incapable. C’est sans doute une forme de délire. Je suis même effrayé de voir à quel point ces choses-là me frappent. Auparavant je ne me faisais aucune idée de la maison dans laquelle tu demeurais; mais, dès que je l’ai vue, j’ai aussitôt pensé: «c’est bien le genre de maison qu’il doit habiter!»
– Vraiment! dit Rogojine en esquissant un vague sourire et sans arriver à saisir clairement la pensée confuse du prince. – C’est mon grand-père qui a construit cette maison, observa-t-il. Elle a de tout temps été habitée par des skoptsi, les Khloudiakov. Ils en sont encore locataires aujourd’hui.
– Quelle obscurité! Tu vis dans une pièce bien sombre, dit le prince en jetant les yeux autour de lui.
Le cabinet était une vaste chambre, haute de plafond, sans clarté, encombrée de toute espèce de meubles, comptoirs, bureaux, armoires remplies de registres et de paperasses. Un large divan de cuir rouge servait évidemment de lit à Rogojine. Le prince remarqua sur la table, près de laquelle celui-ci l’avait fait asseoir, deux ou trois livres; l’un, l’Histoire de Soloviov [65], était ouvert à une page marquée d’un signet. Aux murs étaient suspendus dans des cadres dédorés quelques tableaux à l’huile, si sombres et si enfumés qu’il était fort malaisé d’y distinguer quoi que ce fût. Un portrait de grandeur naturelle attira l’attention du prince: il représentait un homme d’une cinquantaine d’années portant une redingote de coupe étrangère mais à longs pans; deux médailles lui pendaient au cou, sa barbe clairsemée et courte grisonnait, sa face était ridée et jaune, son regard sournois et morose.
Читать дальше