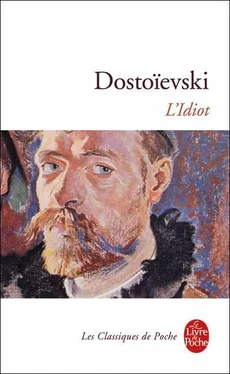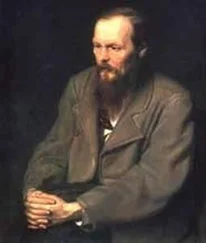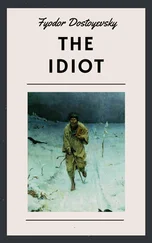Le prince s’était animé en parlant: une légère coloration corrigeait la pâleur de son visage, bien que tout ceci eût été proféré sur un ton calme. Le domestique suivait ce raisonnement avec intérêt et émotion; il semblait craindre de l’interrompre. Peut-être était-il, lui aussi, doué d’imagination et enclin à la réflexion.
– C’est du moins heureux, observa-t-il, que la souffrance soit courte au moment où la tête tombe.
– Savez-vous ce que je pense? rétorqua le prince avec vivacité. La remarque que vous venez de faire vient à l’esprit de tout le monde, et c’est la raison pour laquelle on a inventé cette machine appelée guillotine. Mais je me demande si ce mode d’exécution n’est pas pire que les autres. Vous allez rire et trouver ma réflexion étrange; cependant avec un léger effort d’imagination vous pouvez avoir la même idée. Figurez-vous l’homme que l’on met à la torture: les souffrances, les blessures et les tourments physiques font diversion aux douleurs morales, si bien que jusqu’à la mort le patient ne souffre que dans sa chair. Or ce ne sont pas les blessures qui constituent le supplice le plus cruel, c’est la certitude que dans une heure, dans dix minutes, dans une demi-minute, à l’instant même, l’âme va se retirer du corps, la vie humaine cesser, et cela irrémissiblement. La chose terrible, c’est cette certitude. Le plus épouvantable, c’est le quart de seconde pendant lequel vous passez la tête sous le couperet et l’entendez glisser. Ceci n’est pas une fantaisie de mon esprit: savez-vous que beaucoup de gens s’expriment de même? Ma conviction est si forte que je n’hésite pas à vous la livrer. Quand on met à mort un meurtrier, la peine est incommensurablement plus grave que le crime. Le meurtre juridique est infiniment plus atroce que l’assassinat. Celui qui est égorgé par des brigands la nuit, au fond d’un bois, conserve, même jusqu’au dernier moment, l’espoir de s’en tirer. On cite des gens qui, ayant la gorge tranchée, espéraient quand même, couraient ou suppliaient. Tandis qu’en lui donnant la certitude de l’issue fatale, on enlève au supplicié cet espoir qui rend la mort dix fois plus tolérable. Il y a une sentence, et le fait qu’on ne saurait y échapper constitue une telle torture qu’il n’en existe pas de plus affreuse au monde. Vous pouvez amener un soldat en pleine bataille jusque sous la gueule des canons, il gardera l’espoir jusqu’au moment où l’on tirera. Mais donnez à ce soldat la certitude de son arrêt de mort, vous le verrez devenir fou ou fondre en sanglots. Qui a pu dire que la nature humaine était capable de supporter cette épreuve sans tomber dans la folie? Pourquoi lui infliger un affront aussi infâme qu’inutile? Peut-être existe-t-il de par le monde un homme auquel on a lu sa condamnation, de manière à lui imposer cette torture, pour lui dire ensuite: «Va, tu es gracié!» [15]. Cet homme-là pourrait peut-être raconter ce qu’il a ressenti. C’est de ce tourment et de cette angoisse que le Christ a parlé. Non! on n’a pas le droit de traiter ainsi la personne humaine!
Bien qu’il eût été incapable d’énoncer ces idées dans les mêmes termes, le domestique en comprit la partie essentielle comme on pouvait en juger par l’expression attendrie de son visage.
– Ma foi, dit-il, si vous avez tellement envie de fumer, on pourrait arranger les choses. Mais il faudrait que vous vous dépêchiez, car voyez-vous que le général vous demande au moment où vous n’êtes pas là? Tenez, sous ce petit escalier, il y a une porte. Vous la pousserez et vous trouverez à main droite un petit réduit où vous pourrez fumer, en ouvrant le vasistas pour que votre fumée ne gêne pas…
Mais le prince n’eut pas le temps d’aller fumer. Un jeune homme qui portait des papiers à la main entra soudain dans l’antichambre. Tandis que le valet le débarrassait de sa pelisse il regarda le prince de côté.
– Voici, Gabriel Ardalionovitch, – dit le serviteur sur un ton de confidence et presque de familiarité – un monsieur qui se donne pour le prince Muichkine et le parent de Madame. Il vient d’arriver de l’étranger par le train, avec le seul paquet qu’il a à la main…
Le prince n’entendit pas le reste qui fut prononcé à voix basse. Gabriel Ardalionovitch écoutait attentivement et regardait le prince avec curiosité. Puis, cessant d’écouter, il aborda le visiteur, non sans une certaine précipitation:
– Vous êtes le prince Muichkine? demanda-t-il avec une amabilité et une politesse extrêmes.
C’était un fort joli garçon d’environ vingt-huit ans, blond, svelte et de taille moyenne. Il portait une barbiche à l’impériale; ses traits étaient affinés et sa physionomie intelligente. Mais son sourire, pour affable qu’il fût, avait quelque chose d’affecté; il découvrait par trop des dents qui ressemblaient à une rangée de perles, et dans la gaîté et l’apparente bonhomie de son regard perçait quelque chose de fixe et d’inquisitorial.
– Il n’a probablement pas ce regard quand il est seul, pensa machinalement le prince, – et peut-être ne rit-il jamais.
Le prince expliqua à la hâte tout ce qu’il put, à peu près dans les termes où il l’avait fait précédemment avec Rogojine, puis avec le domestique. Gabriel Ardalionovitch eut l’air d’interroger ses souvenirs:
– N’est-ce pas vous, demanda-t-il, qui avez envoyé, il y a une année ou peu s’en faut, de Suisse, si je ne me trompe, une lettre à Elisabeth Prokofievna?
– Parfaitement.
– En ce cas on vous connaît ici et on se souvient certainement de vous. Vous désirez voir Son Excellence? Je vais tout de suite vous annoncer. Il sera libre dans un moment. Mais vous devriez… Veuillez passer au salon de réception… Pourquoi monsieur est-il resté ici? demanda-t-il d’un ton sévère au domestique.
– Je vous le dis: ce monsieur n’a pas voulu entrer.
À ce moment la porte du cabinet s’ouvrit brusquement pour laisser passage à un militaire qui tenait une serviette sous le bras et prenait congé à haute voix.
– Es-tu là, Gania [16]? cria une voix du fond du cabinet. – Viens donc ici.
Gabriel Ardalionovitch fit un signe de tête au prince et s’empressa d’entrer dans le cabinet. Une ou deux minutes s’écoulèrent, puis la porte se rouvrit et l’on entendit la voix sonore mais avenante de Gabriel Ardalionovitch:
– Prince, donnez-vous la peine d’entrer.
Le général Ivan Fiodorovitch Epantchine attendait debout au milieu de son cabinet et regardait venir le prince avec une vive curiosité; il fit même deux pas à sa rencontre. Le prince s’approcha et se présenta.
– Bien, répondit le général; en quoi puis-je vous être utile?
– Je n’ai aucune affaire urgente qui m’amène ici; mon but est seulement de faire votre connaissance. Je ne voudrais cependant pas vous déranger, car je ne suis au courant ni de vos jours de réception, ni des ordres que vous pouvez avoir donnés pour vos audiences… Pour moi, je descends de wagon… j’arrive de Suisse…
Le général eut un sourire fugitif qu’il réprima aussitôt avec l’air de se raviser. Puis, ayant encore réfléchi un instant, il fixa de nouveau son hôte des pieds à la tête et, d’un geste rapide, lui montra une chaise. Lui-même s’assit un peu de côté et se tourna vers le prince dans une attitude d’impatience. Debout dans le coin de la pièce, Gania triait des papiers sur un bureau.
– Le temps me manque un peu pour faire de nouvelles connaissances, observa le général; mais comme vous avez certainement un but, je…
– Je prévoyais justement que vous attribueriez à ma visite un but particulier. Mon Dieu! je vous assure que je n’en ai pas d’autre que le plaisir de faire votre connaissance.
Читать дальше