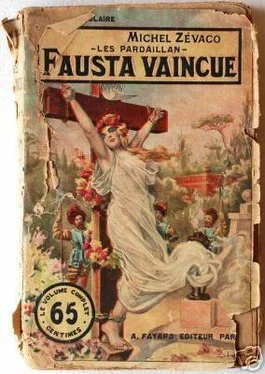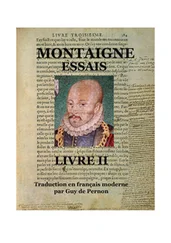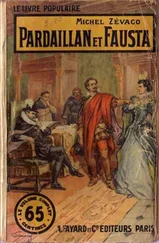Guise l’avait humilié. Guise, dans la période où il recherchait Violetta, avait eu pour Maurevert cette attitude insolente, cette défiance outrageante, ces précautions soupçonneuses qui accumulent dans un cœur de formidables rancunes. La reine l’avait donc admirablement jugé.
Maurevert lut sans surprise les mots que Catherine venait d’écrire. Il prit le bon, le plia froidement, le fit disparaître dans une poche de son pourpoint, et dit:
– Je remercie Votre Majesté. La date qu’elle indique me convient parfaitement.
– Cette date est donc bien rapprochée? demanda la reine palpitante.
– Oh! cela ne dépend pas de moi, madame! Car moi, je ne suis ni Dieu pour décréter la mort de monseigneur de Guise… ni le roi… pour l’envoyer à l’échafaud…
– L’échafaud! dit sourdement Catherine qui se redressa livide…
Ruggieri considérait ardemment Maurevert.
– Expliquez-vous nettement, dit à son tour l’astrologue… il ne s’agit donc pas…
– D’une arquebusade dans le genre de celle que j’envoyai à Coligny? fit Maurevert. Nullement. Aussi, au lieu d’écrire «Payable au lendemain de la mort», Votre Majesté eût plus justement écrit «Payable le lendemain de l’exécution de M. de Guise.»
– Maurevert, dit la vieille reine haletante, tu aurais donc vraiment le moyen de porter quelque terrible accusation contre le duc?… Parle, mon ami!… Je t’ai oublié jadis, c’est vrai… Mais si tu rendais un pareil service à mon fils… ce n’est pas cinq cent mille livres que tu pourrais espérer… entends-tu?…
– J’entends, Majesté. Mais je me contenterai de ce que vous avez bien voulu m’offrir, dit Maurevert. Il me reste donc à vous remettre papier pour papier… Vous m’avez donné un bon pour cinq cent mille livres. Je vais vous donner un bon pour une tête… Lisez ceci, madame…
À ces mots, en effet, il tira de sa poche une lettre qu’il remit à la reine. Catherine y jeta un avide regard et murmura:
– L’écriture de Guise…
Catherine et Ruggieri se penchèrent en même temps sur la lettre posée sur la table. Leurs deux têtes, qui se touchaient presque, formaient dans la pénombre un de ces tableaux que Rembrandt seul eût été capable de traduire. Il se dégageait une puissante et pénible impression, une sorte de poésie farouche, de ces deux têtes vieillies, ridées, d’une pâleur de marbre, mais où éclatait une joie funeste et terrible. Et ce spectacle eût impressionné tout autre que Maurevert… Voici ce que contenait la lettre:
«Madame,
Vous m’avez si bien, convaincu que je ne veux pas attendre une minute pour commencer l’exécution de l’admirable plan que vous m’avez développé. Ce n’est donc ni dans un mois ni dans huit jours que je me rendrai à Blois. J’y vais tout de ce pas. C’est donc à Blois même que j’aurai l’honneur de vous attendre afin de hâter ces deux événements que je souhaite avec une égale ardeur: la mort de qui vous savez, et l’union des deux puissances que vous connaissez.
«Henri, duc de Guise… pour le moment.»
Cette lettre, c’était celle-là même que Guise avait remise à Maurevert pour Fausta. Maurevert avait copié la lettre, remis la copie parfaitement imitée à Fausta et gardé l’original pour lui. La signature «Henri, duc de Guise… POUR LE MOMENT» constituait l’aveu échappé à la prudence du duc. Ce mot éclairait la lettre. «Qui vous savez», c’était le roi!…
Lorsque Catherine eut lu et relu cette lettre non pour en découvrir le sens, car ce sens lui apparaissait très clair, à elle, mais pour y chercher la possibilité d’accabler le duc sous une accusation capitale, elle demanda:
– À qui était adressée cette lettre?
– À la princesse Fausta… dit Maurevert.
– Donc, elle ne l’a pas reçue?…
– Pardon, madame. La princesse Fausta a reçu la lettre… ou une copie de la lettre.
Catherine le regarda avec une certaine admiration.
– Vous êtes sûr que nul autre que vous n’a vu cette lettre? reprit-elle.
– Parfaitement sûr, madame!…
Catherine appuya son coude sur la table, sa tête sur sa main, et les yeux fixés sur le papier, se plongea en une profonde rêverie.
– La princesse Fausta! murmura-t-elle enfin.
À quoi songeait-elle donc en prononçant ce nom?…
XXVI PARDAILLAN AU COUVENT
Nous laisserons Catherine de Médicis à sa rêverie, nous réservant de raconter plus tard ce qui advint de la trahison de Maurevert. Passons donc, avec la magique rapidité de la pensée, de Blois à Paris.
Quelques jours se sont passés depuis le départ du duc de Guise. Paris est inquiet.
Au palais Fausta, une douzaine de jours après le départ des Lorrains, un mouvement se produit. Fausta a lu la lettre que Guise lui a fait remettre par Maurevert. Fausta a pris la résolution de rejoindre le duc à Blois. Elle y voit un double avantage: d’abord, surveiller de près celui qui va devenir le roi de France, le pousser, surchauffer cet esprit si mobile quand il ne se trouve pas jeté dans l’action immédiate et violente; ensuite, cacher au duc cette sorte de faiblesse où elle se trouve depuis la trahison de Rovenni…
Tout est donc prêt pour le voyage. Une litière attend devant la porte. Douze hommes d’armes recrutés depuis peu lui serviront d’escorte. Depuis quatre jours, deux domestiques de confiance sont partis à Blois pour préparer les logis de la souveraine. Fausta monte dans la litière avec ses deux suivantes. Myrthis et Léa sont heureuses de ce voyage et enchantées de quitter, ne fût-ce que pour quelques jours, la sombre demeure.
Au moment du départ, Fausta jette un long regard sur ce palais où elle a pensé, aimé, souffert, calculé, combiné la plus formidable des conspirations. L’image de Pardaillan passe dans son esprit assombri. Mais elle secoue la tête… Il est mort… elle est délivrée!…
Enfin, elle donne le signal de départ, détourne ses yeux de ce palais où tant de choses se sont passées, et le cœur serré par un vague pressentiment, elle laisse tomber la ridelle de la litière. Une heure plus tard, Fausta et son escorte sont sur la route de Blois.
Or, à l’heure même où Fausta sortait de Paris par la porte Notre-Dame-des-Champs après une courte station au couvent des jacobins situé dans le voisinage de cette porte, le chevalier de Pardaillan rentrait dans la ville par la porte Saint-Denis, c’est-à-dire par l’extrémité opposée.
Il s’en était venu à petites journées de Gravelines qu’il n’avait quitté qu’après s’être assuré de la prochaine guérison du messager à qui il avait fourni un si joli coup d’épée. À Amiens, Pardaillan s’était arrêté deux jours. Il éprouvait une certaine lassitude, non pas de la route ou des batailles auxquelles sa destinée, disait-il, le mêlait malgré lui, mais de cette solitude où il se trouvait. Solitude d’âme et de corps… Il était seul dans la vie…
En somme, il s’intéressait à deux choses: d’abord frapper Maurevert, car c’eût été pour lui la pire et la plus affreuse défaite que de disparaître ou de mourir sans avoir écrasé cette vipère. Ensuite, faire rentrer dans la gorge du duc, moyennant sa bonne rapière, les insultes que Guise avait proférées contre lui, le jour où, pour sauver Huguette, le chevalier s’était rendu.
C’était donc surtout dans un moment d’indécision, que Pardaillan s’était arrêté à Amiens. Étendu sur le lit d’une pauvre chambre d’auberge, les bras croisés, les yeux fixes, il songeait.
«Supposons, dit-il, que je terrasse Maurevert, et Guise et Fausta. Que ferai-je après?»
Voilà où était la question… Que faire de sa vie?… Et la question était effroyable car Pardaillan ne savait que faire de sa vie!…
Читать дальше