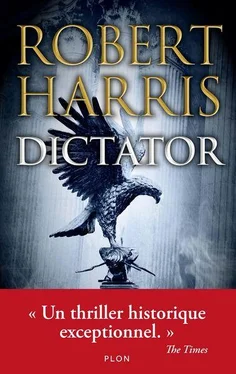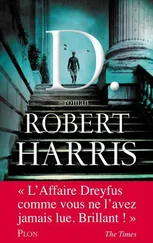Cette nuit-là, je me couchai en grelottant malgré la chaleur athénienne. Je claquais des dents et me figurais que Cicéron me dictait un texte dont un exemplaire devait aller à Pompée, et un autre à César pour les assurer chacun de son soutien. Mais une formule qui eût plu à l’un eût mis l’autre en fureur, et je passai des heures dans la plus grande panique, à tenter de construire des phrases résolument neutres. Chaque fois que je croyais y parvenir, mes mots se brouillaient dans ma tête et il me fallait tout recommencer. C’était de la folie pure, et pourtant tout me paraissait d’une réalité absolue, et je pris conscience au matin, lors d’un épisode lucide, que je subissais un nouvel accès de la fièvre qui m’avais saisi à Arpinum.
Nous devions ce même jour prendre la mer pour Corinthe. Je redoublai d’efforts pour faire comme si de rien n’était, mais j’imagine que j’avais fort mauvaise mine et les yeux creusés. Cicéron essaya de me persuader de manger quelque chose, mais j’étais incapable de garder quoi que ce soit. Même si je pus embarquer sans aide, je passai la journée de traversée dans un état presque comateux et, lorsque l’on accosta le soir même à Corinthe, il fallut vraisemblablement me porter à terre et me mettre au lit.
La question se posait de ce qu’on allait faire de moi. J’avais grand peur que l’on me laisse en arrière, et Cicéron se refusait à m’abandonner. Mais il devait rentrer à Rome, d’abord pour faire le peu qui serait en son pouvoir afin d’empêcher la guerre civile imminente, ensuite pour essayer de s’assurer le triomphe auquel, aussi irréaliste que fût cet espoir, il croyait encore. Il ne pouvait se permettre de perdre des jours en Grèce à attendre que son secrétaire se remette. Avec le recul, je me dis que j’aurais dû rester à Corinthe. Mais nous avions misé sur le fait que je serais assez fort pour supporter les deux jours de voyage jusqu’à Patras, où un vaisseau attendait de nous conduire en Italie. C’était une décision stupide. On m’enveloppa dans des couvertures et m’allongea à l’arrière d’une voiture qui me fit suivre la route côtière dans l’inconfort le plus total. Une fois arrivé à Patras, je les suppliai de s’en aller sans moi. J’avais la certitude qu’un long voyage en mer me tuerait. Cicéron hésitait encore, mais il finit par accepter. Je restai alité près du port, dans une villa qui appartenait à Lyson, un marchand grec. Cicéron, Marcus et le jeune Quintus se rassemblèrent autour de mon lit pour me dire au revoir. Ils me serrèrent la main. Cicéron pleura. Je risquai une plaisanterie hésitante sur nos adieux qui évoquaient le lit de mort de Socrate. Puis ils furent partis.
Cicéron m’écrivit dès le lendemain une lettre qu’il me fit parvenir par Marion, l’un de ses esclaves les plus sérieux.
Je croyais pouvoir supporter facilement ton absence : décidément, je ne saurais m’y faire. Je me reproche comme un tort de t’avoir quitté. Si depuis que tu as cessé la diète, tu te crois en état de partir, tu en es le maître. Avec ton esprit, tu vas me comprendre à merveille. Je t’aime pour toi et pour moi. L’un de ces sentiments dit : reviens bien portant ; l’autre : reviens bien vite ; mais le premier a le dessus. Commence donc par te bien porter. De tes services sans nombre, ce sera le plus précieux.
Il m’écrivit de nombreuses lettres pendant ma maladie — il lui arriva même de m’en envoyer trois dans la même journée. Naturellement, il me manquait tout autant que je lui manquais, mais ma santé était détruite. Je ne pouvais pas voyager. Huit mois s’écouleraient avant que je puisse le revoir, et alors son monde, notre monde, aurait complètement changé.
Lyson se révéla un hôte attentionné et fit venir son propre médecin, un Grec du nom d’Asclapon, pour me soigner. On m’administra purgations et tisanes exsudatives, on me mit à la diète et on m’hydrata, tous les remèdes habituels contre la fièvre tierce alors qu’il m’aurait fallu surtout du repos. Cicéron, cependant, s’inquiétait que Lyson ne fût un peu négligent, d’abord parce que tous les Grecs le sont , et il fit en sorte qu’on me transfère au bout de quelques jours dans une demeure plus paisible et confortable située au-dessus des bruits du port. Cette maison appartenait à un ami d’enfance de Cicéron, Manius Curius : Je ne compte absolument que sur les soins de Curius. C’est le meilleur homme du monde et celui qui m’aime le plus. Abandonne-toi à lui sans réserve.
Curius était effectivement un homme aimable et cultivé. Veuf, banquier de profession, il veilla sur moi au mieux. On me donna une chambre avec une terrasse orientée à l’ouest, sur la mer, et, au bout de quelque temps, quand je commençai à me sentir un peu plus solide, je pus m’asseoir dehors pendant une heure, l’après-midi, à regarder les vaisseaux marchands entrer et sortir du port. Curius était en liaison régulière avec toutes sortes de relations à Rome — sénateurs, chevaliers, percepteurs, armateurs —, et son courrier ajouté au mien ainsi que la situation géographique de Patras, à l’entrée de la Grèce, faisaient que nous recevions les nouvelles politiques aussi rapidement qu’il était possible dans cette partie du monde.
Un jour de la fin du mois de janvier — ce devait être trois mois après le départ de Cicéron —, Curius entra dans ma chambre, la mine sombre, et me demanda si je me sentais assez bien pour recevoir de mauvaises nouvelles. Je hochai la tête et il lâcha :
— César a envahi l’Italie.
Des années plus tard, Cicéron s’interrogea souvent : les trois semaines que nous avions perdues à Rhodes auraient-elles pu faire la différence entre la guerre et la paix ? Si seulement il avait pu arriver à Rome un mois plus tôt ! se lamentait-il. Il était l’un des rares à être écoutés par les deux camps et, dans le peu de temps où il s’était trouvé dans les faubourgs de Rome, avant que le conflit n’éclate — soit à peine une semaine —, il me confia qu’il avait commencé à négocier l’ébauche d’un compromis : que César renonce à la Gaule et à toutes ses légions sauf une, contre le droit de se présenter au consulat in absentia . Mais il était déjà trop tard. Pompée n’était pas convaincu ; le Sénat rejeta la proposition, et César s’était, soupçonnait-il, déjà décidé à frapper, ayant estimé qu’il ne serait jamais plus fort qu’à ce moment. « Je ne voyais autour de moi que des fous ne parlant que guerre et batailles. »
Dès qu’il apprit l’invasion de César, il se rendit tout droit chez Pompée, sur le mont Pincio, pour l’assurer de son soutien. Les chefs en faveur de la guerre — Caton, Ahenobarbus, les consuls Marcellinus et Lentulus, quinze ou vingt hommes tout au plus — s’y pressaient déjà. Pompée était furieux. Et il était gagné par la panique aussi. Il croyait à tort que César avançait avec toutes ses troupes, soit dans les cinquante mille hommes. En réalité, l’audacieux n’avait franchi le Rubicon qu’avec un dixième de ses troupes, comptant sur l’effet de sidération suscité par son attaque. Mais cela, Pompée ne le savait pas encore, et il décréta l’abandon de la ville. Il ordonna à tous les sénateurs de quitter Rome. Tous ceux qui resteraient sur place seraient considérés comme des traîtres. Quand Cicéron rechigna, arguant que c’était pure folie, Pompée le rappela à l’ordre :
— Et cela vaut pour toi aussi, Cicéron !
Cette guerre, poursuivit-il, ne se déciderait pas à Rome, ni même en Italie, ce serait faire le jeu de César. Non, ce serait une guerre mondiale portée en Espagne, en Afrique, en Méditerranée orientale et surtout en mer. Il instaurerait un blocus sur l’Italie. Il affamerait l’ennemi pour le soumettre. César régnerait sur un charnier.
Читать дальше