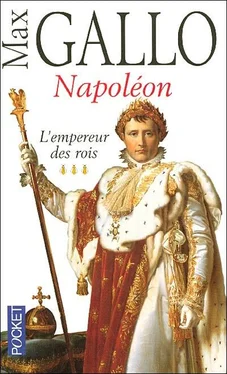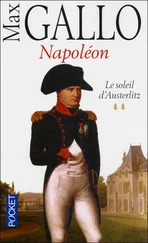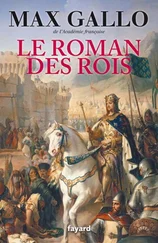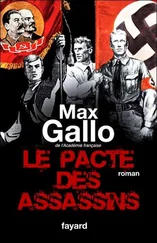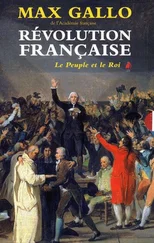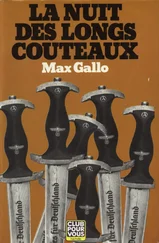Quand, enfin, à la mi-janvier, il la retrouve dans sa chambre du château royal, il la serre avec fougue et il s'indigne d'abord qu'elle se refuse, qu'elle veuille s'enfuir. Comme si elle n'avait pas imaginé ce qu'il attendait d'elle. Quel jeu est donc le sien ? Quel prix veut-elle qu'il paie ?
Elle pleure, se confie. Il parle à son tour. Il raconte. Il séduit. Il a la sincérité d'un jeune homme. Et cette innocence retrouvée pour quelques heures, cette liberté, ces confidences désintéressées l'émeuvent. Les heures passent. Elle repart sans qu'il ait cherché à la forcer.
« Marie, ma douce Marie, ma première pensée est pour toi, mon premier désir est de te revoir », écrit-il dès l'aube.
Ce sont des mots perdus depuis des années, depuis la campagne d'Italie, quand il écrivait à Joséphine, qu'il l'implorait, qui surgissent à nouveau, clairs, frais.
« Tu reviendras, n'est-ce pas ? Tu me l'as promis. Sinon l'aigle volerait vers toi ! Je te verrai à dîner, l'ami le dit. Daigne donc accepter ce bouquet : qu'il advienne un lien mystérieux qui établisse entre nous un rapport secret au milieu de la foule qui nous environne. Exposés aux regards de la multitude, nous pourrons nous entendre. Quand ma main pressera mon cœur, tu presseras ton bouquet ! Aime-moi, ma gentille Marie, et que ta main ne quitte jamais ton bouquet !
« N. »
Elle est à lui, puisqu'elle revient. Il ne peut se contenter de cette sentimentalité platonique. Elle a refusé la parure de bijoux qu'il lui a fait porter ? Elle n'est pas quitte. Il faut maintenant qu'elle cède. N'a-t-il pas montré qu'il l'estimait ? Qu'elle n'est pas pour lui l'une de ces femmes qu'on prend et qu'on renvoie ?
Il s'emporte, jette sa montre à terre, la piétine. Il est aussi cet homme-là, qu'on ne peut éconduire.
Elle cède enfin.
Mais cela ne lui suffit pas. Ce corps jeune qu'il a pris, il veut qu'il se donne. « Aime-moi, Marie, aime-moi. »
Il la garde près de lui. Elle est sienne. Sa douceur et sa tendresse, sa soumission le comblent. Il ne se lasse pas de la regarder. Elle est si claire, si jeune. Il voit en elle une image de lui qu'il avait perdue.
Lorsqu'elle s'absente, il la rejoint.
« Je m'invite, ma douce Marie, pour 6 heures. Fais-nous servir dans ton boudoir et ne fais rien de spécial. »
Elle sera là et cela suffit.
Tout est à nouveau en ordre en lui. Il a atteint son but. Il peut à nouveau, calmement, avec sa lucidité aiguë, dresser son plan de bataille.
Ce mois de janvier 1807, alors que Ney et Bernadotte livrent les premiers combats contre les Russes au nord, aura été une période d'attente.
Il fallait aussi pour cela qu'une passion nouvelle l'habite.
Maintenant il revient aux cartes, l'esprit libre. Il se sent régénéré par cet amour, ce regain de jeunesse, Marie si désintéressée.
Il va quitter Varsovie pour envelopper les troupes de Bennigsen dans une boucle dont Eylau et Friedland, au nord, seraient le centre. Il compte gagner Willemberg, au sud de ces deux villes.
Durant tout ce mois il a, jour après jour, dû répondre à Joséphine, intuitive, pressante et sans doute informée déjà.
Elle a utilisé tous les arguments pour qu'il accepte de la recevoir à Varsovie. Mais il n'a pas cédé.
« Pourquoi des larmes, du chagrin ? N'as-tu donc plus de courage ? » lui a-t-il demandé.
Il faut qu'elle « montre du caractère et de la force d'âme ». « J'exige que tu aies plus de force, lui a-t-il répété. L'on me dit que tu pleures toujours : fi ! que cela est laid !.. Sois digne de moi. Une impératrice doit avoir du cœur ! »
Il est si distant d'elle, maintenant. « Adieu, mon amie », lui dit-il.
Enfin elle est rentrée à Paris, mais elle pleure toujours.
Il n'aime pas cette douleur qu'elle affiche.
Et, dans la berline qui le conduit de Varsovie à Willemberg, il se met à écrire pour qu'elle comprenne ce qu'il attend d'elle.
« Mon amie, ta lettre du 20 janvier m'a fait de la peine ; elle est trop triste. Voilà le mal de ne pas être un peu dévote ! Tu me dis que ton bonheur fait ta gloire : cela n'est pas généreux, il faut dire : le bonheur des autres fait ma gloire ; cela n'est pas conjugal, il faut dire : le bonheur de mon mari fait ma gloire ; cela n'est pas maternel, il faudrait dire : le bonheur de mes enfants fait ma gloire ; or, comme les peuples, ton mari, tes enfants ne peuvent être heureux qu'avec un peu de gloire, il ne faut pas tant en faire fi ! »
Il s'arrête. Il n'aime pas se relire. La pensée court et l'élan justifie l'idée. On ne revient pas sur ce qui a été pensé, fait, écrit.
Il sent bien qu'elle ne va pas aimer cette lettre. Mais le temps entre eux a creusé son sillon. C'est la nature des choses.
Il reprend :
« Joséphine, votre cœur est excellent, et votre raison faible ; vous sentez à merveille, mais vous raisonnez moins bien. »
Il faut qu'elle mesure la distance qu'il y a désormais entre eux.
« Voilà assez de querelle. Je veux que tu sois gaie, contente de ton sort, et que tu obéisses, non en grondant et en pleurant, mais de gaieté de cœur, et avec un peu de bonheur.
« Adieu, mon amie, je pars cette nuit pour parcourir mes avant-postes.
« Napoléon »
7.
Napoléon, du sommet de la colline, domine le ravin. Au-delà d'un pont étroit, dans un petit bois qui cache en partie la ville de Hoff, il distingue les uniformes des grenadiers russes. Il faudrait disposer de pièces d'artillerie pour débusquer ces troupes qui fourmillent sous les branches couvertes de neige. Ils sont là plusieurs bataillons, à n'en pas douter.
Est-ce enfin le début de la vraie bataille ? Depuis une semaine, Bennigsen se dérobe, recule vers Eylau et Königsberg.
« Je pense que nous ne sommes pas éloignés d'une affaire », dit Napoléon.
Mais il n'en est pas sûr. Il a déjà livré bataille à Allenstein. Davout a bousculé les Russes à Bergfride. Il ne s'est agi que d'affrontements limités.
« Je manœuvre sur l'ennemi, reprend Napoléon en s'adressant à Murat, s'il ne se retire pas à temps il pourrait fort bien être enlevé. »
Il se penche sur l'encolure de son cheval. Il veut accrocher les Russes, les retenir pour les encercler et les écraser. Mais c'est à croire que Bennigsen est au courant de la manœuvre. Il recule à point nommé. Peut-être a-t-il saisi l'un des courriers envoyés à Ney ou à Bernadotte, qui sont sur l'aile gauche et remontent la rivière Passarge cependant que Davout tient l'aile droite.
- Chargez sans attendre, dit Napoléon à Murat.
La cavalerie légère, hussards et chasseurs, s'élance, puis les dragons du général Klein.
Il faut rester impassible, voir les chevaux et les hommes basculer du pont sous la mitraille, s'abattre dans la neige, glisser sur la glace.
Maudit soit ce pays.
Il l'a écrit à Joseph, qui plastronne dans son royaume de Naples.
« C'est donc une mauvaise plaisanterie que de nous comparer à l'armée de Naples, faisant la guerre dans le beau pays de Naples où l'on a du vin, de l'huile, du pain, du drap, des draps de lit, de la société et même des femmes. »
Ici, rien.
Depuis qu'il a quitté Varsovie, il y a huit jours, Napoléon vit aux côtés des soldats. Il voit. Il entend les plaintes. Du pain, réclament-ils. Et même la paix !
Les ventres sont creux, les paupières sont brûlées par le froid.
« Officiers d'état-major, colonels, officiers ne se sont pas déshabillés depuis deux mois, et quelques-uns depuis quatre, explique encore Napoléon à son frère aîné. J'ai moi-même été quinze jours sans ôter mes bottes... Au milieu de ces grandes fatigues, tout le monde a été plus ou moins malade. Pour moi, je ne me suis jamais trouvé plus fort, et j'ai engraissé. »
Читать дальше