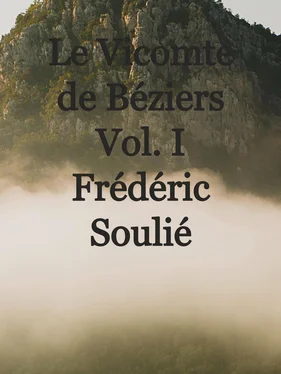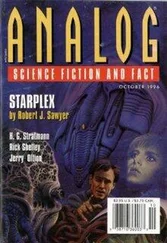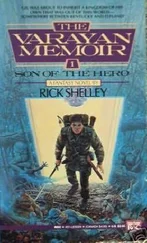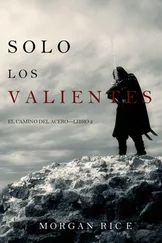Et les jeunes chevaliers, après cette harangue, s’enfuirent en applaudissant et appelant plus fort que jamais leurs valets et leurs esclaves pour soigner les apprêts de leur départ. Un seul demeura pensif dans l’embrasure d’une croisée. C’était un jeune homme de vingt ans au plus, pâle et brun, frappé au cœur d’un malheur solennel ou d’une passion profonde et sans espoir. Roger le considéra un moment, il contempla en silence ce beau et jeune visage, si triste et si résigné. Dans son regard, plein d’une tendre compassion, on pouvait deviner que Roger se retraçait l’histoire des douleurs de cette jeune existence, car une larme vint presque à ses yeux, et il lui dit, d’une voix émue :
— Sire Pons de Sabran, vous me suivrez, n’est-ce pas ?
— C’est un devoir en guerre, seigneur vicomte, répondit gravement le jeune homme.
— Ce serait amitié en partie de plaisir, reprit affectueusement Roger.
— Amitié ! répéta le jeune homme avec un triste sourire. Amitié !
— Pons, reprit le vicomte en lui tendant la main, viens-y, je t’en supplie. Viens-y. Puis, hésitant un moment, il ajouta : Le comte Aimer de Narbonne y sera.
— Et sans doute Étiennette avec lui, murmura le jeune chevalier en chancelant et le regard égaré.
— Étiennette y sera, reprit Roger en assurant sa voix ; la belle Étiennette, la louve de Penaultier, consent à suivre son suzerain, le comte de Narbonne, et à quitter ses montagnes pour la cour du roi d’Aragon.
— Et pour l’amour du vicomte Roger, reprit froidement le jeune Pons.
— Et pour l’amour de toi si tu veux ne plus être un enfant, et ne pas t’effaroucher de ce nom de louve qui lui sert de masque aux yeux des sots et des fous.
— Et où sont les sots et les fous ? s’écria impétueusement le sire de Sabran, en portant la main sur la garde de son épée.
— Le premier des sots est son mari ; le plus grand des fous c’est toi, qui vous laissez prendre à ses grimaces et à ses colères, répliqua doucement le vicomte.
— Oh ! tais-toi, Roger, dit le jeune homme, tais-toi ! L’avoir aimée deux années entières ; à chaque heure, à chaque minute de ces deux années, avoir fait d’elle ma vie, mon culte, ma croyance ; l’avoir vénérée jusqu’à n’oser penser qu’elle était belle, jusqu’à craindre de lui faire injure en baisant la place où ses pieds s’étaient posés, et savoir que, dans une nuit d’orgie, toi, Roger, tu l’as conduite délirante et folle, et pendue à tes lèvres, de la salle du festin jusqu’à ton lit, où elle s’est épuisée d’amour dans tes bras : non, c’est souffrir l’enfer que d’y penser. Que serait-ce si je la voyais ?
— Ce serait ton tour, enfant, si tu la voyais.
— Ah ! ne me dis pas cela, Roger, ne me fais pas croire qu’elle se donnerait à moi comme elle a fait à toi, car alors elle serait une débauchée, ouvrant ses bras aux caresses de tout amant : dis-moi que c’était une nuit de sabbat ; que tu l’as fascinée, trompée ; dis-moi que tu l’as enivrée, rendue folle, égarée, perdue ; mais ne me dis pas que pour moi aussi elle retrouverait ces brûlants baisers et ces instants d’amour que tu nous as si cruellement racontés ; car ce serait vice alors et non plus folie, ce serait crime, et je la mépriserais.
— Et tu ne l’aimerais plus au moins ? dit doucement Roger.
— Oh ! ajouta Pons avec un regard d’une inexprimable douleur, je l’aimerais toujours ! et il cacha sa tête dans ses mains.
Roger le quitta et entra dans une vaste chambre magnifiquement meublée. À son aspect des femmes, richement vêtues, se levèrent et laissèrent voir leur surprise de la venue du vicomte ; l’une d’elles s’avança pour soulever le rideau de la porte qui conduisait aux appartements plus éloignés.
— C’est inutile, dit Roger, avertissez Arnauld de Marvoill que je l’attends. Ne dites pas à la vicomtesse que je suis ici.
Puis il se mit à se promener activement, selon sa coutume. De rapides réflexions se pressaient dans son esprit et venaient successivement s’écrire sur son front où se succédaient de vives physionomies d’impatience et de colère ; il semblait qu’il redoutât l’entretien qu’il allait avoir, et qu’il s’irritât par avance des remontrances qu’il prévoyait. Il était si absorbé dans cette sorte de discussion anticipée, qu’il ne vit pas entrer la personne qu’il attendait.
Arnauld de Marvoill avait été le poète le plus célèbre de son époque ; il avait passé en outre pour l’un des hommes les plus remarquables par sa grâce et sa beauté ; mais à l’époque de cette histoire, de jeunes rivaux lui avaient succédé dans la faveur des princes et des dames, et ce n’est qu’avec un violent chagrin qu’il avait vu arriver ce changement. Cependant il avait retenu, autant que possible, les souvenirs du passé. Son costume presque romain se composait encore de la tunique et de la toge du siècle précédent. Des bandelettes pourpres, croisées sur les jambes, y attachaient cette sorte de pantalon qu’avait adopté la mollesse du Bas Empire ; il portait les cheveux courts, et sa barbe encore noire était soigneusement peignée et parfumée. Il attendit un moment que Roger lui adressât la parole ; enfin il lui parla le premier.
— Vicomte Roger, vous m’avez fait demander ?
— J’ai à te parler Arnauld, répondit le jeune homme sans arrêter sa promenade.
— Je le crois, dit Arnauld.
— Sais-tu ce que j’ai à te dire ?
— Je crains de le deviner.
Roger examina Arnauld ; il vit que le poète s’était préparé à ne pas fléchir dans la discussion qu’il prévoyait, et une teinte d’humeur et de chagrin se montra sur son visage. Il reprit sa marche, et, se parlant à lui-même, il s’exalta peu à peu.
— Toujours des obstacles, dit-il ; des hommes qui se nomment mes amis et qui s’arment contre moi de ma condescendance. Écoute, Arnauld, je viens de voir Saissac, le vieux fou m’a quitté en me menaçant et en se dégageant de ma suzeraineté.
— C’est que vous avez fait quelque chose de mal, dit Marvoill en interrompant le vicomte.
— Peux-tu parler ainsi ? dit Roger, Saissac est ton ennemi.
— Sans doute, mais il est votre ami.
— Eh bien ! s’écria Roger, ami ou ennemi, Saissac m’a résisté et m’a bravé ; il a épuisé tout ce que j’ai de patience. Écoute-moi donc et obéis.
— J’écouterai d’abord, répondit froidement Arnauld.
Roger le mesura de son regard de feu ; mais le poète, comme pour échapper à cette puissance, tenait les yeux baissés ; et le vicomte continua.
— Demain tu partiras pour Montpellier avec cette enfant dont tu as réclamé le soin.
— Quelle enfant ? dit Arnauld.
— Quelle enfant ? reprit tristement Roger. Cette enfant à laquelle toi et ma mère m’avez lié pour la vie. Cette fille au berceau dont vous avez fait ma femme, toi et ma mère, pendant que votre volonté était la mienne, pendant que Saissac perdait d’un autre côté mes privilèges.
— Lorsque ta mère, moi et le conseil de tes tuteurs nous t’avons fait épouser Agnès, le testament de Guillaume, qui lui assurait le comté de Montpellier pour héritage, existait encore.
— Oui, répliqua avec dérision le vicomte, Pierre d’Aragon vous l’affirmait, et pendant ce temps il épousait Marie, la sœur aînée d’Agnès, la pauvre déshéritée, comme il la nommait. Puis, lorsque Guillaume est mort, il ne s’est plus trouvé de testament. Le roi d’Aragon a eu le comté, et moi j’étais marié avec une femme au maillot.
— Elle a grandi, seigneur, dit Marvoill.
— Et ma haine pour elle aussi, répondit sèchement Roger.
— Pourquoi la haïssez-vous ? Vous ne la connaissez pas.
Читать дальше