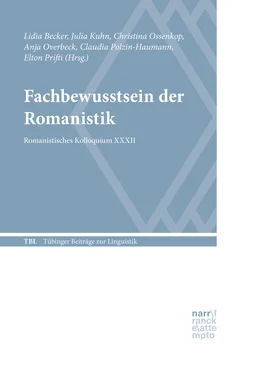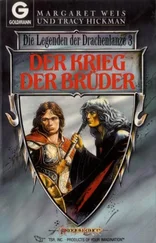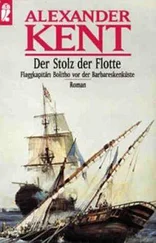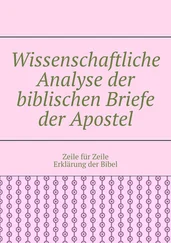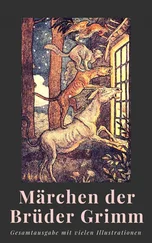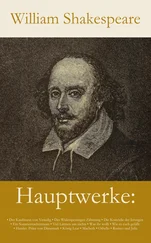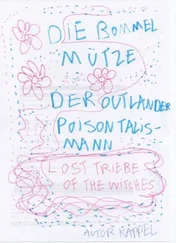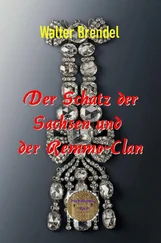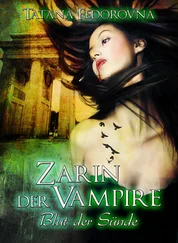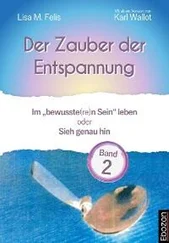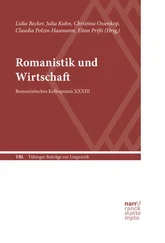1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Entre 1816 et 1821, le chercheur François-Juste-Marie Raynouard, alors reconnu de ses contemporains pour son travail sur le provençal, prononça l’idée que l’origine des langues romanes comportait deux volets.3 Dans la Romania centrale et occidentale, la langue originelle qui se forma aurait correspondu dans ses grandes lignes à l’ancien provençal. À l’opposé, le valaque, comme on appelait alors le roumain, se serait construit sur une autre variété romane originelle. Autant la forme occidentale qu’orientale se seraient constituées grâce à des mélanges linguistiques particuliers, un point de vue tout à fait courant à l’époque. Dans la tentative de réfuter cette opinion tout en accordant une origine commune aux langues romanes, les philologues allemands Friedrich Diez et Hugo Schuchardt prirent une place à part. C’est à leurs travaux et enseignements que l’on doit l’établissement d’une philologie romane comme discipline autonome, qui expliqua le développement de toutes les langues romanes à partir d’un latin populaire relativement uniforme, donc d’un latin avant tout parlé, pour lequel le terme de « latin vulgaire », c’est-à-dire latin du peuple, s’est imposé sur le plan terminologique.4
La formule trouvée paraissait simple : les langues romanes ne proviennent pas du latin classique écrit, mais du latin vulgaire parlé. Le problème de cette hypothèse était cependant que la mise en exergue de l’oralité anéantissait de cette manière le concept d’une langue de culture uniforme s’étant construite au cours de l’histoire et qu’on séparait ainsi le latin en une partie écrite normée et une partie orale non normée (du moins non normée uniformément). Cette division ne pouvait cependant valoir pour un concept concevable et valide d’une langue construite dans l’histoire et encore moins dans la vision d’une langue comme organisme, comme elle a été prédominante dans la philologie romane depuis ses débuts et pendant longtemps.5
La philologie romane se sert encore aujourd’hui de l’idée du latin vulgaire parlé afin de déterminer l’origine des langues romanes (cf. la note de bas de page n°2). Mais aujourd’hui, une majorité de romanistes reconnaît que le latin vulgaire est une construction hypothétique, qui peut être qualifiée de reconstruction méthodologique et descriptive abstraite se référant ainsi à la méthodologie des études indo-européennes précoces. Quoi qu’il en soit, le concept de latin vulgaire n’est plus compatible avec l’idée contemporaine d’une définition socio-culturelle et communicative de la langue. Ainsi, il est même ouvertement rejeté aujourd’hui par certains6 ou n’est simplement plus mentionné dans des présentations historico-linguistiques.7 Mais il n’est pas si simple de le rejeter ou de le bannir de la philologie romane,8 car la discipline a construit sa légitimité sur la base de prémisses qui ont vu le jour en relation avec la construction théorique du latin vulgaire. Afin d’expliquer cette idée, il est opportun de s’intéresser aux conséquences du second axiome.
Axiome n°2 : L’origine des langues romanes n’est pas monogénétique, c’est-à-dire qu’il n’existe pas une langue d’origine. (principe d’hétérogénéité)
À première vue, cet axiome semble contradictoire au modèle du latin vulgaire. En réalité, on ne pouvait défendre le latin vulgaire comme définition imparfaite d’une langue, donc comme modèle d’une langue de culture dont la forme écrite est totalement différente, que si on acceptait que l’interprétation monogénétique de l’origine des langues romanes se référait de manière unilatérale à un modèle de langue écrite de cette langue d’origine, dans lequel on ne pouvait trouver de potentiel pour le développement de différentes langues romanes.
Essayons à présent de cerner la problématique à l’aide d’une comparaison. La langue écrite allemande s’est développée comme un concept relativement uniforme pour les variations très hétérogènes de l’allemand. Les Allemands du Nord utilisaient déjà ce modèle de langue écrite à une époque où le bas allemand étaient prédominant dans le domaine parlé. Les Bavarois, eux, conservent leur dialecte jusqu’aujourd’hui mais se servent également de la langue écrite allemande uniforme. Les variétés autrichiennes, suisses et alsaciennes de l’allemand, qui ne se comprennent mutuellement qu’avec peine, utilisent dans le domaine écrit, par exemple dans la presse, la langue allemande uniforme.1
Ce principe d’une langue écrite commune, dans laquelle une variété-standard parlée neutre de l’allemand prend sa source, peut s’appliquer à la construction des langues romanes. Il nous faut alors imaginer que le latin normé de l’Empire romain exerçait cette fonction englobante mais admettait l’existence de variétés orales hétérogènes du latin. Nous ne connaissons pas ces variétés du latin parlé dans l’Empire romain car elles n’avaient pas d’équivalent écrit et n’ont pas été transmises. Nous savons néanmoins qu’elles existaient, même si romanistes et latinistes ont longtemps ignoré cette évidence. Plus récemment, un latiniste a apporté d’importants éclaircissements à ce sujet, qui permettent d’adopter un point de vue nouveau et adéquat du problème. Dans le cadre d’une étude de grande ampleur, J.N. Adams a souligné qu’une approche différenciée du latin de l’Empire romain est nécessaire, surtout en considération des sources littéraires, et qu’une structure de variétés diatopiques se dessine. L’ouvrage d’Adams paru en 2007, The Regional Diversification of Latin. 200 BC – AD 600 ,2 ne reçoit toujours pas l’attention des romanistes qu’il mérite.3 On y trouve l’explication détaillée du développement de différences régionales dans le latin écrit transmis jusqu’aux débuts des langues romanes. Ce faisant, l’auteur livre des preuves de l’hétérogénéité supposée des formes parlées du latin de cette époque.
Les romanistes de leur côté ont d’abord appliqué l’axiome de l’hétérogénéité linguistique concernant l’origine des langues romanes à un concept théorique des mélanges et du contact linguistiques. À l’origine, c’est l’idée de mélanges linguistiques incontrôlables qui était prédominante. Elle amena par exemple August Wilhelm Schlegel, un « romaniste » avant la lettre, à considérer les langues romanes comme langues mixtes dès le début du XIXe siècle.4 Se mélanger ou se fondre : cela n’était possible que pour des dialectes italiques ou gaulois et certaines formes régionales du latin, par exemple, dans des situations de contact purement orales et sans considération des traditions de langue écrite.
Ainsi, la recherche sur les strats, donc la définition de substrats et de superstrats comme explication du développement des langues romanes, qui a sa place dans la philologie romane, s’est construite sur l’idée d’un contact des langues orales et a contribué à l’image d’origines hétérogènes avant même l’émergence des dialectes romans. L’interprétation historique du territoire linguistique italien en est l’illustration parfaite : ce que nous considérons aujourd’hui comme la « langue italienne » n’est, en regardant de plus près, qu’un territoire linguistique complètement hétérogène qui se caractérise par l’existence de dialectes très variés et en partie très différents sur le plan de la forme. L’idée que toutes ces variétés constituent ensemble « l’italien » s’explique uniquement par la fonction englobante du dialecte florentin, qui s’est développée depuis la Renaissance. L’émergence et la diffusion d’une langue écrite normée toscane a eu sa part dans cette évolution.5
Читать дальше