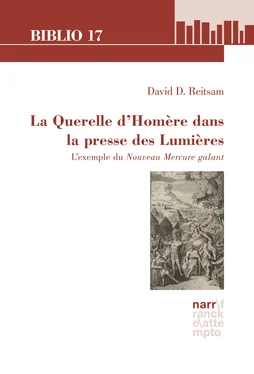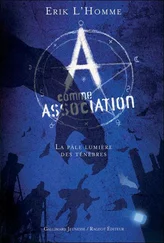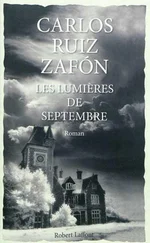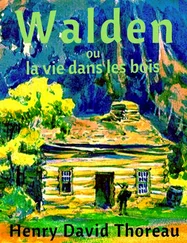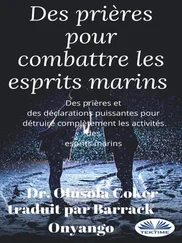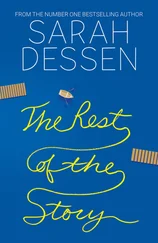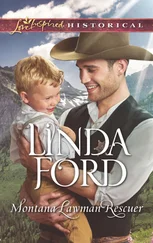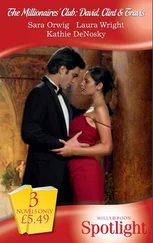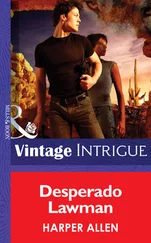Tout d’abord, il faut donc parler de notre point d’attaque, c’est-à-dire notre problématique. La recherche des idées anciennes et modernes construira ainsi notre lecture du Nouveau Mercure galant que nous quitterons pourtant régulièrement afin de contextualiser les textes. Ensuite, il faut décrire notre « perspective », qui est celle de Larry F. Norman et de Delphine Denis. Dans Le Parnasse galant , Denis évoque la question de l’« archive » et parle des « archives galantes » au pluriel :
[Les textes] forment en outre un réseau serré, de circulation diffuse et complexe ; étroitement tissés entre eux, ils se présentent comme un ‘trésor’ commun, où contemporains et lecteurs à venir pourraient puiser références et citations, pour s’autoriser [en italique dans l’original] à leur tour19.
Dans le même temps, Denis exclut la dimension du terme « archive » qui renvoie au travail des archéologues : elle ne cherche guère à « exhumer les documents20 ». À l’instar de Foucault, Denis étudie des discours sur une période plus longue. Dans son sous-titre, elle indique qu’elle s’intéresse à tout le XVII esiècle et, dans L’Ordre du discours , Foucault esquisse également des projets de recherche relevant de l’ensemble critique. Il pense par exemple à se pencher sur « la sexualité depuis le XVI esiècle jusqu’au XIX esiècle21 ». Force est de constater qu’il y a un clivage non-négligeable entre les siècles que Denis ou Foucault envisagent comme cadre de leurs recherches et les quelques années qui sont au cœur de notre projet. En outre, les discours auxquels nous nous intéressons forment une autre limitation – ou plutôt délimitation – de nos recherches. Si Delphine Denis se concentre sur « le seul domaine littéraire22 », nous préférons une approche plus globale et plus « horizontale » qui rend mieux compte de la complexité des enjeux de la Querelle d’Homère et qui inclut, à côté de la critique du goût, les dimensions politique et épistémologique de la querelle. Nous y suivons l’exemple de Larry F. Norman qui étudie également plusieurs aspects de la Querelle des Anciens et des Modernes – en l’occurrence des questions politiques, religieuses, morales et esthétiques. Néanmoins, il y a encore une autre raison qui justifie notre choix d’un corpus relativement restreint.
En effet, après avoir exposé brièvement la théorie de l’analyse du discours qui se trouve au centre de nos études, il nous faut passer de l’histoire des idées à des aspects plutôt matériels. Ce changement de perspective nous permet principalement de résoudre le grand problème des sources sur lesquelles nous fondons nos travaux. Certes, les chercheurs qui ont travaillé sur la presse de l’Ancien Régime sont presque légions. Sur ce point, nous nous contentons d’évoquer les travaux importants de Monique Vincent23, de Suzanne Dumouchel24 ou de Christophe Schuwey25 qui ont tous étudié les natures et les fonctionnements des revues des XVII eet XVIII esiècles. Leurs livres et articles constituent une aide précieuse pour nos recherches, mais, toutefois, il faut admettre que le Nouveau Mercure galant reste le parent pauvre de ces études. À notre connaissance, aucun ouvrage scientifique – à part une entrée dans le Dictionnaire des journaux – ne s’intéresse au Nouveau Mercure galant d’Hardouin Le Fèvre de Fontenay. Si cette lacune n’est guère surprenante étant donné la perte de vitesse supposée de la revue et de la brièveté du règne de Le Fèvre de Fontenay sur le Mercure, il n’empêche qu’il reste intéressant de compléter ce vide dans le cadre de la recherche scientifique. Tout en nous concentrant sur les discours développés par les contributeurs du Nouveau Mercure galant , nous aborderons également des questions plus matérialistes : les plus importantes en sont certainement l’identification des contributeurs de la revue, l’étude des genres en ce qu’ils sont les véhicules transportant les propos, les moyens linguistiques dont les acteurs de la querelle se servent afin de défendre leurs positions et de « disqualifier […] l’adversaire discursif26 » ainsi que les idées chères aux contributeurs. Il s’agit donc d’« exhumer les documents » avant de les classer, ce qui nous ramène à l’archéologie et ce qui est également justifiée par la nécessité – plus historique que foucaldienne – d’une véritable critique des sources.
Ce travail d’historien rencontre pourtant des limites. Contrairement aux archéologistes, nous ne procéderons pas à une fouille généralisée d’un site historique. Au vu de notre centre d’intérêt, nous avons malheureusement dû renoncer à des recherches supplémentaires et systématiques dans les archives dans lesquelles nous aurions pu « exhumer » quelques documents méconnus concernant le Nouveau Mercure galant . Tout en assumant cette faiblesse, le périodique d’Hardouin Le Fèvre de Fontenay avec ses 29 livraisons27, dont chacune compte plusieurs centaines de pages, reste un corpus digne d’une étude plus approfondie puisqu’il parvient – d’après les recherches de Monique Vincent – à toucher un public en dehors des cercles des salons littéraires de la haute société parisienne. Toujours est-il que ce public n’en reste pas moins galant et mondain, tout en étant pour une part populaire, c’est-à-dire socialement moins influent au niveau du royaume ou de la République européenne des lettres que, par exemple, les habitués du salon de Madame de Lambert, Madame deLambert. Par conséquent, il est possible de décrire nos travaux comme une microhistoire littéraire et culturelle, pour reprendre l’expression de Carlo Ginzburg, l’auteur de l’ouvrage Le Fromage et les vers 28, qui a popularisé cette façon d’étudier l’histoire, même si le terme en tant que tel est attesté avant Ginzburg.
Bien évidemment, le Nouveau Mercure galant n’est pas le « meunier du Frioul, Domenico Scandella, DomenicoScandella dit MenocchioMenocchioScandella, Domenico, qui mourut brûlé sur l’ordre du Saint-Office après une vie passée dans l’obscurité la plus complète29 » étant donné qu’il n’est pas du tout condamné au silence, mais forme même une voix semi-officielle. Malgré quelques interdits dans le sens foucaldien30, le Nouveau Mercure galant constitue effectivement un « forum31 » sur lequel les contemporains peuvent se prononcer librement. Néanmoins, les deux objets de recherche ont des caractéristiques en commun. Ginzburg nous renseigne à ce sujet : « Réduire l’échelle d’observation revenait à transformer en un livre ce qui, pour un autre chercheur, aurait seulement été l’objet d’une note de bas de page dans une monographie sur la Réforme dans le Frioul32. » Cet autre chercheur évoqué par Ginzburg est, dans le cas de la Querelle d’Homère, Noémi Hepp. Dans son Homère en France au XVII esiècle , elle consacre certes environ une page au Nouveau Mercure galant et l’évoque dans quelques notes de bas de page, mais elle passe rapidement à autre chose et ne s’intéresse guère à la revue. Cette analyse – comme celle d’un cas particulier sous un microscope – reste pourtant dangereuse puisque nous risquons de tomber dans l’« histoire événementielle33 ». Ce risque est également identifié par Michel Foucault :
L’histoire, telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, ne se détourne pas des événements ; elle en élargit au contraire sans cesse des couches nouvelles, plus superficielles ou plus profondes ; elle en isole sans cesse de nouveaux ensembles où ils sont parfois nombreux, denses et interchangeables, parfois rares et décisifs : des variations quasi quotidiennes de prix on va aux inflations séculaires34.
Читать дальше