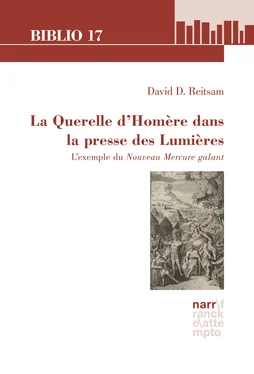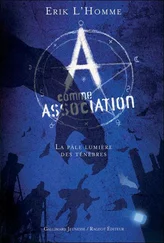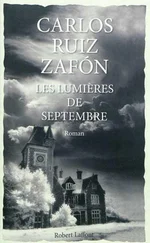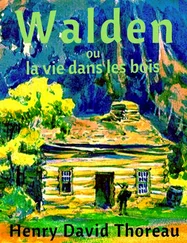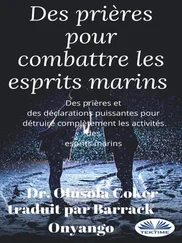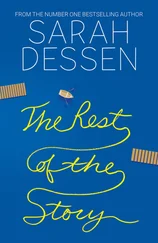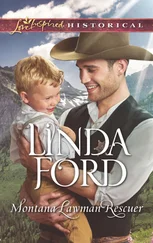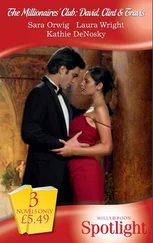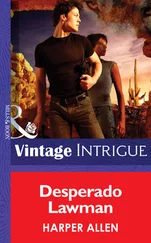David D. Reitsam - La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières
Здесь есть возможность читать онлайн «David D. Reitsam - La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
D’autres contributeurs sont pourtant plus directs et n’hésitent pas à formuler plus ouvertement leurs critiques à l’égard d’Anne Dacier. L’abbé Jean-François de Pons, Jean-François de [M. P.]Pons qui dénonce dans le Nouveau Mercure galant de mai 1715 l’ Homère vengé de François Gacon, FranҫoisGacon en constitue un bon exemple. Après avoir décrit de manière générale « Messieurs les Sҫavants […] [comme] trop scandaleusement rustiques6 », il s’en prend à la chef de file des Anciens et au censeur qui a approuvé son dernier ouvrage :
Le Livre qui parut le mois de Février dernier sous le titre des Causes de la Corruption du goust, surprit & scandalizât tout ensemble les gens sensez. Ce livre sera la honte éternelle de M. l’abbé Fraguier, Claude FrançoisFraguier, luy, qui par son approbation souscrit lâchement au traitement infâme qu’on y fait à son Confrere7.
Même sans évoquer Anne Dacier par son nom, il est évident que Pons, Jean-François de [M. P.]Pons parle de celle-ci et les lecteurs du périodique ont sans aucun doute compris cette référence car le livre intitulé Des causes de la corruption du goût était largement discuté dans le Nouveau Mercure galant de février 1715 et parce que ce contributeur n’a pas hésité à en nommer l’autrice8. Particulièrement frappante reste ici l’évocation du censeur. En suggérant que Claude François Fraguier, Claude FrançoisFraguier n’aurait pas dû approuver le livre de Dacier, Pons, Jean-François de [M. P.]Pons compare ce titre à l’ Homère vengé de François Gacon, FranҫoisGacon auquel il consacre cette dénonciation de 40 pages9. À ses yeux, Dacier ne vaut donc guère mieux que Gacon, FranҫoisGacon et même si Pons, Jean-François de [M. P.]Pons admet que l’approbateur de l’ouvrage gaconien est « infiniement plus coupable10 » que Fraguier, Claude FrançoisFraguier, il estime clairement que les deux livres doivent être corrigés.
Comparable à cette première attaque directe et plutôt violente contre Anne Dacier est la « Critique sur l’Examen pacifique de M. L’abbé de Fourmont » d’Hardouin Le Fèvre de Fontenay11 qui fut publié comme supplément au Nouveau Mercure galant en décembre 1715. Le Fèvre de Fontenay ne prend pas de gants et écrit à Étienne Fourmont, ÉtienneFourmont qui, à un moment donné du texte, devient son interlocuteur12 : « Et d’ailleurs en vous mettant de moitié des jugements de Madame Dacier sur l’Iliade, il falloit au moins, pour soûtenir le caractere de Pacificateur, desavoüer le procedé injurieux de cette Sҫavante envers son adversaire13. » Un peu plus loin, le responsable de la revue revient à l’attaque. Il résume un passage de l’Examen pacifique favorable à Houdar de La Motte et le commente de la façon suivante :
M. Fourmont, ÉtienneFourmont, vol. 2. page 208. aprés avoir justifié de son mieux les excés injurieux de Madame Dacier, remarque que M. de la Motte, loin de répondre à tant d’injures, s’est contenté de les rassembler confusément dans un Chapitre exprés de sa réponse pour en faire honte à son adversaire14.
Si ce passage rappelle les critiques déjà étudiées, cela n’est certainement pas un hasard. Cette récurrence ainsi que l’uniformité observée confirment les réflexions d’Éliane Itti qui, face à ce phénomène, parle d’une « étiquette15 » que l’on appose à l’érudite.
Les contributeurs du Nouveau Mercure galant s’inscrivent par conséquent dans un discours, qu’ils suivent souvent servilement. Or, cette critique polémique, mais uniforme – selon eux, Anne Dacier serait impolie et tiendrait des propos injurieux – est quelquefois plus habilement mise en scène. Ainsi les approches plus littéraires seront-elles étudiées par la suite.
Des attaques plus littéraires
La couverture de la Querelle d’Homère au sens étroit du terme commence dans le Nouveau Mercure galant en février 1715 : Hardouin Le Fèvre de Fontenay publie dans cette livraison de la revue une critique des Causes de la corruption du goût d’un « Auteur anonyme » qui discute amplement l’ouvrage d’Anne Dacier et attaque également directement l’Ancienne. Il fait cependant preuve d’esprit et il se montre plus innovatif que les détracteurs de Dacier que nous venons de rencontrer précédemment.
Tout comme La Motte qui entame sa dénonciation de l’œuvre homérique par un résumé des louanges prodiguées au poète grec1, le contributeur inconnu fait semblant d’établir le prestige de l’autrice qu’il s’apprête à attaquer : « Madame Dacier qui tient sans contredit le premier rang entre les Commentateurs, entreprit cette glorieuse refutation2. » Étant donné qu’il s’empresse de contester les thèses de Dacier et qu’il laisse rapidement entendre qu’il se sent proche des Modernes, les mots « glorieuse réfutation » paraissent suspects. Par la suite, ce choix lexical ne devient guère plus clair et notre interprétation est confirmée par les termes qui closent son analyse : « Nous voilà enfin debarassez du Traité DES CAUSES DE LA CORRUPTION DU GOUST [en capitales dans l’original]3. » Encore aujourd’hui, le soulagement du contributeur anonyme paraît audible. Ainsi, il est plus qu’évident que cette étude commence par une remarque ironique qui est par ailleurs suivie d’autres commentaires similaires.
Par exemple, au lieu de dénoncer simplement les termes injurieux que Dacier utiliserait selon certains Modernes, le contributeur inconnu cite un passage de la préface de sa traduction d’Aristophane ; mais il le sort de son contexte4 et il y ajoute la réflexion suivante :
C’est-à-dire, selon Madame Dacier, que si l’on rendoit justice aux bons auteurs vivans, cette justice même toute flatteuse qu’elle paroist, les jetteroit dans le découragemẽt [ sic ], parce qu’elle leur seroit un sûr augure du mépris qui les attendroit dans des tems reculez. M. de la Motte ne se seroit pas avisé de soupҫonner qu’il dût à la pure bien-veillance de son adversaire, les mauvais traitements qu’il en reҫoit, elle se gardera bien de le louer, de peur que ses éloges ne lui fassent tort & ne l’avilissent dans les tems futurs. L’extrême modestie de Madame Dacier promene sa charité par des chemins bien singuliers5.
Ainsi, il aiguise non seulement une observation d’Anne Dacier, mais il se moque également d’elle. Il suffit de se rappeler la discussion d’une Blonde et d’une Brune d’avril 1715 : la représentante des Modernes y soutient que « les mauvais traitements » – que Dacier réserverait à La Motte – et la « modestie » sont incompatibles.
De plus, l’auteur anonyme n’hésite pas à ridiculiser la traductrice d’Homère. II constate que Charles Perrault, CharlesPerrault, qu’il appelle seulement l’« Auteur des Paralleles6 », et Anne Dacier ont interprété différemment un passage de QuintilienQuintilien :
Il est surprenant que ce Dialogue [de QuintilienQuintilien] ait frappé si différemment l’Auteur des Paralleles, & Madame Dacier. Le stile neanmoins en est simple & la diction claire : Il faut sans doute que l’Auteur des Paralleles ne l’ait pas assez medité : car Madame Dacier convient qu’il faut le mediter pour y trouver que les anciens y triomphent7.
Le contributeur au Nouveau Mercure galant semble suggérer qu’il y a au moins deux lectures différentes de cet extrait du rhéteur romain et il en distingue notamment deux interprétations : le sens qui est immédiatement évident pour le lecteur et qui correspond à l’interprétation de Perrault, CharlesPerrault ainsi que le sens caché qui ne se révèle qu’après une longue médiation et qui fut découvert par Dacier. Or, il semble que l’auteur anonyme joue sur les différents sens du mot « méditer » pour dévaloriser l’approche de Dacier. D’après Antoine Furetière, AntoineFuretière, « méditer » signifie non seulement que l’on fait « plusieurs réflexions sur quelque pensée8 », mais le terme peut également être employé dans le domaine de la « Devotion9 ». Selon le Moderne, Anne Dacier n’aurait donc pas étudié QuintilienQuintilien de façon rationnelle, digne de la méthode géométrique, mais elle se serait laissée emporter par son adoration presque religieuse pour les auteurs anciens déformant de cette manière la signification du texte. Il faut en effet regarder sous tous les angles ce passage du rhéteur romain pour comprendre le sens que Madame Dacier a voulu lui attribuer.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La Querelle d'Homère dans la presse des Lumières» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.